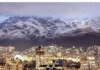La dizaine d’élections prévues en 2018 pourrait faire émerger des candidats issus des extrêmes, souvent de la droite conservatrice (mais pas toujours), propulsés par le rejet croissant de la corruption qui mine le sous-continent.
En 2018 et 2019, la quasi totalité des électeurs latino-américains se rendra aux urnes. Le coup d’envoi a été donné début février avec le premier tour de la présidentielle au Costa Rica et un référendum en Equateur. Suivront, rien que cette année, une série d’élections législatives ou locales et cinq élections présidentielles au Paraguay (22 avril), au Venezuela (d’ici la fin avril), en Colombie (27 mai), au Mexique (1er juillet) et au Brésil (7 octobre). Signalons aussi –même s’il ne s’agit pas d’une élection démocratique– le départ de Raul Castro de la présidence cubaine et la désignation de son successeur en avril (probablement l’actuel numéro deux du gouvernement Miguel Diaz-Canel), qui tournera la page de l’ère Castro.
La région n’avait pas connu une telle intensité électorale depuis le précédent cycle des années 2005 et 2006, celui du grand virage à gauche initié dès 2003 au Brésil avec l’élection de l’ancien métallo Lula et de Nestor Kirchner en Argentine, puis l’avènement de pouvoirs de gauche modérés au Chili, au Pérou ou au Costa Rica, ou plus radicaux en Bolivie, en Equateur ou au Nicaragua, ces derniers dans la foulée de la «révolution bolivarienne» du charismatique président vénézuélien Hugo Chavez.
Aujourd’hui, on s’attend à un retour de balancier. L’Argentine a déjà mis fin, en décembre 2015, à douze ans de kirchnérisme en portant au pouvoir Mauricio Macri, un libéral assumé conforté par les législatives d’octobre dernier. Au Chili, l’homme d’affaires conservateur Sebastian Piñera (déjà président de 2010 à 2014) a été élu en novembre dernier, pour succéder à la socialiste Michèle Bachelet dont il compte bien effacer les réformes sociales et sociétales (début de gratuité de l’éducation, mariage gay, dépénalisation partielle de l’avortement…). Au Brésil, depuis la destitution de la présidente de gauche Dilma Rousseff en août 2016, son successeur par interim Michel Temer mène une politique nettement droitière.
Incertitude, fragmentation et polarisation
La poursuite de ce coup de barre à droite s’expliquerait logiquement par la lassitude, le besoin d’alternance et surtout la crise que vit la région depuis l’effondrement en 2014 des cours des matières premières. Mais ce qui caractérise d’abord le cycle qui s’annonce, c’est l’imprévisibilité. Trois pays vivent des situations totalement inédites, voire surréalistes comme le Brésil, dont l’ancien président Lula a vu récemment sa condamnation confirmée en appel et alourdie à douze ans de prison, mais qui continue de surfer en tête de tous les sondages, avec 34 à 37% d’intentions de vote selon les scénarios. Malgré les recours qui lui restent, la probabilité qu’il aille en prison avant la présidentielle d’octobre est forte, d’autant que la justice est clairement décidée à tout faire en ce sens.
Le cas du Venezuela est encore plus complexe en raison du chaos dans lequel se trouve le pays, en défaut partiel, confronté à une inflation à quatre chiffres, à des pénuries intenables, à un climat toujours proche de la guerre civile, à des sanctions internationales et à un exil massif des Vénézuéliens. Initialement prévue en décembre, l’élection présidentielle a été avancée à mars ou avril par le président Nicolas Maduro, candidat à sa propre succession, mais on ne connaît toujours pas sa date exacte. Cette hâte est clairement destinée à surfer sur les récents «succès» de son camp aux régionales d’octobre 2017 et aux municipales de décembre (boycottées, elles, par l’opposition) mais aussi à couper l’herbe sous le pied de ses opposants, très divisés après les heurts meurtriers de l’été dernier et l’élection contestée de l’Assemblée constituante. Les deux leaders de l’opposition susceptibles de le battre (Henrique Capriles et Leopoldo Lopez) ne peuvent se présenter car ils ont été privés de leurs droits civiques. Dans un contexte de plus en plus répressif, l’opposition tenterait maintenant de convaincre Lorenzo Mendoza, patron du puissant groupe agroalimentaire Polar, de se présenter à ce qui risque de n’être qu’une parodie électorale …
Quant à la Colombie, elle vit une nouvelle étape hors normes puisque «Timochenko», chef des FARC –guerilla d’extrême-gauche à l’origine d’un demi-siècle de guerre civile– est candidat à la présidentielle de mai prochain. Des membres de son nouveau parti, baptisé tout bonnement «la FARC», se présentent par ailleurs aux législatives du 11 mars. Quels que soient les résultats, il est acquis, en vertu des accord de paix, que dix d’entre eux entreront d’office au Sénat et à la Chambre des députés. Pour beaucoup de Colombiens, ces concessions sont difficiles à accepter (50,2% d’entre eux ont voté non au référendum sur les accords de paix) alors que les plaies sont encore à vif et la normalisation post-conflit loin d’être acquise. Ces très fortes tensions -elles ont conduit la FARC à suspendre temporairement sa campagne– contribuent à la montée en puissance d’une droite dure, emmenée par l’ex-président Alvaro Uribe, qui n’a cessé de combattre le processus de paix du président nobélisé Juan Manuel Santos.
Ailleurs aussi, l’imprévisibilité prévaut. Au Costa Rica, petit pays d’Amérique centrale étonnamment stable dans cette zone violente et agitée, la campagne électorale impliquant treize candidats s’est déroulée dans une grande incertitude jusqu’à ce que, le 9 janvier, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme se dise favorable au mariage homosexuel. Ce simple avis nullement contraignant a électrisé un électorat costaricien très conservateur et fait surgir du plancher des sondages Fabrizio Alvarado, un pasteur évangéliste en lutte farouche contre une telle idée. Résultat, il est en tête du premier tour de la présidentielle qui a eu lieu au début du mois, et en bonne position de l’emporter au second (le 1er avril).
Outsiders radicaux
Il faut dire que, dans une Amérique latine traditionnellement catholique, l’influence des évangélistes ne cesse de croître; ils sont désormais près de 20% de la population (contre 3% il y a 30 ans) et jouent un rôle politique actif en faveur des plus conservateurs.
Au-delà, on assiste surtout, comme l’expliquait récemment Olivier Dabène, président de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (OPALC), «à l’émergence d’outsiders radicaux, en réaction à une classe politique fragilisée et décrédibilisée». Tel, par exemple, un Jimmy Morales, acteur comique sans la moindre expérience politique, élu fin 2015 au Guatemala par une population écoeurée par ses politiciens véreux, mais qui s’avère aujourd’hui plus consternant encore que ses prédécesseurs.
Au Brésil, l’outsider, c’est Jair Bolsonaro. Même si ce député fédéral de Rio est en politique depuis près de 30 ans, il n’avait jamais percé au niveau national. Or depuis des mois, cet ancien capitaine nostalgique de la dictature et de la torture, misogyne et homophobe, aux propos délibérément provocateurs, s’est solidement installé en deuxième position dans les sondages, certes loin derrière Lula mais avec 16 à 18% d’intentions de vote. Ce qui rend désormais envisageable son accession au pouvoir, si Lula ne peut se présenter.
Au Mexique –l’autre grande puissance régionale–, c’est à une poussée populiste de gauche que l’on assiste: Andres Manuel Lopez Obrador, dit AMLO, fait pour le moment la course en tête. Ce n’est pas à proprement parler un outsider, c’est même un vieux routier de la politique qui se présente pour la troisième fois, après une première tentative en 2006 (il n’a jamais voulu reconnaître sa défaite) et en 2012. Il a par ailleurs été un maire de Mexico plutôt pragmatique en 2000. Ce chantre d’une gauche radicale, pourfendeur parfois caricatural du libéralisme et des «gringos», symbolise le dégagisme auquel aspire une grande partie des Mexicains. Moins de cinq mois avant la présidentielle, il caracole en tête des sondages, devant Ricardo Anaya, candidat d’une curieuse alliance gauche-droite et, surtout, loin devant Jose Meade, le candidat du PRI, parti du très détesté président Eduardo Peña Nieto.
Diplômé de Yale, Jose Meade est souvent présenté comme un serviteur de l’État compétent. Mais le fait d’avoir été ministre de l’Économie de Peña Nieto ne joue pas en sa faveur. «C’est un technocrate non militant, qui symbolise le modèle d’ouverture économique du Mexique depuis son intégration à l’Amérique du Nord il y a 30 ans, analyse Gaspard Estrada, directeur exécutif de l’OPALC. Amlo, lui, incarne parfaitement l’alternative et l’opposition à ce modèle.» Une opposition que Donald Trump, par ses tweets, son mur et sa remise en cause du traité de l’Alena, contribue efficacement à renforcer.
Un continent malade de la corruption
L’essor d’un Bolsonaro ou d’un Amlo résulte en grande partie du profond rejet des partis politiques traditionnels et de leurs turpitudes. Pour paraphraser Bill Clinton en 1992, «it’s the corruption, stupid!». Le tentaculaire scandale de pots de vin qui a éclaté en 2014 au Brésil autour de la compagnie pétrolière Petrobras –pillée par les géants du BTP via des marchés truqués au bénéfice des partis politiques– suivi de l’opération mains propres dite «Lava Jato» (nettoyage express), a révélé l’ampleur démentielle de la corruption: des dizaines d’entrepreneurs et de parlementaires ont été mis sous les verrous, dont l’ex-chef de l’Assemblée Nationale Eduardo Cunha, condamné à quinze ans de prison pour avoir touché des millions de dollars de pots de vins. De nombreux autres sont inquiétés, plusieurs ministres du gouvernement de Michel Temer ont dû démissionner, et lui-même est dans le collimateur de la justice.
Véritable opération commando des juges et de la police fédérale, Lava Jato n’en finit pas de faire tomber des têtes, au Brésil mais aussi dans toute la région: le système brésilien, qui offre des remises de peine en échange d’une «collaboration avec la justice» fonctionne à merveille. Notamment avec Marcelo Odebrecht, PDG du numéro un brésilien du BTP et acteur majeur du scandale (condamné à dix-neuf ans de prison, il a été remis en résidence surveillée). Son groupe a arrosé de très hauts responsables politiques de tous bords dans une douzaine de pays de la région, de la Colombie au Panama en passant par l’Argentine, l’Equateur ou le Pérou. Le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski vient ainsi d’échapper de peu à une destitution, Odebrecht ayant reconnu avoir versé cinq millions de dollars à des sociétés proches de lui. Les Péruviens ne se sont pas gênés pour lui manifester leur dégoût. Cela dit, sa principale opposante Keiko Fujimori a le même problème…
Cette vaste opération punitive a d’abord soulevé l’espoir de voir ces pratiques enfin éradiquées, d’autant que la «méthode» Lava Jato franchit désormais les frontières. Mais l’impression qu’elle donne de creuser un puits sans fond depuis trois ans crée aussi une forme de découragement, comme si la corruption était trop profondément ancrée dans la société et les institutions, pour espérer la réduire un jour. La condamnation de nombreux membres du Parti des Travailleurs de Lula, puis de l’icône Lula elle-même, a d’autre part généré une profonde désillusion. Devenu très clivant, Lula suscite une véritable haine chez bon nombre de Brésiliens, même s’il conserve ses fidèles dans les classes populaires. Certains dénoncent une forme d’acharnement contre lui et une condamnation trop lourde pour ce qui lui est reproché (corruption passive et blanchiment d’argent pour avoir accepté un triplex en bord de mer d’une entreprise de BTP, ce qu’il nie). Pour Olivier Dabène, «l’action de la justice est salutaire mais elle s’est politisée et n’est pas exempte de dérives».
Au Mexique, c’est surtout le PRI –vieux parti hégémonique pendant 70 ans, revenu au pouvoir avec Peña Nieto– qui concentre la colère des gens contre l’impunité de ses dirigeants. Un gouverneur d’un État du Nord vient d’achever une spectaculaire marche de quinze jours, la «Caravane de la dignité», à travers tout le pays, pour dénoncer les détournements de fonds de plusieurs gouverneurs PRI, protégés selon lui par l’État fédéral. Les liaisons dangereuses entre narcotrafic et politique est un véritable fléau dans ce pays ravagé par la violence, où le nombre d’homicides a atteint l’an dernier le chiffre de 25.339 en 2017, selon le site Animal Politico, soit une hausse de 23% en un an et de plus de 58% depuis l’arrivée au pouvoir de Peña Nieto.
Certes, la corruption est un mal endémique de l’Amérique latine, supportée avec plus ou moins de fatalisme par les populations. Le boom des matières premières du début des années 2000 et les progrès sociaux qui ont suivi ont, en outre, légèrement réduit les inégalités sur le continent le plus inégalitaire du monde (Brésil, Chili et Colombie battant tous les records) et mis au second plan la dénonciation de la corruption. «Mais la crise a effacé bon nombre de ces progrès, on repart quinze ans en arrière», estime Olivier Dabène. De quoi alimenter les frustrations et raviver la colère contre les élites.
Reculs démocratiques
«D’autre part, poursuit-il, on assiste à une propension croissante des candidats à contester le résultat des urnes devant les tribunaux ou à anticiper la proclamation des résultats.» Des comportements «déviants» qui fragilisent ces démocraties encore en construction. Selon l’OPALC, le taux de confiance envers les institutions électorales est tombé à 29% en Amérique latine, contre 45% en 2015. La fraude se pratique parfois «au nez des observateurs internationaux». De forts soupçons de ce type pèsent sur l’élection présidentielle de décembre dernier au Honduras.
Les héros de la gauche latino-américaine, dont l’étoile a pâli, n’hésitent plus à manipuler des règles qu’ils ont parfois eux-mêmes édictées pour s’accrocher au pouvoir. Longtemps adulé en Bolivie et à l’extérieur pour ses réelles avancées sociales, Evo Morales, président depuis 2006, a déjà fait modifier sa propre Constitution en 2013 pour avoir le droit de faire un troisième mandat. En 2016, il a organisé un référendum pour en tenter un quatrième mais cette fois, les Boliviens ont dit stop. Qu’à cela ne tienne, le Tribunal constitutionnel a annoncé en fin d’année dernière qu’il pourrait quand même se représenter en 2019, suscitant dans la population une colère qui n’est pas retombée. Scénario comparable pour l’ex-président équatorien Rafael Correa (2007-2017) mais cette fois, à son désavantage: peu avant la fin de son dernier mandat, il a fait modifier la Constitution pour autoriser la réélection indéfinie, puis a fait élire un proche en 2017, Lenin Moreno, censé lui garder la place au chaud jusqu’en 2021. Las, ce dernier, très critique envers le bilan de son mentor et sa dérive autoritaire, a organisé dimanche dernier un referendum annulant cette réélection indéfinie, que les Equatoriens ont voté massivement, enterrant ainsi toute possibilité de retour de Correa.
Le facteur Trump
Entre la montée des extrêmes, la polarisation des sociétés, la liberté de la presse attaquée dans plusieurs pays et la fragmentation des partis, la gouvernabilité de certains États est mise à mal. Beaucoup parient sur l’amélioration de l’économie pour sortir l’Amérique latine de cette passe difficile. Mais depuis que le géant brésilien –privé des talents diplomatiques de Lula– s’est recroquevillé sur ses maux intérieurs, l’absence de leadership régional saute aux yeux, comme l’a montré l’incapacité des voisins du Venezuela à s’unir pour endiguer sa fuite en avant. Le Mexique, qui a toujours regardé davantage vers le Nord que vers le Sud, n’est pas, pour le moment du moins, en situation de jouer un rôle moteur. D’ailleurs, si Amlo est élu, les liens commerciaux entre Mexico et Washington, déjà fragilisés, pourraient se rompre carrément, avec un risque de déstabilisation durable pour le pays.
Or, face à un Trump plus agressif que jamais à l’égard de la région (1), cette absence de leadership est problématique. Si les États-Unis continuent de se détourner de leur ancienne «arrière-cour» et si le mégacycle électoral ne fait émerger aucun leader capable de relancer l’intégration latino-américaine, qui pourrait être tenté de remplir ce vide ? La Chine.
Source www.slate.fr