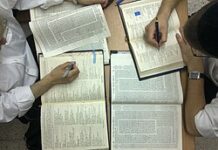Par Michel Thieren Michel Thieren, représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Israël (*)
Pour la première fois depuis le 7-octobre, Michel Thieren, le représentant de l’OMS en Israël, a choisi de parler haut et fort via les colonnes de TJ pour dénoncer les dérives de son organisation
« La tribune du représentant de l’OMS en Israël, Michel Thieren, m’a paru remarquable au point que je l’ai mis cette semaine en relation avec Sarah Cattan, de Tribune Juive. Michel Thieren était dans les kibboutz du sud et à la morgue juste après le massacre. Il a tout vu. Il a tout compris depuis le premier jour. En ce 2ème anniversaire, il a décidé de s’exprimer sur la place publique. Bravo à lui et merci à TJ.
L’auteur s’expose. C’est le prix à payer quand on fait le choix du courage et de l’honneur – rare par les temps qui courent. Aux amis journalistes : de grâce, invitez-le et ouvrez-lui colonnes et micros. Je tiens ses coordonnées à votre disposition ». Alexandra Lavastine
Nous sommes en pré-Shoah. Cela peut surprendre, même choquer, si l’on se réfère à l’unicité de la Shoah. Et pourtant, cette affirmation, je l’assume. D’ailleurs, le monde n’a jamais été exempt de pogromes. Il suffit de lire Poliakov pour s’en convaincre. Le plus frappant dans cette lecture est l’abondance : deux ans de rage antisémite quelque part, c’est deux lignes dans cette somme historique de 1000 pages que comprennent les deux volumes de l’Histoire de l’antisémitisme. Cela en dit long sur la permanence de la haine du Juif. Constitutif de l’Europe et inépuisable dans ses manifestations, il est comme le virus qui a toujours existé, et n’apparait que par poussées, au gré de l’hygiène sociétale des époques. D’ailleurs, le voir disparaitre c’est déjà commencer à craindre son retour. Aujourd’hui il y a de quoi trembler. Ce qui arrive au monde depuis 730 jours pourra peut-être ne faire que quelques phrases d’un volume posthume de Leon Poliakov, mais il est permis de penser que la future écriture de l’histoire que l’on vit en ce moment n’en fasse bien plus, car si l’antisémitisme a toujours été épidémique, il est bel et bien devenu pandémique depuis le 7 octobre, réseaux sociaux et panurgisme aidant.
Dans les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, je me suis rendu sur les terres du massacre, Kfar Aza et Be’eri, Sderot et Nova. Comme à Kigali et le Kivu en 1994, et à Srebrenica un an plus tard, ce fut la même nausée, le même silence, le silence des jouets tombés au sol comme uniques épitaphes des enfants morts, et le même constat qu’une terre de massacre ce n’est pas une terre de guerre. Tout y est figé dans le meurtre. Le lendemain, c’est depuis les frigos de la base militaire de Shoram, et le centre médico-légal de Tel Aviv où les morts des Kibboutz et de Nova reposaient sur des étagères, enveloppés dans des sacs plastique aux tailles et formes funestement suggestives de l’horreur des crimes commis, que j’ai fait le serment de rester très vigilant sur la suite à venir. Ce fut bien à propos. Il y eut d’abord le silence des instances internationales et de beaucoup de mes pairs – pas tous -, tardant à condamner le plus grand pogrome du vingt et unième siècle et ce qui deviendrait la plus grave prise d’otages de tous les temps. Peu après vint la bénédiction du 24 octobre 2023, exprimée sans équivoque deux semaines plus tard à New York au plus haut Sommet de l’administration des Nations unies dans cette parole : « Le 7 octobre n’est pas survenu dans le vide ». Les portes du « Oui mais » s’ouvrirent alors aux sceptiques de partout, et offrirent maints prétextes à l’antisémitisme pandémique de se transmettre des porteurs mal instruits aux incultes hyperconnectés.
Il avait fallu que l’apocalypse holocaustienne s’abatte sur l’Europe comme autrefois la peste noire pour céder à l’optimisme du « Plus jamais ça ». Une courte période de répit d’après-Shoah s’installa en Europe. Seulement, le « Plus jamais ça » ce n’est pas nécessairement le « Plus jamais la Shoah » et rien ne pouvait assurer que la singularité de la Shoah ne signifiait pas sa non-reproductibilité sous d’autres formes et dans un autre cadre. Il est tout à fait possible d’établir un parallèle symbolique entre les lois pré-Shoah de Nuremberg, fruits des perversions scientifiques et légales de leur temps, et l’addiction sémantique qui a mené le récit de la guerre à Gaza aux injonctions de famine et génocide, elles aussi sorties des manipulations statistiques et légales du nôtre. En ces temps de post-vérités, l’établissement des faits ne vaut rien à côté de leur incantation dans un récit fédérateur, qu’il soit légitime ou non. De là l’équation surprenante : 1935 = 2025, qui ne dit pas que Nazisme et Islamisme terroriste soient équivalents, mais que tous deux soient à même d’offrir un cadre pour deux équivalences d’antisémitisme. C’est ce que Ami’hai Chikli, Ministre israélien de la diaspora a voulu signifier en déclarant hier que « Le 7 octobre n’était pas un soulèvement populaire, mais la planification méticuleuse de l’un des actes les plus barbares de l’histoire ».
Les deux actes fondateurs du conflit entre Israël et la Hamas, le massacre et les otages, ont été – quand pas complètement tus – relégués à de maigres expédients de communication dans les dépêches des instances internationales. « Nous demandons la libération immédiate des otages » servait d’alibis à la bien-pensante « parité » des causes, ce que l’on confond à tort avec la « neutralité ». En vérité, on a évité de ne parler que du calvaire des otages, leurs familles, et des familles des victimes massacrées. Cette omission renouvelée 730 fois a fait de la souffrance des Palestiniens de Gaza – qui n’est jamais niée ici – l’unique représentation du conflit. Cela créa l’avaloir dont l’antisémitisme d’Europe et d’ailleurs avait grand besoin pour écouler son trop-plein. Dès lors que l’impasse fut faite sur ces actes barbares et sur les souffrances israéliennes en général, les notions de crimes de famine et de génocide perpétrés par le peuple Juif à Gaza furent énonçables, ceci dans une inversion inouïe et inédite de l’histoire. Et on ne s’en est pas prié pour le faire. Dès leur lancement en pâture de la civilisation du Tik Tok, le mot lempkinien et son acolyte nutritionnel devinrent deux théorèmes à démontrer, ce qui fut fait avec beaucoup d’entrain, et non sans une certaine jouissance collective.
À seulement deux semaines de ce troisième 7 octobre et encore en pleine crise des otages, la réunion des dirigeants du monde en Assemblée générale aux Nations unies, dans la foulée de la session spéciale sur la déclaration d’un Etat palestinien, fut un troublant écho à la réunion de Munich de 1938 où les Etats pactisaient avec le diable nazi sous couvert de bons offices de paix. À New York 87 ans plus tard, l’antisémitisme devait se glisser non plus dans quelques faustiennes poignées de main, mais dans des dizaines de discours, que l’on pouvait entendre comme le chorus incantatoire d’une tragédie annoncée. De Munich à New York, l’antisémitisme européen aura mis 87 ans à retrouver une faille de l’Histoire qui lui permettrait à terme de recouvrer sa manifestation en un nouveau « ça », celui qui serait passé de l’espérance du « plus jamais » à l’inéluctabilité du « à nouveau ».
Dans l’ombre menaçante de ce « ça », nous sommes donc de plein pied en période pré-Shoah, et cela nous oblige, pour encore éviter le pire, à comprendre comment l’antisémitisme se gonfle aujourd’hui d’un récit qui fait l’impasse depuis 730 jours sur le sort des otages et la souffrance d’Israël à propos de la guerre en cours, créant insidieusement les conditions possibles à un éclatement holocaustien. On irait même jusqu’à penser que l’Islamisme du Hamas, qui tel le nazisme, est exterminationiste et antisémite par une dhimmitude poussée à l’extrême, n’aurait eu pour but que de plonger l’Europe dans une déferlante antisémite dont la foudre, à défaut de pouvoir encore s’abattre sur elle puisque toujours en période d’après-Shoah, tomberait sur Israël, encore vierge de ce mal. Il est de fait difficile de ne pas voir dans la procession des discours à la tribune de New York une aveugle caution au slogan « du fleuve à la mer » qui conduirait, même à l’insu des orateurs bien intentionnés, à la noyade de l’Etat d’Israël au large des plages de Gaza.
Chemin faisant, l’antisémitisme de toujours a resurgi le 8 octobre dans une sournoise convenance sociale et dans le politiquement correct, et allait se muer en déferlantes et violences « palestinistes » dans les rues de Paris, Bruxelles, et Londres, pour ne pas dire absolument partout, gagnant aussi tournois, rencontres, et autres festivals culturels ou sportifs, non sans reprendre ses formes plus classiques d’antan telles que profanations de tombes, marquage de croix, attaques à la personne juive et incendies de synagogues. Ne vient-on pas de voir les idéologues de la « flottille des selfies » se montrer leur avant-bras tatoué du numéro de téléphone à l’intention de leur « baveux », non seulement en piétinant la mémoire de la Shah, mais en préfigurant ce que pourrait-être la suivante ? Il est vrai que cette année l’été fut particulièrement antisémite, au point que pour beaucoup d’Israéliens, il valait mieux passer ses vacances dans leur pays en guerre que d’aller dans des îles grecques ou les villes d’Occident en proie aux délires de récupérations en tout genre du drapeau pastèque.
Le discours humanitaire autour de Gaza, auquel je suis très exposé et sensible, permet de saisir ce sentiment de pré-Shoah grandissante introduit plus haut, car le « Oui, mais » du 24 octobre a implicitement balayé d’un revers de main toute chance d’émergence de dialogue entre des acteurs humanitaires opérant à Gaza et leur contreparties israéliennes, fussent-elles civiles ou militaires. Disons qu’il a donné prétexte à l’absence de dialogue. Sans vraiment jamais appeler un chat un chat, et sans vraiment dénoncer le terrorisme pour ce qu’il est, il devenait difficile pour les humanitaires et les militaires d’envisager un but commun tel que sortir les habitants de Gaza et les otages israéliens des crocs du Hamas, et de les mettre sous la protection de l’aide. Plus encore, le « Oui, mais » de New York, en appui à bien d’autres, fut l’acte manqué qui a empêché un front humanitaire commun sûr contre qui se battre et sur la reconnaissance du Hamas comme une organisation terroriste qui ne sert ni les Palestiniens, ni la cause palestinienne, ni l’Islam.
Certes, il y eut tout au long de ces 730 jours maints contacts, tables rondes et réunions, et certes y eut-il également tout un appareil de coordination entre humanitaires et contreparties Israéliennes, mais pas suffisant, semble-t-il, pour s’entendre même sur des statistiques a priori aussi élémentaires que le comptage de camions. Dès le début, les acteurs humanitaires n’ont eu de cesse que de mettre leur indignation au devant de leurs actions. Déjà en décembre 2023, dans une réunion de gouvernance multilatérale sur Gaza cette fois à Genève et à laquelle j’ai assisté en personne, on pouvait entendre combien il serait important de pouvoir démontrer scientifiquement l’occurrence d’une famine dans les mois à venir et de pouvoir utiliser le terme à des fins de communication et de pression politique sur « la puissance occupante », Israël. Il aura fallu 19 mois pour y arriver, mais le mot fut lâché bien avant, au moyen d’un passe-passe sémantique entre état de risque et état de fait, car ce qui comptait avant tout, c’était l’énonciation du mot « famine » quel que fût le qualificatif scientifique qui l’accompagnait, les gens ne voulant attacher aucune importance à de telles nuances. Le même procédé fut utilisé pour le mot « génocide » qui de manière outrancièrement prématurée – et erronée – fut prononcé par un juge international sous la forme de son génitif « acte de génocide » ou « risque de génocide ». Ce qui importait n’était pas la justesse du mot mais sa mise en résonnance dans le vide abyssal des réseaux sociaux. Et le mal était fait.
Les rapports publiés sur ces « crimes » dont la véracité méthodologique n’a pas été sans poser de sérieuses questions consacrèrent les attentes et les desseins initiaux d’un monde sous pression antisémite : il s’agissait de désigner dès le 8 octobre qui sera à jamais la victime à aider et qui sera le coupable à dénoncer.
Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, de toujours assister à une véritable tyrannie humanitaire barricadée derrière une vision dogmatique de ses pratiques et approches, et opposée à entamer un franc dialogue, non seulement pour s’accorder sur les chiffres, mais encore pour débattre de considérations bien légitimes telles que, par exemple, l’examen d’éléments suspensifs à la protection d’infrastructures médicales militarisées au point de présenter une menace sécuritaire, éléments pourtant prévus par le droit humanitaire lui-même, ou de l’applicabilité conjointe des quatre principes humanitaires pourtant lus en droit international non comme des bornes fixes de bonne conduite mais comme des repères suggérés au « jus in bello ». Un tel dialogue devait pourtant être de la plus haute importance si l’on considère le cas tout à fait particulier de Gaza où la séparation entre zone militaire et zone humanitaire est impossible, la seule frontière non israélienne de l’enclave étant continuellement fermée, créant un mélange démographique de civils palestiniens, de terroristes palestiniens, d’otages israéliens et de militaires israéliens qui constamment s’entrecroisent. Cette tyrannie humanitaire, par définition, se double d’un discours non moins tyrannique, martelant sans relâche la nature « preuve à l’appui » des crimes assignés d’entrée de jeux à la coupable Israël, tel une sinistre loi de Murphy.
Aujourd’hui, à une fuite en avant de la politique défensive d’Israël – heureusement sans doute arrêtée d’ici peu et dont l’analyse est hors propos ici – répondit une fuite en avant de l’offensive antisémite du monde, qu’il soit politiquement humanitaire ou humanitairement politique. Même s’il reste encore un idéal humanitaire neutre parmi beaucoup d’entre nous ainsi qu’une retenue politique dans toute la société israélienne, l’inquiétude ici réside en un risque de cette mise en résonnance de ces deux « amoks », donc de leur possible explosion en une Shoah en Eretz Israël, une fois les derniers alliés lâchés. Que d’autre pourrait-il se passer pour un Israël seul et contre tous, piétiné et laissé pour compte dans les sables mouvants des déserts qui l’entourent ? Cette prédiction est aussi plausible que celle qui put être faite en 1984 à propos de la chute six ans après de l’olympique Sarajevo aux mains d’un national socialisme serbe. On ne néglige jamais assez les scenarios du pire quand ils se démasquent subrepticement.
Entre temps, 48 otages sont morts ou se meurent dans les tunnels du Hamas, et il est illusoire de penser leur libération facilement négociable, puisqu’elle signerait la fin pour leurs geôliers de tout moyen de pression. Il faudrait plutôt que l’acharnement diplomatique sur Israël se déplace sur le Hamas et ses appuis, dans un cocktail de sanctions, étranglement financier et isolement politique. Sans doute y arriverons-nous dans les prochains jours à Sharm el-Sheikh. Cela va-t-il éclaircir ces sombres temps ? Je n’en suis pas si sûr car cela exigerait un changement radical de paradigme entre antisémitisme et raison, ce qui est fort peu probable, tant l’antisémitisme est résilient dans l’âme des hommes, et tant il est un mal capable du pire, même de se faire aimer pas les plus innocents et les plus ignorants parés des meilleurs offices. Perversement aimable et aimé, l’antisémitisme n’est en conséquence même pas accusable, puisque désigner un antisémitisme, c’est se confronter au déni de celui-ci qui en est en fait une de ses plus singulières expressions. Tel l’arroseur arrosé, l’accusation revient en boomerang sur l’accusateur, et il n’est pas étonnant que tellement de gens se disent consternés de voir que la seule ligne de défense d’Israël est l’antisémitisme à leur égard.
On comprend mieux aussi pourquoi une facilité de retournement et d’inversion est ce qui caractérise le plus toute l’histoire de l’antisémitisme. Les Kibbutz de Kfar Aza et Be’eri, visités dans la foulée du 7 octobre 2023, n’avaient rien de la terre d’un peuple génocidaire contre qui l’accusation était déjà en gestation avancée. Ne pas succomber à l’antisémitisme demande donc un travail journalier d’entendement, et comme très peu de gens s’y attèlent, le monde s’y glisse avec une facilité déconcertante. C’est à ce titre que j’ai commémoré mon 7 octobre il y a deux jours à Yad Vashem où je me suis recueilli sous la grande coupole des noms et des portraits et devant la flamme du Mémorial, cela dans l’absolue certitude de ce que « génocide » signifie, et ne signifiera jamais.
Si nous n’en sommes pas encore là, les similitudes et manifestations déjà citées du mécanisme antisémite enclenché existent et ne peuvent être ignorées. Dire qu’une paix durable est le seul moyen de le suspendre est illusoire. On ne termine pas une guerre de 100 ans sur des déclarations d’intention, aussi sincères fussent-elle sur l’instant. Un certain rapport de force devra se maintenir car l’Etat d’Israël est le symbole du Juif debout qui pour la première fois en quatre millénaire peut se défendre. Il serait bien utopique, et risqué, de penser que ce rapport de force puisse décroître avec un contrôle de la pandémie antisémite et se poser quasi asymptotiquement sur une concorde.
Mais de quoi je me mêle, me direz-vous à moi qui écris ces phrases en n’étant qu’un observateur de passage, un non juif et un non Israélien ? Il ne s’agit pas d’imposture ou de naïveté, mais de responsabilité de témoin, qui depuis cinq ans, et surtout deux, a vu, écouté, et senti de très près les nouveaux « sombres temps » qu’Israël, les Israéliens et la diaspora juive traversent. Il n’y a pas non plus de négation du calvaire dans lequel deux millions de civils palestiniens sont plongés sous le regard absent de leurs frères du Caire à Amman et de Beyrouth à Riadh.
Je me mêle de cela parce qu’en 730 jours passés en pré-Shoah et en tyrannie humanitaire, sans vraiment savoir lequel conduit à l’autre, je me suis rendu compte d’une chose, qui est qu’il ne faut pas être juif pour souffrir d’antisémitisme.
C’est à ce titre que j’ai pu présenter à une otage libérée et à la mère d’un otage encore détenu mes excuses comme Représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Israël pour n’avoir jamais été capable de fournir la moindre aide que ce soit, à part les témoignages de sympathie. Penser en pré-Shoah, c’est donner une chance de mettre un terme aux plus de 102,500 jours cumulés d’atroce détention.
© Michel Thieren
(*) Rédigé à titre personnel.
Alexandra Laignel Lavastine est philosophe, historienne, essayiste et éditorialiste. On lui doit notamment un des livres précurseurs sur notre sombre actualité : « La Pensée égarée : Islamisme, populisme, antisémitisme : essai sur les penchants suicidaires de l’Europe » (Grasset 2015). Elle vient de publier la biographie d’un grand Résistant français : « André Zirnheld, le Chant d’un partisan » (Cerf, 2025), un Compagnon de la Libération et un succès de librairie. Toujours la même histoire, dit-elle : « Juin 40 ici, juin 40 là, depuis le 7-Octobre « …