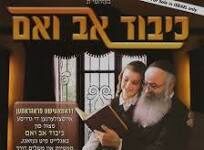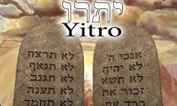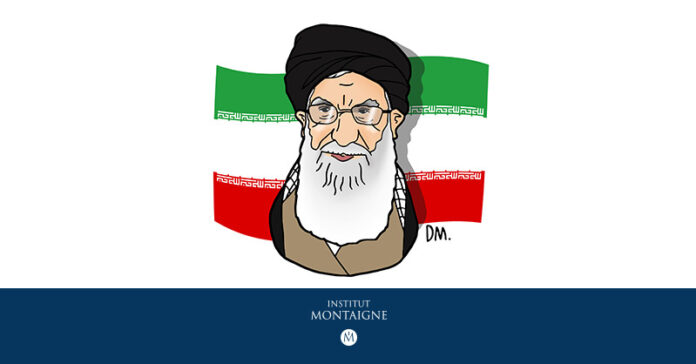L’échec des négociations nucléaires pourrait accélérer l’effondrement du régime iranien et le pousser à des actes extrêmes, comme l’accélération de l’enrichissement d’uranium et l’intensification des attaques contre les intérêts et actifs des États-Unis, d’Israël et de leurs alliés dans la région.
Ma’ariv
Les déclarations publiques de Donald Trump, selon lesquelles l’Iran serait « en grand danger » si les pourparlers échouaient, attirent une attention considérable. L’ultimatum de deux mois imposé pour conclure les négociations, accompagné d’une menace voilée d’action militaire, limite fortement la marge de manœuvre diplomatique. Les chances de parvenir à un accord global et contraignant dans un délai aussi court – malgré un optimisme prudent et des rapports positifs sur des « discussions sérieuses » entre les États-Unis et l’Iran – restent faibles. Le principal point de blocage est l’arrêt du programme nucléaire et de l’enrichissement de l’uranium.
Parallèlement, le renforcement du dispositif militaire américain, incluant le déploiement de bombardiers stratégiques B-2 et de chasseurs F-35 dans l’océan Indien et au Moyen-Orient, ainsi que l’intensification des frappes contre les Houthis au Yémen, accentuent la pression sur Téhéran et soulignent la gravité de la menace. L’approche de « pression maximale » des États-Unis s’appuie également sur la fragilité économique iranienne (chômage des jeunes à 30 %, inflation à plus de 40 %, et dévaluation de 55 % du rial depuis 2015), visant à forcer l’Iran à céder sur ses ambitions nucléaires.
Cependant, les actions agressives de Trump ont renforcé l’opposition farouche du Guide suprême Ali Khamenei, approfondissant la méfiance envers les États-Unis et compliquant encore davantage les possibilités de compromis. En réaction, l’Iran durcit sa position, refuse d’abandonner l’enrichissement d’uranium ou ses capacités balistiques, considérant son programme nucléaire comme un pilier de sa stratégie de dissuasion – officiellement civile selon l’accord JCPOA de 2015.
Téhéran accuse Trump d’avoir quitté unilatéralement l’accord en 2018 et considère les pressions actuelles comme une tentative de changement de régime. Le ministère iranien des Affaires étrangères a d’ailleurs déclaré cette semaine que toute exigence dépassant les termes de 2015 ou touchant à la souveraineté et aux capacités défensives du pays entraînerait une rupture immédiate des pourparlers.
En dépit de sa situation économique difficile, l’Iran cherche à renforcer son influence au Moyen-Orient et exige la levée immédiate de toutes les sanctions, y compris celles qui bloquent ses revenus pétroliers et gaziers. Malgré les sanctions, la production pétrolière iranienne atteint actuellement 3,99 millions de barils par jour – soit 4 % de la production mondiale, ce qui en fait le troisième producteur de l’OPEP+.
Une impasse géostratégique
Ne pas parvenir à un nouvel accord limitant le programme nucléaire iranien dans le contexte actuel – entre crise économique interne, avancée technologique, guerre à Gaza et lutte contre les Houthis – constituerait une situation explosive. Cela pourrait avoir des conséquences sécuritaires dramatiques, modifier les équilibres stratégiques au Moyen-Orient, et affecter l’ordre mondial.
Un échec des négociations pourrait fortement augmenter le risque d’escalade militaire et obliger Israël à envisager une attaque unilatérale, avec ou sans soutien américain, contre les installations nucléaires iraniennes. Cela pourrait conduire à un conflit régional majeur.
Si l’Iran réduit son « temps de percée » à quelques semaines (ayant déjà accumulé 275 kg d’uranium suffisant pour 6 à 7 bombes), le risque sécuritaire s’aggrave. Une sortie du TNP (Traité sur la non-prolifération) ouvrirait la porte à une dissémination incontrôlable de l’arme nucléaire, avec un risque de transfert à des groupes terroristes ou milices pro-iraniennes. Cela pourrait également pousser d’autres pays comme la Turquie, l’Égypte ou l’Arabie saoudite à se doter de capacités nucléaires.
Un climat de sécurité instable
L’effondrement des négociations et l’aggravation des sanctions pourraient renforcer l’axe Téhéran-Moscou-Pékin, notamment via des accords comme l’initiative chinoise de la « Ceinture et la Route ». L’Iran pourrait aussi relancer son réseau de milices régionales pour frapper des cibles américaines ou israéliennes, voire les infrastructures pétrolières du Golfe.
Les répercussions de ces scénarios dépasseraient largement le cas iranien : elles affecteraient les marchés pétroliers mondiaux, les économies dépendantes du pétrole et les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment à cause des droits de douane instaurés par Trump.
Vers l’effondrement du régime ?
L’isolement accru et la crise économique (PIB de 401 milliards de dollars en 2024, avec 40 % de la population sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale) affaiblissent encore davantage le régime. L’inflation, la pauvreté, la baisse du pétrole et du rial creusent le mécontentement interne, surtout chez les jeunes.
La pression des Gardiens de la Révolution, hostiles à tout compromis, et le clivage entre conservateurs et réformistes (sous la direction du président Masoud Pezeshkian), exposent le régime à un test crucial. Toute nouvelle crise – militaire, sociale ou économique – pourrait entraîner un effondrement interne aux multiples dimensions.
Une telle implosion remettrait en cause la légitimité du régime, minerait son image de puissance régionale et accélérerait, enfin, sa chute.