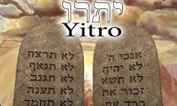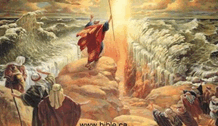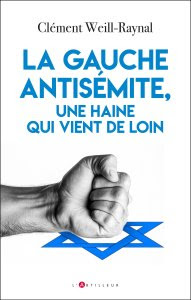Longtemps perçue comme le camp du progrès et des droits humains, la gauche française se voit aujourd’hui confrontée à un passé encombrant, que certains préféraient oublier. Dans son ouvrage La Gauche antisémite, publié aux éditions L’Artilleur, le journaliste Clément Weill-Raynal bouscule les certitudes : l’antisémitisme n’est pas uniquement le fait de l’extrême droite, mais a aussi de profondes racines dans les traditions socialistes, marxistes, voire républicaines.
Depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023, La France Insoumise et certains de ses alliés n’ont cessé de se positionner avec virulence contre Israël. Mais pour de nombreux observateurs, cette hostilité dépasse le cadre politique et touche directement les Juifs en tant que communauté. Accusations de « complot », caricatures douteuses, refus de reconnaître l’antisémitisme du Hamas, silence sur les prises d’otages israéliennes : les exemples se sont multipliés, laissant place à une inquiétude croissante.
Une histoire réécrite
L’un des apports majeurs du livre de Weill-Raynal est de démontrer que la gauche n’a pas toujours été du côté des Juifs — y compris durant l’affaire Dreyfus, où la fracture était bien réelle. Contrairement à l’image souvent véhiculée d’une gauche unanimement dreyfusarde, de nombreux socialistes et républicains de l’époque se sont montrés réticents à défendre le capitaine juif accusé à tort de trahison.
Antisionisme ou antisémitisme ?
Pour Weill-Raynal, l’antisionisme militant a souvent servi de paravent à un antisémitisme plus profond. Cette tendance est particulièrement visible dans les années 2000, avec la montée des tensions entre Israël et les territoires palestiniens. France Inter, notamment dans les émissions de Daniel Mermet, ou Le Monde, avec des tribunes d’Edgar Morin, ont parfois relayé des discours où l’État d’Israël est assimilé aux Juifs dans leur ensemble, une confusion qui nourrit le ressentiment.
Des figures oubliées et dérangeantes
Weill-Raynal exhume également les écrits de grands penseurs socialistes tels que Karl Marx, Jules Guesde, Jean Jaurès, ou Proudhon, dont les textes comportent des passages explicitement hostiles aux Juifs. Pour Karl Marx, dans son essai La question juive, le judaïsme est assimilé à l’argent et à la cupidité, dans une logique qui fusionne anticapitalisme et préjugés religieux.
Du procès de Prague en 1952 aux purges antisémites de Staline en URSS, la gauche communiste européenne n’a pas été épargnée. En France, le Parti communiste et la CGT ont parfois fermé les yeux, voire cautionné, ces épisodes, au nom d’une fidélité à l’Union soviétique.
Une idéologie qui persiste
Aujourd’hui, cette tradition trouve de nouveaux relais. Certains mouvements féministes refusent de coopérer avec des collectifs juifs, au motif que le sionisme serait incompatible avec leurs valeurs. Des groupes LGBTQ+ excluent également les militants juifs pro-israéliens. Dans le monde universitaire, des étudiants de grandes écoles participent à des manifestations où le soutien au Hamas devient ouvert, effaçant la distinction entre critique d’un État et rejet d’un peuple.
Le livre de Clément Weill-Raynal n’est pas une charge idéologique, mais un travail de mémoire. Il met en lumière ce que d’aucuns préfèrent taire : une part obscure de l’histoire politique française, qui traverse les décennies, les partis et les causes. Une réflexion salutaire pour tous ceux qui refusent que la critique d’un pays se transforme, insidieusement ou frontalement, en rejet d’un peuple.