Le 11 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendu une décision aux implications juridiques et politiques considérables : les Palestiniens originaires de Gaza peuvent, désormais, se voir reconnaître le statut de réfugié en France, non plus seulement pour des raisons liées au conflit, mais en tant que victimes de persécutions fondées sur leur nationalité. Une décision qui bouleverse le traitement habituel des demandes d’asile palestiniennes et provoque de vives réactions dans le paysage politique français.
Une reconnaissance fondée sur la persécution
Jusqu’à présent, les ressortissants de Gaza pouvaient généralement bénéficier d’une protection subsidiaire, accordée à ceux fuyant une guerre intense, mais sans reconnaissance d’une persécution ciblée. Désormais, la CNDA estime que la nature répétée des opérations militaires israéliennes, touchant massivement la population civile, constitue un risque réel de persécutions au seul motif de la nationalité palestinienne.
Cette avancée est survenue dans un contexte de détérioration rapide de la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne, après la rupture du cessez-le-feu en janvier 2025 et la reprise des combats. La CNDA a notamment été saisie du cas d’une mère de famille fuyant les bombardements, à qui l’OFPRA avait initialement refusé le statut de réfugiée, ne jugeant pas ses craintes « suffisamment individualisées ». La Cour a cassé cette position, estimant qu’une situation de persécutions généralisées pouvait suffire.
Il ne s’agit toutefois pas d’un droit d’asile universel et automatique pour tous les Palestiniens. Chaque demande doit toujours être examinée individuellement, et le requérant doit démontrer un risque réel et personnel. Néanmoins, la jurisprudence crée un précédent qui facilitera considérablement la tâche des avocats et demandeurs.
Dans les faits, les arrivées depuis Gaza restent limitées, en raison des lourdes restrictions de sortie imposées par Israël et l’Égypte. L’impact immédiat en termes de flux migratoires reste donc marginal, ce que soulignent nombre de spécialistes.
Cette décision a été saluée par les associations de défense des étrangers, qui y voient une avancée humanitaire et juridique. Mais elle a aussi déclenché une vague d’indignation dans les rangs de la droite et de l’extrême droite, où l’on fustige une dérive du droit d’asile.
Éric Zemmour a vivement critiqué la CNDA, l’accusant de « mépriser la souveraineté populaire », et appelle ni plus ni moins à suspendre l’application de la Convention de Genève. Dans une tribune publiée dans Le Figaro, le président de Reconquête dénonce l’existence même d’instances juridictionnelles pouvant contraindre l’État à accorder l’asile contre sa volonté.
Des chiffres qui nourrissent le débat
Selon les dernières données de l’OFPRA, plus de 660 000 personnes bénéficient actuellement du droit d’asile en France, contre moins de 200 000 il y a dix ans. En 2024, 153 715 demandes d’asile ont été enregistrées, soit plus du double de celles déposées en 2004. L’Afghanistan reste, pour la septième année consécutive, le principal pays d’origine des demandeurs.
La décision du 11 juillet marque un tournant juridique important pour les demandeurs d’asile palestiniens et illustre les tensions croissantes entre droit international et discours politiques nationaux. Si elle renforce la protection de certains exilés, elle met aussi en lumière les fractures profondes autour de l’accueil de certains réfugiés en France.





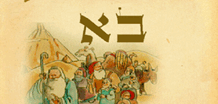
























« au seul motif de la nationalité palestinienne. » Depuis quand y a-t-il une nationalité palestinienne ?