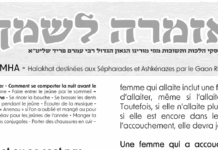Sous la pression diplomatique et populaire liée aux combats à Gaza, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a tracé une ligne rouge : l’Égypte n’engagera pas d’action militaire contre Israël et conditionnera l’acheminement de l’aide humanitaire à une coordination avec l’État hébreu. Sa posture, martelée publiquement, fait écho à une logique de préservation des intérêts nationaux et de sécurité des citoyens égyptiens — priorités que le président met au-dessus des appels à une réaction unilatérale.
La décision du Caire s’inscrit aussi dans un contexte de tensions bilatérales croissantes : Jérusalem a récemment demandé l’appui américain pour pousser l’Égypte à réduire certaines présences militaires dans le Sinaï, évoquant des inquiétudes sur le respect des clauses du traité de paix de 1979. De son côté, Le Caire justifie ses déploiements par des impératifs sécuritaires propres — notamment la protection des frontières et le contrôle des flux — et rejette toute interprétation qui le pousserait vers une escalade. Ces désaccords illustrent combien la relation israélo-égyptienne, historiquement fondée sur des garanties américaines, reste fragile en période de crise régionale.
Politiquement, al-Sissi joue un double rôle : il affirme son refus de l’escalade militaire tout en se positionnant comme médiateur possible pour l’après-conflit, prêt à accueillir ou coordonner des initiatives internationales de reconstruction. Cette posture vise à préserver la stabilité intérieure égyptienne — éviter l’arrivée massive de réfugiés, maintenir le contrôle du Sinaï et protéger les liaisons énergétiques et commerciales — tout en restant un acteur central dans les négociations régionales.
Enfin, la ligne du Caire souligne une réalité diplomatique : même sous forte pression internationale et populaire, un État peut choisir la retenue quand ses intérêts de sécurité le dictent. En refusant d’être « entraîné » dans la guerre, al-Sissi renvoie l’image d’un dirigeant qui privilégie la manœuvre politique et la coordination internationale plutôt que la riposte militaire — une stratégie susceptible de limiter l’escalade immédiate, mais qui pose la question de l’efficacité des corridors humanitaires tant que le conflit se poursuit.
Jforum.fr