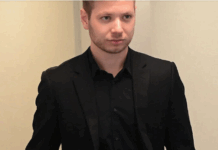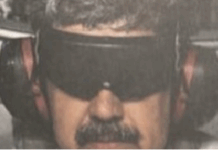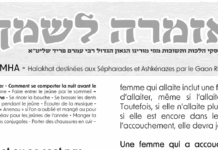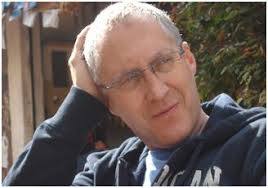Depuis le 7 octobre 2023, comment décririez-vous l’évolution de l’antisémitisme en France ?
Loin d’être un surgissement isolé, chaque flambée récente s’inscrit dans une dynamique de long terme : les pics d’actes antisémites coïncident de manière récurrente avec les crises du Proche‐Orient. Cette corrélation ne se limite pas à une simple concomitance chronologique : elle s’explique aussi par les répercussions médiatiques et l’importation des tensions internationales dans le débat public, qui favorisent la circulation de stéréotypes et l’amalgame entre Juifs et politique israélienne. Ainsi, les années 2000, 2002, 2004, 2009, 2012, 2014, 2019, 2023 – 2025 s’inscrivent toutes dans ce même schéma. Et, depuis 2000, on observe l’émergence de nouvelles formes d’antisémitisme : cyberhaine, instrumentalisation des enjeux moyen‐orientaux, et confusion identitaire persistante. Aucun ralentissement structurel n’a été observé : chaque crise ravive un antisémitisme déjà bien ancré.
Mais, lorsqu’on élargit la perspective, on constate que la France n’est pas seule confrontée à cette dynamique. Si les chiffres français témoignent d’une forte intensité, la montée de l’antisémitisme se constate aussi en Allemagne, en Belgique, au Royaume‐Uni et aux États‐Unis, où l’on observe également de nouveaux pics d’actes et de discours haineux depuis plusieurs années. Ces évolutions traduisent un phénomène occidental plus large, sous l’effet conjugué de la médiatisation des crises internationales, de la circulation des discours antisémites sur les réseaux sociaux et de l’importation idéologique des conflits extérieurs. Enfin, depuis octobre 2023, l’ampleur de la hausse est indéniable : de 436 actes en 2022, on passe à 1 676 en 2023, soit une augmentation de plus de 1 000 %. Même avec le léger recul observé en 2024 (1 570 actes), le niveau demeure exceptionnellement élevé par rapport aux années précédant la guerre de 2023.
Comment expliquez-vous que le pogrom qui s’est déroulé en Israël le 7 octobre ait eu pour conséquence une hausse de l’antisémitisme en France ?
Dans mes travaux, je souligne la singularité de l’antisémitisme, qui vise les Français de confession juive de façon indifférenciée à chaque crise impliquant Israël, et l’injustice flagrante qui consiste à assigner collectivement cette minorité à la situation politique d’un autre pays. La flambée observée depuis le 7 octobre ne fait que réactiver une logique déjà constatée lors des précédentes crises : le conflit israélo‐palestinien, par ses répercussions internationales, se traduit quasi systématiquement par un regain de violences et de menaces antisémites dans la société française. Il faut aussi souligner le rôle amplificateur des réseaux sociaux : ces plateformes facilitent la diffusion rapide et massive de discours antisémites lors de chaque crise affectant Israël, participant à une mobilisation aussi bien virtuelle que réelle des actes de haine, tout en donnant une visibilité élargie à la haine antisémite.
Pourtant, il importe de rappeler la pluralité et la diversité qui caractérisent la communauté juive française : ses membres se distinguent largement par leurs histoires, leurs convictions et leurs engagements. Hélas, cette richesse est systématiquement occultée par les discours antisémites, qui procèdent à une essentialisation simplificatrice et violente. Cette négation de la complexité sociale et identitaire contribue à aggraver la violence symbolique de l’assignation collective. Ainsi, la spécificité de l’antisémitisme contemporain en France tient à cette mécanique d’importation du conflit, d’assignation identitaire et de négation de la pluralité juive, renforcée par l’effet démultiplicateur des réseaux sociaux.
Quels lieux ou moments du quotidien (école, université, travail, réseaux sociaux) sont devenus les plus difficiles pour les Juifs depuis cette date ?
À chaque flambée du conflit israélo‐palestinien, les Français de confession juive sont exposés dans tous les lieux symbolisant leur présence et/ou leur identité – écoles, lieux de culte, espace public, réseaux sociaux – à une « rage d’importation », où ce sont d’abord les signes de judéité et/ou les communautés visibles qui cristallisent la haine et servent d’exutoire aux passions alimentées par cette guerre.
Depuis le 7 octobre 2023, la recrudescence des actes antisémites a fortement touché les milieux scolaires et universitaires, où l’on a signalé un doublement, voire un quadruplement des incidents depuis octobre 2023. Les études mettent en évidence une augmentation préoccupante des actes et propos antisémites dans les établissements scolaires. Or cet antisémitisme (en milieu scolaire) se manifeste sous diverses formes : violences verbales, harcèlement, mises à l’écart, menaces et agressions physiques. De plus, une large part des élèves juifs adoptent des stratégies d’invisibilité pour éviter d’être ciblés, tandis que d’autres continuent de quitter leur établissement par crainte pour leur sécurité.
Au total, 1 670 actes antisémites ont été recensés dans les écoles publiques françaises pour l’année scolaire 2023–2024, contre 400 en 2022–2023 selon le ministère de l’Éducation nationale. Selon plusieurs études, 62% des victimes d’actes antisémites indiquent que les violences subies l’ont été au sein d’un établissement scolaire. Par ailleurs, les chiffres récents montrent une nette aggravation de l’antisémitisme dans le milieu universitaire en France depuis le 7 octobre 2023, marquant une rupture par rapport aux années précédentes. Par exemple, selon une enquête publiée par l’UEJF (Union des étudiants juifs de France) en septembre 2023, 91% des étudiants juifs déclarent avoir déjà été personnellement victimes d’un acte antisémite durant leur parcours étudiant (insultes, mises à l’écart, menaces, violences ou harcèlement). Beaucoup évoquent une banalisation du phénomène ou le sentiment d’une « invisibilité contrainte » pour éviter de s’exposer.
De plus, la haine en ligne a explosé, avec une augmentation de plus de 60% des signalements de contenus antisémites entre 2022 et 2023, selon la Dilcrah. Les attaques sur les réseaux sociaux (harcèlement, menaces, diffusion de listes noires, etc.) deviennent plus nombreuses et violentes, avec une viralité et une visibilité décuplées depuis la guerre en Israël. Enfin, selon diverses enquêtes, certains Juifs disent devoir masquer leur identité ou éviter de parler d’Israël pour ne pas être l’objet de remarques, d’ostracisme ou de mise à l’écart dans le cadre professionnel.
Alors, je veux souligner la douleur de devoir sécuriser ses enfants à l’école, vivre sous surveillance policière même dans la pratique religieuse ou culturelle, ou encore éviter de se manifester en entreprise ou sur internet sous peine de représailles, ce qui est une expérience unique comparée à celle d’autres groupes minoritaires en France.
La société française, selon vous, a-t-elle été à la hauteur dans sa réponse à cette montée de l’antisémitisme ?
Cette question est assurément complexe, d’autant qu’elle suscite souvent des réactions passionnées ou des analyses fondées sur des ressentis personnels. Pour ma part, je souhaite rappeler ce que j’ai déjà exposé : la flambée de l’antisémitisme observée depuis octobre 2000, et singulièrement aggravée depuis le 7 octobre 2023, ne constitue pas une spécificité française. De très nombreux pays connaissent des poussées similaires, et la situation peut parfois s’avérer plus préoccupante encore en Grande‐Bretagne ou en Belgique qu’en France. Il est donc essentiel d’aborder ce phénomène à l’aune de sa dimension internationale, en évitant de tomber dans le piège d’une stigmatisation nationale ou de jugements hâtifs sur la capacité singulière de la société française à y faire face. De fait, vous comprendrez aisément que je veuille privilégier la factualité et la prudence sur les jugements moraux ou accusateurs que je lis ici ou là et que j’entends sur certains plateaux de télévision.
Cela dit, l’exigence reste de mise. Une observation attentive de la scène politique et sociale depuis 2023 montre que l’ampleur et la violence inédite de cette vague antisémite – exacerbée par le conflit entre Israël et le Hamas – ont mis les réponses institutionnelles à rude épreuve. Le nombre d’actes recensés a atteint un niveau inédit depuis la création des dispositifs de signalement, et la brutalité de certaines agressions a profondément marqué la société, accentuant le sentiment d’insécurité au sein de la communauté juive.
Le principal défi tient à la capacité des autorités à anticiper de tels chocs, à tenir un discours rassembleur, et à fédérer la société autour d’un refus réel de l’antisémitisme, alors que le contexte international complexifie la tâche politique. Ces exigences, fondamentales dans une République, ont mis à l’épreuve la parole présidentielle et gouvernementale ces derniers mois. L’absence remarquée lors de moments clés, la lenteur ou la retenue de certaines prises de parole officielles, illustrent les limites rencontrées par l’appareil institutionnel. Il ne s’agit donc pas tant d’un manque de volonté que d’une confrontation avec des limites structurelles et contextuelles, qui rendent la réponse actuelle perfectible.
Quelles pistes concrètes vous semblent les plus urgentes pour combattre durablement l’antisémitisme ?
À mes yeux, plusieurs dispositifs mériteraient d’être améliorés. Pour répondre plus précisément, je propose de centrer la réflexion sur le domaine de l’éducation. Il me semble en effet indispensable de formuler quelques pistes concrètes pour améliorer les processus en place, permettre aux enseignants d’exercer leur mission dans une plus grande sérénité, et renforcer la qualité des enseignements dispensés dans nos établissements scolaires. Bien entendu, j’ai pleinement conscience de la complexité de ces enjeux, mais je suis convaincu que des marges de progrès demeurent possibles.
Par exemple, il importe de garantir la sécurité et l’accompagnement des enseignants lorsqu’ils abordent l’histoire de la Shoah ou le conflit israélo‐palestinien : des mesures disciplinaires fermes contre les comportements d’intimidation doivent permettre de restaurer un climat de respect et de soutenir la liberté pédagogique. Il est également essentiel d’actualiser et de diffuser systématiquement les ressources éducatives – guides, affiches de prévention, outils en ligne – et de renforcer les partenariats associatifs.
Au cœur des programmes officiels, la sensibilisation aux phénomènes de racisme et d’antisémitisme doit non seulement être maintenue, mais enrichie et précisée, me semble‐t‐il : enseignement de l’histoire du judaïsme, de la diversité diasporique, de l’évolution de l’antisémitisme dans la longue durée, ainsi que des faits religieux et du patrimoine culturel à travers l’histoire, les lettres, la philosophie ou les arts. L’organisation de rencontres concrètes (visites de lieux de culte, sites liés à la Shoah, musées de la résistance) constitue un levier pédagogique essentiel pour ancrer durablement ces apprentissages.
La multiplication des initiatives – participation active aux Journées européennes de la culture juive, enseignement rigoureux des génocides et crimes contre l’Humanité, comme le propose l’historien Iannis Roder, travail de fond sur la déconstruction des stéréotypes et la lutte contre le complotisme – contribuera à aiguiser l’esprit critique et à inscrire la pluralité des mémoires au cœur du vécu scolaire.
Pour garantir l’efficacité et la cohérence de ces mesures, il est indispensable d’intégrer une évaluation régulière des dispositifs, afin de les ajuster aux évolutions du terrain et d’accompagner les enseignants durablement. Par ailleurs, cette lutte ne peut reposer sur les seuls enseignants : elle doit mobiliser l’ensemble de la communauté éducative – professeurs, direction, rectorats, parents – dans une dynamique collective et responsable. Enfin, dans l’application des sanctions et des mesures disciplinaires, il convient d’articuler fermeté, pédagogie et prévention, afin d’éviter tout excès répressif et de préserver le climat d’apprentissage nécessaire.
Deux ans plus tard, quel est l’état d’esprit dominant dans la communauté juive française : peur, résilience, lassitude ?
Deux ans plus tard, le sentiment qui domine au sein de la communauté juive française est malheureusement un mélange profond de lassitude et d’inquiétude. Nombre de nos compatriotes juifs avouent perdre espoir face à la persistance de la situation, qui demeure particulièrement grave. Leur souffrance est réelle, palpable au quotidien, et il est difficile d’accepter qu’en République, tant d’hommes et de femmes soient à ce point rattrapés par l’angoisse et le désenchantement. Cette souffrance, cette fatigue et cette inquiétude récurrentes constituent, à mes yeux, une réalité intolérable pour notre société.
Propos recueillis par Paloma Auzéau