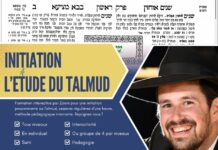Deux ans après le 7 octobre, Israël reste confronté à une équation explosive : comment établir les responsabilités du pire désastre sécuritaire en temps de paix tout en préservant la stabilité d’un pays encore sous tension ? La semaine a offert une réponse, controversée : à la Knesset, la commission de Contrôle de l’État a rejeté la création d’une commission d’enquête d’État sur les défaillances du 7 octobre, tandis que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a écarté son conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, aussitôt remplacé par son adjoint, Gil Reich.
Le choix parlementaire est lourd de sens. En Israël, une commission d’État est l’outil le plus crédible pour une investigation apolitique : présidée par un juge (souvent de la Cour suprême), elle dispose du pouvoir d’assignation, d’un accès complet aux documents et d’une indépendance institutionnelle. Son histoire parle d’elle-même : après la guerre du Kippour, la commission Agranat a remué l’appareil sécuritaire ; après la seconde guerre du Liban, la commission Winograd a mis à nu les failles de la décision et de la préparation. Ces précédents ont ancré l’idée que, face aux traumatismes nationaux, la vérité doit passer par une procédure rigoureuse et visible.
La séquence a été d’autant plus inflammable qu’elle a coïncidé avec le départ de Tzachi Hanegbi. Figure de longue date du camp national, devenu chef du Conseil de sécurité nationale fin 2022, Hanegbi a assumé publiquement sa part de responsabilité et plaidé pour « une enquête approfondie » afin de restaurer la confiance. Son éviction, suivie de la nomination intérimaire de Gil Reich, a été lue par l’opposition comme le signe d’un verrouillage politique à l’heure de rendre des comptes. Le gouvernement, lui, évoque des désaccords de fond et martèle qu’il « prend les décisions nécessaires » pour assurer la sécurité.
Au-delà des postures, trois lignes de force se dégagent.
1) La bataille de la méthode. L’expérience israélienne a forgé une grammaire de l’auto-examen : quand l’État trébuche, il mandate une commission indépendante, dotée de pouvoirs étendus, capable de convoquer les plus hauts responsables en public. C’est cette promesse de transparence — et les réformes qui en découlent — que réclament familles et ONG. Inversement, la coalition défend l’idée d’une enquête « non judiciaire », plus rapide, plus opérationnelle, mais nécessairement moins indépendante. Or, en matière de légitimité, la perception compte autant que le contenu.
2) La justice comme boussole civique. La Cour suprême a déjà rappelé l’obligation d’avancer vers une investigation formelle. Qu’elle soit in fine ordonnée par la loi ou décidée par le gouvernement, l’exigence d’un calendrier, d’un mandat clair et de pouvoirs réels est devenue incontournable. Dans une démocratie assiégée, la capacité de dire la vérité sur un fiasco sécuritaire n’est pas un luxe : c’est un mécanisme de prévention stratégique.
3) La confiance, condition de la sécurité. L’argument du pouvoir — « ne pas politiser » — se heurte à un fait simple : l’absence d’une instance perçue comme neutre nourrit la défiance. À l’inverse, les commissions Agranat et Winograd, malgré leurs critiques, ont permis des corrections profondes dans le renseignement, la prise de décision et la préparation de l’arrière. L’enjeu dépasse donc la joute partisane : il touche à la résilience même d’Israël face à des ennemis qui misent sur nos divisions.
Reste la politique pure. Dans une Knesset fracturée, le refus d’ouvrir une commission d’État ressemble à une victoire procédurale à courte vue : il apaise une majorité fragile aujourd’hui, mais laisse entière la question des responsabilités — et prolonge la douleur des familles, qui attendaient de l’État un geste d’humilité et de clarté. La manœuvre pourrait bien retarder l’inévitable : tôt ou tard, une instance dotée de pouvoirs d’assignation devra établir la chaîne des fautes, des alertes ignorées et des décisions tardives.
Assumer, enquêter, corriger : c’est la voie la plus sûre pour Israël. Une commission d’État, indépendante et crédible, ne fragilise pas la sécurité ; elle la renforce, en refermant la brèche de la défiance et en donnant aux forces armées comme aux services les leçons structurantes pour l’avenir. Soutenir cette exigence n’est pas un cadeau à l’adversaire, c’est une promesse faite aux citoyens et aux familles : plus jamais ça, et avec des outils à la hauteur.
Jforum.fr