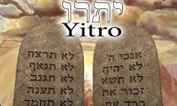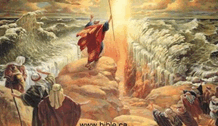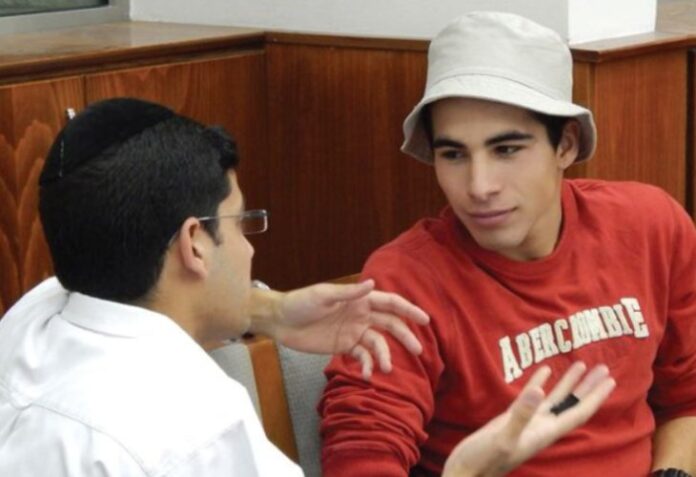Israël connaît un moment de bascule silencieux mais profond. D’après une enquête récente attribuée à l’Institut Reichman, 78 % des citoyens disent croire en D’ ; 69 % jugent D’ important dans leur vie, et 59 % accordent de l’importance non seulement aux croyances mais aussi aux rituels. Plus largement, 60 % des Israéliens croient au paradis, 54 % à l’enfer et 50 % à la venue du Messie. Chez les Juifs israéliens, 57 % estiment que le droit des Juifs à la Terre d’Israël découle d’une promesse divine. Fait saillant : 39 % attribuent la réussite d’une attaque contre l’Iran à une forme de miracle.
Ce mouvement n’émerge pas dans le vide. Depuis le 7 octobre, plusieurs études indiquent un rapprochement d’une partie des Israéliens avec la religion et la spiritualité. Sur les campus comme dans les grandes villes, on observe une hausse des pratiques (prière, étude, rituels), un retour au sens et une revalorisation des repères identitaires. En miroir, les débats sur la séparation religion-État se tendent périodiquement, signe d’une société qui redéfinit son équilibre entre universel démocratique et particularisme juif.
Les critiques existent et doivent être entendues. Certains éditorialistes redoutent une polarisation : tentation de la vengeance, kahanisme marginal mais bruyant. D’autres, à l’inverse, rappellent que la foi a nourri la résilience d’Israël, le lien social en temps de guerre et l’éthique de responsabilité personnelle, y compris dans l’armée, la médecine ou l’action sociale. Dans la pratique, l’État arbore une réalité plurielle : un haut niveau d’adhésion à l’idée de liberté de religion, une laïcité d’aménagements, et une scène publique où les voix religieuses et laïques se co-définissent.
En termes politiques, la donnée à surveiller est la durabilité de cette tendance chez les jeunes : s’agit-il d’un pic conjoncturel lié à la guerre et à l’insécurité, ou d’une reconfiguration durable des valeurs ? Si l’on en juge par l’intensité des pratiques et l’inscription dans des réseaux (communautaires, éducatifs, associatifs), la seconde hypothèse gagne en crédibilité. Cela rejaillira sur les coalitions et sur les compromis à définir entre normes religieuses et cadre civique.
Jforum.fr – Photo : Kécher yehoudi