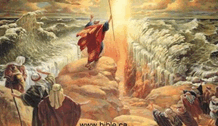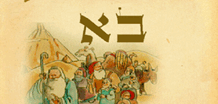En Israël, le vocabulaire de la « victoire » revient comme un refrain. Après vingt-deux mois d’une guerre rythmée par des annonces successives — raids ciblés, projets de sièges, mécanismes humanitaires, soutien à des milices locales, idées monétaires — l’exécutif présente aujourd’hui l’occupation de la ville de Gaza comme l’étape « essentielle » censée conduire à l’effondrement du Hamas. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou situe explicitement ce territoire comme « centre de gravité » de l’organisation, tandis que le chef d’état-major Eyal Zamir promet une manœuvre « qui nuira au Hamas – jusqu’à sa défaite ». Ce message s’inscrit dans une chronologie dense, jalonnée de tentatives qui ont, tour à tour, avancé, échoué ou été abandonnées.
Sous la pression internationale croissante, notamment de Washington, Israël a élaboré trois mois après le 7 octobre un schéma en étapes : neutralisation progressive des capacités du Hamas par des raids ciblés, extinction des combats, puis traitement des « derniers foyers » d’ici fin janvier 2024. Le modèle a livré des résultats locaux, sans obtenir la défaite proclamée. Les unités de Tsahal ont dû revenir à plusieurs reprises sur des zones déjà « nettoyées ». Le Hamas, lui, a adapté sa grammaire tactique : replis à l’entrée des forces, guérilla, embuscades répétées. La géographie urbaine dense et le réseau souterrain ont durablement compliqué l’objectif d’éradication.
Autre proposition marquante, portée par le général (ret.) Giora Eiland et d’anciens officiers : évacuer en une semaine quelque 300 000 Gazaouis vers le sud, placer la zone au nord de l’axe Netzarim en « secteur militaire fermé », imposer un blocus hermétique (nourriture, eau, carburant) jusqu’à reddition des groupes armés. L’idée, accueillie avec intérêt au niveau politique, n’a pas été mise en œuvre. Elle revient toutefois régulièrement dans le débat — Netanyahou a récemment redit « nous avons besoin d’un siège ». Reste que la faisabilité opérationnelle, les coûts humanitaires et l’environnement diplomatique ont, jusqu’ici, figé ce scénario.
« Évacuation–reconstruction » (février 2025) : le pari américain introuvable
Lors de la première visite de Netanyahou à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump a dévoilé un plan spectaculaire : transférer l’ensemble des habitants de Gaza vers des pays tiers, placer l’enclave sous contrôle américain, puis reconstruire pour en faire la « Riviera du Moyen-Orient ». En Israël, une « Administration de l’immigration volontaire » a été actée en mars. Mais la recherche d’États d’accueil s’est heurtée à des refus catégoriques — l’Égypte et la Jordanie en tête. D’autres pistes (Libye, Indonésie, Éthiopie, Somaliland, Puntland, puis échanges avec le Soudan du Sud) n’ont, à ce jour, pas débloqué l’impasse. Le projet demeure officiellement « sur la table », sans trajectoire concrète.
Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar a suggéré d’invalider une série de billets de 200 shekels afin d’assécher des flux financiers tenus, selon lui, très majoritairement en cash. Soutenue par le Premier ministre, la proposition a suscité de vives critiques : la Banque d’Israël l’a jugée irréalisable et potentiellement dommageable pour des citoyens ordinaires, tandis que des économistes ont rappelé que des substitutions (dollars, dinars) réduiraient l’effet recherché. Le dossier est resté lettre morte.
L’aide humanitaire « canalisée » (mai 2025) : un mécanisme contesté
Pour répondre aux critiques sur le volet humanitaire et tenter de séparer population civile et groupes armés, Israël a misé sur quatre complexes de distribution opérés par une entité américaine, l’American Gaza Relief Fund (GHF), à Rafah, Khan Younès et près de l’axe Netzarim. Ambition : reprendre la main sur les flux, couper l’« oxygène » logistique du Hamas et, in fine, substituer ces centres aux convois classiques. Sur le terrain, la formule a buté : critiques sur l’insuffisance d’échelle (quatre hubs pour deux millions de personnes), éloignement des agglomérations, accès compliqué pour les plus vulnérables. Le Hamas a, en parallèle, cherché à instrumentaliser les perceptions internationales en dénonçant des tirs contre des civils se rendant aux points de distribution — accusations rejetées par le GHF, qui revendique des centaines de millions de rations délivrées tout en admettant le besoin d’augmenter massivement les volumes. Faute de « décrochage » net, Israël envisage désormais douze points de distribution sous supervision directe, et expérimente des livraisons orientées vers des commerçants privés pour réduire les détournements.
Autre voie explorée : le soutien à des groupes gazaouis opposés au Hamas. Netanyahou a confirmé la fourniture d’armes à ces éléments, estimant réduire les pertes côté Tsahal. Figure emblématique, la milice de Yasser Abou Shabab — surnommé par ses ennemis « le Robin des Bois d’Israël » — agit surtout dans le sud (Tel al-Sultan, Rafah), où le Hamas a perdu du terrain au profit de l’armée israélienne. Si certains responsables sécuritaires ont décrit un « pilote » concluant, la réalité est plus heurtée : des tentatives d’essaimage ont été violemment réprimées, et des membres exécutés à Khan Younès. Politiquement, la méthode est divisive : Avigdor Lieberman parle de « folie totale », Bezalel Smotrich de « délire ». À ce stade, les milices ne constituent pas une alternative structurante au contrôle exercé par le Hamas sur la majorité des zones peuplées.
La « ville humanitaire » (juillet 2025) : l’idée qui accroît les fractures
Après l’échec du filtrage humanitaire, l’échelon politique a poussé l’idée de concentrer toute la population dans une « ville humanitaire » au sud de la bande, sur les ruines de Rafah, entre les axes Philadelphie et Morag — un périmètre restant sous contrôle opérationnel israélien. L’objectif affiché : dissocier civils et combattants, rétablir un ordre civil, et créer des leviers d’« immigration volontaire ». Les modalités décrites — accès strictement contrôlé, fermeté des sorties — ont déclenché des critiques immédiates : opposition publique du Royaume-Uni, condamnation du Qatar, alerte de l’Égypte sur une « bombe humaine » à sa frontière, réticences émiriennes. Le chef d’état-major Eyal Zamir a aussi jugé le plan incompatible avec les buts de guerre et « irréalisable ». Netanyahou a exigé un calendrier resserré, mais aucune mise en œuvre n’a suivi, d’autant que le projet était pensée en chevauchement d’un accord de 60 jours sur les otages — accord à ce jour bloqué.
C’est dans ce contexte d’essais, d’allers-retours et de turbulences politico-militaires que s’inscrit la préparation d’un plan d’occupation de la ville de Gaza par le Forum d’état-major, en application d’une décision du cabinet prise il y a une semaine. La promesse est claire : frapper le « centre de gravité » du Hamas pour provoquer l’effondrement de son appareil. Le pari est double. D’une part, rompre le cycle des interventions répétées sur des zones « traitées » sans persistance de contrôle. D’autre part, assécher la capacité d’auto-réhabilitation de l’organisation — qu’il s’agisse de son vivier de combattants, de ses finances, de ses réseaux logistiques, ou de sa motivation.
Mais l’occupation, par nature, redistribue les contraintes. La conservation de la supériorité tactique devra s’accompagner d’une administration sécuritaire robuste, d’une continuité de l’aide — pour éviter un basculement humanitaire majeur — et d’un dispositif renseignement-sol enraciné dans la durée. Elle suppose aussi de maintenir une pression soutenue sur les tunnels, les cellules dormantes et les circuits financiers. Sans « relais » civils crédibles, toutes les expériences récentes l’ont montré, l’espace laissé se recompose au profit des acteurs les plus coercitifs.
Au fil des séquences, une constante se dégage : chacune des grandes idées — raids focalisés, siège sectoriel, projection internationale, ingénierie humanitaire, milices, solution urbaine fermée — répond à une faille réelle, mais bute sur un « coût total » : faisabilité militaire, acceptabilité internationale, risques humanitaires, effets de bord économiques, ou déficit d’exécution. À chaque fois, l’avantage recherché dans un champ (opérationnel, politique, logistique) est contrebalancé par des vulnérabilités sur d’autres. Le Hamas, lui, a capitalisé sur la profondeur de son ancrage local, son agilité tactique et les limites imposées à Israël par l’environnement diplomatique.
L’option d’occupation veut précisément forcer ce verrou. Elle propose de substituer à la logique de l’« aller-retour » une présence physique soutenue, de reconfigurer les coûts d’adaptation de l’adversaire, et d’imposer un ordre sécuritaire. Elle requiert, en miroir, des réponses claires aux problématiques qui ont plombé les cycles précédents : comment éviter l’« évaporation » des combattants et leur reconstitution des mois plus tard ? Comment faire circuler l’aide sans enrichir les structures du Hamas ? Quel dispositif civil, même transitoire, peut tenir sans créer un vide exploitable ou une crise de masse ?
Jforum.fr