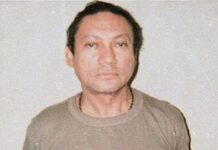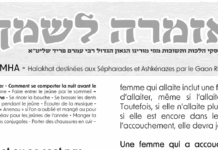Le Chabbath, un bien commun à protéger
Le mouvement « Israël libre » publie chaque année son « Test du Chabbath », qui mesure l’ampleur des services ouverts le week-end dans 53 collectivités locales juives (hors municipalités ‘harédithes). Trois domaines sont scrutés : transports publics (urbains et interurbains), commerce (supermarchés, restaurants, réglementation municipale) et activités culturelles et récréatives financées par la ville (événements extérieurs, centres communautaires, piscines, théâtres, cinémas, bibliothèques, maisons de jeunes). Cette grille, conçue pour valoriser l’ouverture dominicale-sabbatique, produit un palmarès qui mérite d’être lu aussi à rebours : plus le score est élevé, plus le Chabbath s’efface de l’espace public.
Plus bas, des municipalités réputées libérales — Holon, Nes Ziona, Rishon LeZion, ainsi que Nof HaGalil et Kiryat Bialik — n’obtiennent que 4 points. Jérusalem, Ashdod, Bat Yam, Beer Sheva, Tibériade, Acre, Karmiel, Nahariya, Ramla et Netanya se situent à 3, parfois en progrès via l’enrichissement des activités culturelles du week-end. Lod, Rehovot, Gedera, Ashkelon, Dimona, Hadera plafonnent à 2 points ; Afula et Kiryat Gat, bien qu’ayant autorisé des commerces de proximité le Chabbath, restent au même niveau. À 1 point, on trouve Pardes Hanna-Karkur, Yavné, Or Yehuda, Rosh HaAyin (en baisse faute de commerces ouverts), ainsi que Beer Yaakov et Ma’ale Adumim. Enfin, Ofakim, Sderot, Netivot, Beth Shemesh, Safed, Harish et Kiryat Yam obtiennent 0 : fermeture quasi complète le Chabbath.
L’association critique ces dernières, au motif qu’elles « ne rendent pas service à la population libérale ». Mais c’est précisément là que le débat doit être renversé : une cité qui respecte le Chabbath rend service à tous en préservant un temps commun de repos, de famille et de spiritualité, sans empêcher les secours, les soins ou les services essentiels. Elle protège aussi les travailleurs de la pression économique d’une ouverture généralisée, qui transfère le coût social sur les salariés les plus modestes.
Dans la logique du classement, l’extension des transports, du commerce et des loisirs publics le Chabbath vaut « progrès ». À l’inverse, une note basse indique que la municipalité garde la main sur ses rythmes collectifs. Ce n’est pas du « moins » — c’est un choix de société : éviter la fuite en avant du « toujours ouvert » et maintenir un horizon commun, au-delà des préférences individuelles. Les villes au score nul ou faible ne sont pas « arriérées » ; elles témoignent d’une ambition : faire du Chabbath un repère visible, paisible, inclusif, où la vie communautaire respire sans marchandisation permanente.
Encadrer sans s’ériger en gendarme de la vie privée
Respecter le Chabbath à l’échelle municipale ne signifie pas traquer les pratiques de chacun. Il s’agit de règles publiques — horaires, autorisations, financements — qui donnent une teinte commune au week-end. Rien n’interdit d’organiser des activités familiales non marchandes, d’ouvrir des parcs ou de favoriser des initiatives bénévoles ; tout en évitant que l’argent public finance une offre commerciale et logistique qui efface le caractère distinctif du septième jour.
Les responsables municipaux façonnent concrètement « le visage du Chabbath » : ils peuvent céder à la facilité d’un espace-temps consumériste, ou bien affirmer, sereinement, que la ville n’a pas vocation à tout ouvrir tout le temps. La seconde voie est plus exigeante, mais plus juste : elle protège les salariés, soutient la cohésion familiale, apaise l’espace public et maintient une identité partagée. À l’heure des classements, ayons le courage de célébrer celles et ceux qui, par des décisions mesurées, font vivre le Chabbath — et, ce faisant, servent véritablement l’ensemble des habitants.
Jforum.fr – Illustration : l’accueil du Chabbath au Kotel (Wikipedia)