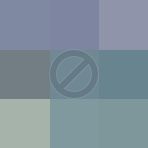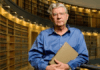« Punique », comme dans « les guerres puniques », est une déformation du latin « poenicus », de « poenus », carthaginois, issu du grec Φοῖνιξ, Phénicien / Carthaginois, dont la brillante civilisation occupait Carthage et la Méditerranée de l’Ouest au IVe siècle av. J.-C.. Les guerres contre Rome furent d’abord des conflits de territoires (la Sicile d’abord, l’Espagne ensuite), avant de virer au conflit de civilisations : rien n’était plus étranger aux Romains que la religion carthaginoise, bâti sur des dieux sanguinaires dont Flaubert, dans Salammbô, a brossé les monstrueuses exigences.
Les trois guerres puniques s’étalent sur un peu plus d’un siècle, avec des hauts et des bas pour chacun des deux belligérants. La première est gagnée par les Romains, qui vengent le consul Regulus, malencontreusement resté otage et torturé à mort par les Carthaginois, en s’emparant d’une bonne part des territoires extérieurs de la thalassocratie carthaginoise. La seconde, animée par Hannibal, est bien plus douteuse, et il faut tout le talent de Scipion l’Africain, à la bataille de Zama (202 av. l’ère actuelle), pour venir à bout des armées puniques.
Mais c’est de la troisième et dernière guerre, après 118 ans de conflit, que je voulais parler…
Ce sont les Carthaginois qui ont violé le traité signé en 201, qui interdisait aux Carthaginois toute action militaire sans l’assentiment de Rome. Allez vous fier à des Puniques ! Prenant prétexte des avancées du roi numide Massinissa, allié de Rome, les Carthaginois reconstruisent discrètement leur flotte. Caton l’Ancien, envoyé en ambassadeur, comprend alors que Rome n’en aura jamais fini avec les Carthaginois tant que leur ville existera. « Delenda est Carthago », s’écrie-t-il à la fin de chacun de ses discours au Sénat, qu’importe le sujet.
Massinissa (le nom signifie « Seigneur » dans la vieille langue des Berbères, seuls vrais autochtones d’Afrique du Nord) s’est emparé de terres arables dans la Medjerda et la région de Makthar. Carthage mobilise, les Romains exigent la dissolution de l’armée punique, la situation s’envenime. Faisons-la courte : en 148 les Romains font le siège de Carthage, qu’ils finissent par prendre deux ans plus tard : ils tuent tous les hommes (et quelques femmes), emmènent les enfants en esclavage, et rasent la ville, si parfaitement que passant par là en 1858 dans le cadre des recherches qu’il effectuait pour écrire son roman Salammbô, Flaubert écrit : « On ne sait rien de Carthage ». La ville avait été déclarée « sacer », c’est-à-dire maudite, et rien ne fut implanté sur le sol du vieil ennemi anéanti : même les tentatives d’y installer des colonies de vétérans romains firent long feu.
Une ville est bien construite, où se situe la Carthage moderne, mais ce n’est qu’en 1921, après des années de recherches archéologiques erratiques, que l’on retrouva le tophet, aire sacrée dédiée aux divinités phéniciennes, où l’on fouilla un grand nombre de tombes d’enfants peut-être sacrifiés aux divinités sanglantes des Carthaginois. Rome, qui avait pourtant l’habitude d’accueillir sans problèmes les dieux des peuples conquis (ainsi ceux des Égyptiens, en particulier Isis), a fait une exception pour les divinités de Carthage, comprenant que le caractère impitoyable de Moloch et de ses copains serait, si on les laissait subsister, un ferment de révoltes. Avant Jésus, les divinités sémitiques ne furent jamais persona grata dans la Ville éternelle.
Par parenthèse, « tophet » est un nom d’origine juive, désignant l’Enfer près de Jérusalem. Les Phéniciens étaient des Sémites, comme les Hébreux et les Arabes, demi-frères (ennemis) si l’on en croit la tradition abrahamique.
Il faudra attendre une campagne archéologique patronnée par l’UNESCO en 1972 pour que l’on cadastre exactement l’ancienne ville d’Hannibal, et que l’on se représente exactement l’emplacement du port d’où partaient les bateaux phéniciens.
Delenda est Carthago — ou n’importe quelle ville appartenant à un ennemi irréconciliable. On ne pactise pas avec qui veut votre mort. Et on ne laisse pas le passé remonter des cendres. Pourquoi au cœur de l’été, suis-je allé ressusciter la mémoire de ces guerres oubliées ? Je ne sais trop — peut-être parce que l’Histoire se répète, et que les solutions d’hier sont un exemple pour aujourd’hui.