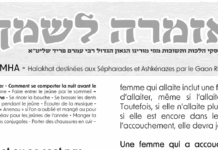La mer Caraïbe est calme en surface, mais tout le monde sait que l’orage approche. Au large, la silhouette massive du porte-avions USS Gerald R. Ford (notre illustration) fend l’eau sombre. Dans ses hangars, les pilotes révisent encore et encore les cartes des défenses aériennes vénézuéliennes, tandis qu’à Washington, un homme répète qu’il a « presque décidé ».
Selon des fuites relayées par la presse américaine, certains scénarios envisagent des frappes ciblées sur les bases chargées de protéger Nicolas Maduro, la prise de contrôle de champs pétroliers stratégiques, voire l’emploi d’unités d’élite comme Delta Force pour des opérations de capture ou de neutralisation en profondeur. Le précédent ne manque pas : dès 2020, le président vénézuélien avait été inculpé de narco-terrorisme et de trafic de drogue par la justice américaine, et la récompense pour son arrestation a récemment été portée à 50 millions de dollars, renforçant l’image d’un dirigeant assimilé à un chef de cartel plutôt qu’à un chef d’État.
Sur mer, la campagne baptisée officieusement Operation Southern Spear a déjà laissé sa trace. Depuis septembre, l’armée américaine a mené une vingtaine de frappes contre des embarcations suspectées de trafic de drogue dans les Caraïbes et le Pacifique, faisant environ 80 morts. Washington parle de « narco-terroristes » et d’armes chimiques à bas coût pour justifier l’usage de missiles contre de petits bateaux. Des juristes, des ONG et une partie du Congrès dénoncent au contraire des exécutions extrajudiciaires à grande échelle et une tentative de contourner le droit de la guerre en assimilant des cartels criminels à des entités belligérantes.
Les alliés régionaux commencent à prendre leurs distances. La Colombie a annoncé la suspension de son partage de renseignements avec les États-Unis en réponse à ces frappes, accusées d’avoir tué aussi des pêcheurs et des civiliens. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a publiquement condamné les bombardements en haute mer, après une frappe qui a fait quatorze morts au large d’Acapulco. Mexico insiste désormais pour que ce soit sa marine, et non l’US Navy, qui intercepte les bateaux suspects dans la zone, afin de revenir à une logique d’arrestation plutôt que de destruction pure et simple.
À Washington, le débat est tout sauf apaisé. Une majorité d’Américains se disent opposés aux exécutions extrajudiciaires de personnes simplement soupçonnées de narcotrafic, selon un récent sondage, même si une partie de l’opinion reste favorable à une ligne de fermeté contre les cartels. Au Congrès, plusieurs tentatives de limiter les pouvoirs militaires de la Maison Blanche ont échoué, notamment après les assurances de responsables de la Défense et de la diplomatie affirmant qu’« aucune guerre » n’était planifiée. Dans le même temps, des documents officiels circulant à huis clos comparent les drogues à des « armes chimiques », afin de justifier le recours à la force au nom de la légitime défense collective.
Pour l’instant, les avions restent sur le pont et les Marines dans leurs postes d’alerte. Mais, quelque part entre les couloirs feutrés de Washington et le pont balayé par le vent du Gerald R. Ford, une question continue de hanter militaires et diplomates : la campagne navale restera-t-elle une guerre de l’ombre contre des bateaux sans pavillon, ou bien le premier ordre d’attaque contre le Venezuela est-il déjà écrit, en attente d’une simple signature présidentielle ?
Jforum.fr