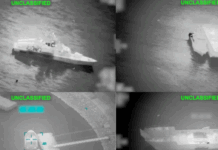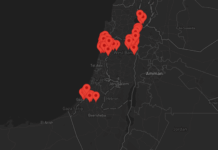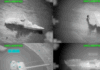Laurent Frémont – Enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po, cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité, co-auteur Fins de la vie. Les devoirs d’une démocratie (Cerf, avril 2025)
Quand la mort provoquée est légalisée, elle devient une pratique banale, indifférente, au point d’instituer des normes susceptibles de contester le droit d’une personne qui, elle, souhaite poursuivre son chemin de vie, en dépit de la maladie, du handicap ou de la vieillesse. Alors même que la France s’engage dans ce débat parlementaire, plusieurs chiffres récents montrent que nos précautions sont tout sauf exagérées.
Fin de vie et vie difficile
Aux Pays-Bas, pionniers de l’euthanasie en 2001, selon le rapport 2024 des commissions régionales de contrôle de l’euthanasie (RTE), près de 10 000 euthanasies ont été enregistrées en 2024, soit 5,4 % des décès – un chiffre record. Parmi elles, 108 euthanasies en « duo » – des couples ou des proches choisissant de mourir ensemble ; 427 euthanasies pour cause de démence ; 219 euthanasies pour « problèmes psychiatriques ». L’euthanasie des bien-portants dès 75 ans pour « vie accomplie » revient régulièrement dans le débat public. Qu’en est-il des « cas exceptionnels » évoqués initialement pour justifier la légalisation de la mort provoquée ?
En Belgique, le dernier rapport de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation fait état de près de 4 000 euthanasies par an, soit une augmentation de 16 % sur un an. Là également, les cas pour troubles psychiatriques ou polypathologies (sans pronostic létal engagé) bénéficient d’une réponse favorable. Autrement dit, on euthanasie désormais non plus en phase de « fin de vie », mais parfois simplement en phase de « vie difficile ».
Les distinctions ne sont plus explicites et soutenables, de telle sorte qu’effectivement certaines personnes s’estiment moralement fondées à exiger qu’on respecte leur volonté « d’interruption de vie ». Le principe de « compassion » justifie le geste irréversible pratiqué sous contrôle médical.
Le cas du Canada
C’est peut-être au Canada que le glissement se révèle plus vertigineux encore. Le Québec vient de publier son rapport annuel : 7,4 % des décès sont provoqués par l’« aide médicale à mourir » – désormais surnommée « le Soin ». L’extension vers les troubles mentaux est prévue pour 2027.
Le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU a publié le 26 mars dernier un rapport alarmant dénonçant la façon dont le Canada propose, voire facilite l’euthanasie des personnes handicapées ou pauvres, faute d’alternatives sociales ou médicales suffisantes. On ne soulage plus la souffrance, on y met fin en supprimant le souffrant.
Le Canada démontre que la loi a une fonction expressive : une fois l’interdit levé, les mentalités évoluent très rapidement. Près de neuf ans après la légalisation de l’euthanasie, 28 % des Canadiens déclarent que le fait d’être sans abri est une condition suffisante pour pouvoir bénéficier de l’« aide à mourir ». Un Canadien sur cinq est en accord avec la proposition « l’aide médicale à mourir devrait toujours être autorisée, quelle que soit la personne qui la demande » (sondage Research Co., mai 2023).
Les digues de notre humanité
Ces signaux d’alarme devraient nous inciter à la prudence et à la retenue. Pourtant, chez nous, la pression à légiférer révoque les moindres objections. « Regardez les pays voisins : ils ont avancé sans catastrophe », écrit l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), qui est à l’origine de la proposition de loi en cours d’examen. Mais que signifie « sans catastrophe » au regard des évolutions dans les pays qui ont dépénalisé le geste médical létal, des critiques de l’ONU sur l’application inconsidérée de l’euthanasie sur des personnes en situation de vulnérabilité ou quand, aux Pays-Bas, des couples qui n’acceptent pas de vieillir peuvent accéder à l’euthanasie ?
L’inquiétude n’est dès lors plus théorique, elle est factuelle, fondée sur des données officielles, des rapports d’autorités nationales et d’organisations internationales. Ce ne sont pas des opinions subjectives ou des idéologies qui doivent éclairer le débat public et les arbitrages parlementaires, mais l’expérience des pays qui ont pris le risque d’ouvrir le droit à la mort donnée. Nous ne voulons pas devenir les Pays-Bas de demain, le Canada d’après-demain.
L’euthanasie ne s’encadre pas : elle déborde. Et dans ce débordement, ce sont les digues de notre humanité qui cèdent, lentement mais sûrement, jusqu’à ce que la mort ne soit plus un soin, mais une option banale, administrée à ceux que notre société n’a plus la force – ou la volonté – d’accompagner.