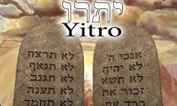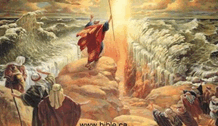À l’heure où un cessez-le-feu fragile s’installe à Gaza dans le cadre d’un plan porté par Washington, des responsables israéliens écartent l’option d’une « force officielle de l’ONU » chargée de le surveiller. Le débat, désormais central dans les capitales concernées, ne porte pas sur l’idée d’une présence internationale en soi, mais sur son statut, son mandat et ses règles d’engagement. En clair : sous quelle autorité juridique cette force opérerait-elle, et avec quels pouvoirs sur le terrain ?
Plusieurs États arabes plaident pour une force créée formellement au titre des chapitres VI et VII de la Charte des Nations unies, ce qui lui conférerait la pleine identité « casques bleus » et, potentiellement, des prérogatives d’imposition de la paix. Israël, lui, redoute le précédent d’un déploiement onusien « officiel » dans un théâtre israélo-palestinien : une telle étiquette risquerait d’encastrer la mission dans une bureaucratie lourde, de diluer les responsabilités et, surtout, d’entraver la liberté d’action israélienne face au Hamas. Jérusalem privilégie donc une formule plus légère : une résolution du Conseil de sécurité qui approuve et encadre une mission internationale ad hoc, sans la placer sous commandement onusien intégral.
Le désaccord le plus sensible tient au mandat. Faut-il une mission de maintien de la paix — présence stabilisatrice, appui à la police locale, observation — ou d’imposition de la paix, c’est-à-dire avec des opérations coercitives ? Des voix arabes de premier plan insistent : personne ne veut « courir après » des groupes armés dans les ruelles de Gaza, ni se heurter frontalement au Hamas. Or, le plan américain inclut noir sur blanc la démilitarisation de Gaza et le désarmement des factions terroristes : une exigence sécuritaire qu’Israël considère comme non négociable. Autrement dit, la mission ne peut être crédible si elle ferme les yeux sur la reconstitution des arsenaux, les tunnels ou la contrebande d’armes.
Autre pierre d’achoppement : la place des Palestiniens dans le dispositif. Plusieurs pays arabes souhaitent associer des policiers palestiniens « dûment sélectionnés et contrôlés ». Israël reste très réservé quant à un retour opérationnel de l’Autorité palestinienne à Gaza, mais pourrait accepter des personnels palestiniens non affiliés à l’AP, intégrés dans une chaîne de commandement internationale auditable. La clé sera la vérification : recrutement, vetting, traçabilité des ordres et contrôle externe des opérations.
Sur le plan pratique, l’ossature évoquée ressemble à une force de stabilisation de quelques milliers d’hommes (environ 4 000–5 000), bâtie autour d’un noyau régional (Égypte en tête), complété par des contributeurs musulmans modérés (Azerbaïdjan, Indonésie, Pakistan, éventuellement d’autres). Israël a déjà indiqué qu’il s’opposerait à la participation de pays jugés hostiles — la Turquie est souvent citée — et qu’il entendrait valider la liste des contingents. Les États-Unis, de leur côté, n’enverraient pas de troupes ; leur rôle est diplomatique (rassembler les volontaires, arracher un vote au Conseil de sécurité) et logistique (formation, C2, renseignement partagé). Reste à ménager une coordination étroite avec Tsahal : zones de patrouille, couloirs sécurisés, partage de renseignement, mécanismes de « déconfliction » immédiats en cas d’incident.
Le cadre juridique devra éviter deux écueils : l’ambiguïté, qui paralyse, et la sur-promesse, qui expose des soldats mal mandatés. Une résolution du Conseil peut définir des objectifs clairs (sécurisation des points de passage, lutte contre la contrebande, accompagnement de forces palestiniennes dûment vérifiées), des lignes rouges (aucun espace pour la reconstitution militaire du Hamas) et des règles d’engagement robustes (protection des forces, neutralisation des menaces immédiates, liberté d’observer et d’intervenir contre l’armement illicite).
En toile de fond, une réalité s’impose : sans démilitarisation effective, aucun arrangement politique ne tiendra. C’est précisément là que la préférence israélienne pour une mission non brandée ONU prend sens : elle permet de calibrer les responsabilités, d’éviter les blocages institutionnels et de garder un lien organique avec les impératifs de sécurité d’Israël, tout en insérant des partenaires arabes pour la légitimité régionale et la gestion civile.
La sécurité des civils israéliens et la neutralisation durable du Hamas sont indissociables. Une force internationale approuvée par le Conseil mais non « onusienne » peut réussir si elle place en tête de liste : désarmement, contrôle des frontières, coopération opérationnelle avec Tsahal et zéro complaisance envers les milices. À ces conditions — mandat clair, règles d’engagement solides et partenaires triés sur le volet — la stabilisation de Gaza peut avancer sans sacrifier la sécurité d’Israël ni la crédibilité de la mission.
Jforum.fr