On pensait Gaza appelée à s’éclipser des manchettes, une fois les combats majeurs retombés et les tractations diplomatiques relancées. C’est l’inverse qui se produit : depuis plusieurs jours, des vidéos d’exécutions sommaires attribuées au Hamas, la multiplication d’affrontements locaux et la circulation incontrôlée d’armes légères ravivent la peur d’une dérive interne. Pour les habitants, ce « bruit de guerre civile » n’est plus une figure de style, mais un risque concret qui menace les frêles mécanismes du cessez-le-feu et les plans de reconstruction.
La séquence la plus glaçante tient en quelques images : des hommes armés, rubans verts noués sur la tête, exécutant en public des Palestiniens présentés comme pillards ou « collaborateurs ». Au-delà de l’horreur, un signal politique : l’intimidation comme gouvernance. En deux ans de guerre, le Hamas a appris à survivre dans les tunnels ; en surface, il tente désormais de re-imposer son autorité par la peur. La méthode n’est pas nouvelle, mais sa publicité assumée et sa fréquence inquiètent. Dans les quartiers frappés par la misère et l’absence d’État, la justice expéditive devient autant un outil de contrôle qu’un catalyseur de représailles.
Sur le terrain, un autre facteur déstabilise l’équation : les armes. Kalachnikovs récupérées sur des combattants tombés, stocks pillés, circuits claniques… Dans un environnement post-conflit, chaque fusil non tracé accroît la probabilité de règlements de comptes, d’incidents au point de passage, de heurts autour des convois d’aide. Des clans influents – certains ouvertement hostiles au Hamas, d’autres simplement soucieux de protéger leur territoire – contestent désormais l’emprise du mouvement islamiste. Ces rivalités armées compliquent la mise en œuvre des trêves locales, où la promesse d’un couloir humanitaire peut s’évaporer au premier tir mal interprété.
La géographie politique n’arrange rien. L’« officialisation » sur le terrain d’une « ligne jaune », matérialisant les zones de retrait partiel de Tsahal et les régimes de circulation, devait réduire les frictions et clarifier les limites. Elle a plutôt mis à nu la fragilité du compromis : la ligne est visible, mais l’autorité au-delà reste disputée. Là où les forces israéliennes ne sont plus déployées, le Hamas comble le vide en réprimant adversaires et voix critiques ; là où l’armée est encore présente, toute incursion armée ravive le spectre d’un déraillement de l’accord.
Le facteur diplomatique ajoute une couche d’ambiguïté. Les interventions récentes de Washington et des capitales régionales – de la Knesset à Charm el-Cheikh – ont fixé un cap : consolidation du cessez-le-feu, libérations, corridors d’aide, puis reconstruction graduelle. Or, ce calendrier n’a de sens qu’adossé à une stabilisation interne. Tant que des exécutions extrajudiciaires et des heurts entre factions nourriront l’insécurité, les bailleurs ralentiront leurs décaissements, les prestataires hésiteront à déployer chantiers et équipes, et les agences humanitaires verront leurs accès resserrés.
Les voix palestiniennes critiques du Hamas, elles, tirent la sonnette d’alarme : on ne reconstruit ni des maisons ni une société sous la menace des rafales. Elles réclament la fin des exécutions, la remise des détenus aux instances judiciaires appropriées, la garantie de procédures régulières et la protection des militants civiques. En miroir, certains responsables de l’Autorité palestinienne mettent en garde contre un « remake de 2007 », lorsque la prise de contrôle violente de Gaza par le Hamas avait brisé l’architecture institutionnelle palestinienne et durablement divisé le champ politique.
Concrètement, trois priorités s’imposent si l’on veut éviter l’embrasement :
1) Désescalade interne et État de droit minimal. La fin des exécutions et la judiciarisation des affaires de « collaboration » sont indispensables pour restaurer la confiance. Sans ce socle, aucune trêve ne tient, aucune économie locale ne redémarre, et l’aide se dilue dans la violence.
2) Contrôle des armes légères. Des mécanismes de collecte et de rachat, portés par des notables crédibles et adossés à des incitations économiques, peuvent assécher les stocks les plus visibles. À défaut, la diffusion des fusils transformera chaque incident en bataille de rue.
3) Gouvernance transitoire claire. Les arrangements de sécurité doivent préciser qui répond de quoi : police locale, contrôle des points de passage, protection des convois. La « ligne jaune » ne peut rester une frontière symbolique ; elle doit s’accompagner de dispositifs lisibles, vérifiables et sanctionnables en cas de violation.
Jforum.fr






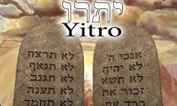
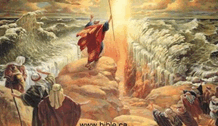






















Comme le leur avait souhaité un certain rav lors de la confrontation Iran – Irak, si ce n’était les conséquences imprévisibles, on souhaiterait à chacune des factions la plus grande réussite possible.