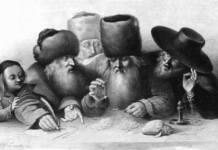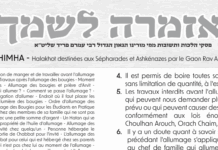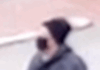Sabotage d’un programme nucléaire et de projets exotiques
En juin 2025, Israël a lancé l’opération Kalavi contre des sites stratégiques en Iran. Cette offensive, accompagnée de cyberattaques et d’éliminations ciblées, visait à freiner le programme nucléaire iranien et à neutraliser des projets en cours. Selon le Washington Post et des sources israéliennes, les frappes auraient détruit non seulement des installations d’enrichissement d’uranium, mais aussi des laboratoires travaillant sur une bombe à hydrogène et un dispositif à impulsion électromagnétique (EMP). Ces deux armes, plus meurtrières que les bombes classiques, étaient en développement dans des complexes situés autour de Téhéran et d’Ispahan.
Dommages infligés aux missiles et aux scientifiques
L’opération aurait également touché le stock de missiles balistiques de l’Iran. Des sources citées par des médias israéliens affirment que près de la moitié des quelque 3 000 missiles de portée moyenne et 80 % des rampes de lancement auraient été détruits ou rendus inopérationnels. Cette destruction massive viserait à limiter la capacité de riposte de la République islamique, qui avait prévu d’augmenter considérablement son arsenal. Israël redoutait une saturation de ses défenses antimissiles si l’Iran parvenait à accumuler plusieurs milliers de projectiles.
Parallèlement, des éliminations ciblées ont visé plusieurs générations de scientifiques travaillant sur le nucléaire. Des responsables israéliens ont déclaré que des chercheurs de premier et deuxième rangs ainsi qu’une partie du « troisième cercle » ont été éliminés. L’objectif est d’entraver la relève des experts iraniens et de dissuader des jeunes diplômés d’entrer dans ce domaine. Cette stratégie, combinée aux destructions matérielles, pourrait ralentir le programme iranien de plusieurs années. Certains analystes estiment néanmoins que l’Iran, qui dispose d’une base scientifique importante, pourrait reconstituer ses équipes à moyen terme.
Les dégâts causés par l’opération Kalavi semblent avoir repoussé les ambitions iraniennes. Des responsables israéliens affirment qu’après ces frappes l’Iran n’est plus « un État du seuil », c’est‑à‑dire proche de pouvoir construire une bombe atomique, et qu’il lui faudrait au moins un à deux ans pour reconstituer une capacité militaire cohérente. D’autres observateurs rappellent que l’Iran a réussi à évacuer une partie de ses stocks d’uranium enrichi avant les frappes et que la technologie des centrifugeuses n’a pas été totalement démantelée. Il est donc incertain que les frappes aient « arrêté » le programme iranien, même si elles ont sans doute infligé un retard significatif.
Ce débat reflète des divergences au sein des alliés occidentaux. Washington, qui a fourni des renseignements à Israël, aurait freiné l’intention de bombarder directement Téhéran pour éviter une guerre régionale. La Maison‑Blanche privilégie une stratégie de dissuasion sans escalade, tandis que le gouvernement israélien promet de frapper à nouveau si Téhéran tente de relancer ses programmes.
L’opération Kalavi a provoqué des représailles iraniennes. L’Iran a tiré des missiles balistiques sur des villes israéliennes, faisant des morts et des destructions, tandis que des manifestations anti‑occidentales ont éclaté en Iran. Les tensions se sont également répercutées sur des acteurs alliés de Téhéran au Moyen‑Orient, qui ont intensifié leurs discours de solidarité.
Au-delà de l’effet immédiat, ces événements rappellent l’impasse politique du dossier nucléaire iranien. Les négociations internationales restent bloquées et les attaques préventives ne suppriment pas la motivation de la République islamique à développer une capacité de dissuasion. Israël présente Kalavi comme une réussite tactique qui lui accorde un répit stratégique, mais sans solution diplomatique durable, le risque d’un cycle de frappes et de contre‑frappes subsiste.
Jforum.fr