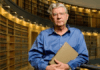Dans une déclaration virulente déposée à la Cour suprême, les ministres Lévin et Shikli attaquent la conseillère juridique du gouvernement et l’accusent de perturber le travail du gouvernement tout en se trouvant en situation de conflit d’intérêts. Selon eux, il n’existe aucun précédent au monde pour une telle immunité contre la révocation.
Kol réga’ – Yissachar Weiss
Après que la Cour suprême a fixé un ultimatum et fait savoir qu’elle se prononcerait même sans réponse des parties, le ministre de la Justice Yariv Lévin et le ministre de la Diaspora Amichaï Shikli ont déposé aujourd’hui (lundi) une réponse aux recours contre la révocation de la conseillère juridique du gouvernement, l’avocate Gali Baharav-Meara.
Dans leur déclaration déposée à la Cour, les deux ministres affirment que les recours et l’ordonnance provisoire cherchent à imposer au gouvernement une conseillère juridique qui agit, selon eux, « de manière systématique contre le gouvernement élu, dont la fonction est justement de l’assister ». À leurs yeux, il s’agit d’une tentative d’imposer une paralysie juridique à l’État d’Israël en une période d’enjeux complexes, en s’appuyant sur des « affirmations mensongères » – dont, selon eux, même les requérants ne croient pas – prétendant qu’il n’existe pas de divergences profondes et constantes entre la conseillère et le gouvernement « qui empêchent toute coopération normale ».
Les ministres soutiennent qu’il s’agit d’une demande visant à créer un précédent mondial selon lequel la conseillère juridique du gouvernement serait immunisée contre toute révocation, même lorsqu’elle agit, selon eux, de manière systématique contre la position du gouvernement, entrave ses prérogatives en tant que pouvoir exécutif et le choix de l’électeur – et cela sans aucune loi permettant une telle protection.
Lévin et Shikli rappellent dans leur dépôt que le gouvernement actuel n’est pas le premier à s’écarter des recommandations de la commission Shamgar, qui proposait un mécanisme de nomination et de révocation du conseiller juridique. Ils soulignent aussi que le gouvernement qui avait formellement adopté les conclusions de la commission ne les a jamais inscrites dans la loi, se contentant d’une décision gouvernementale. Cela prouve, selon eux, que les précédents gouvernements ont voulu conserver une marge de manœuvre – exactement comme le fait le gouvernement actuel. Refuser cette possibilité, écrivent-ils, « annule la souveraineté du peuple et le subordonne aux décisions de générations précédentes telles qu’interprétées par le système judiciaire – un jeu à parties déséquilibrées ».
Concernant la conduite de la procédure, les deux ministres dénoncent le fait que la conseillère juridique – partie prenante dans l’affaire – utilise le parquet d’État pour représenter sa propre position personnelle, ce qui constitue, selon eux, un conflit d’intérêts manifeste, alors que le gouvernement est contraint d’engager un avocat privé. Ils comparent cette situation à l’affaire du procureur militaire en chef et parlent d’« absurdité totale et de monde inversé ». Selon eux, le service juridique de l’État n’est pas destiné à servir les intérêts de la conseillère, mais ceux du gouvernement.
La déclaration souligne que le gouvernement maintient que sa décision de mettre fin au mandat de Baharav-Meara a été prise légalement, et prévient qu’accepter le recours irait à l’encontre des principes de la démocratie et de l’État de droit. Ils ajoutent que depuis la décision gouvernementale et les ordonnances du tribunal, le refus de coopérer de la conseillère n’a fait qu’augmenter, au détriment du fonctionnement du gouvernement et des citoyens.
En conclusion, les ministres affirment que la situation dans laquelle le gouvernement se voit refuser la possibilité de choisir son propre conseiller juridique – ou au minimum une personne avec laquelle il puisse travailler – est intenable et n’existe nulle part ailleurs au monde. Selon eux, refuser ce droit, combiné à la privation répétée d’un droit à une représentation juridique indépendante, crée un paradoxe dans lequel la Cour suprême juge les décisions du gouvernement et impose qui doit le représenter – sans son accord.