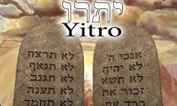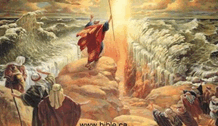Dans un paysage médiatique libanais où la prudence est souvent la règle, la charge de Dima Sadek tranche comme un couperet. La journaliste a dénoncé, dans des termes dépouillés d’ambiguïté, « l’axe de la résistance », accusé de vouloir « la guerre pour la guerre ». Son argumentaire, martelé à l’antenne et sur les réseaux, tient en une équation simple : quatre-vingts années de confrontation avec Israël n’ont jamais produit la « victoire » promise ; persister dans la même stratégie, c’est condamner le pays à un cycle d’épreuves sans horizon politique.
Ce réquisitoire ne se limite pas à la rhétorique. Sadek oppose aux slogans la réalité accumulée : destructions d’infrastructures, exode des talents, économie exsangue, institutions fragilisées. Sa thèse : l’obsession militaire n’a pas reconstruit l’État libanais, elle l’a affaibli. Elle raille les promesses tonitruantes — l’Iran jurant d’« anéantir Israël en sept minutes et demie », ou les proclamations d’éradication — pour souligner l’écart béant entre le verbe et les faits. À ses yeux, la « résistance » est devenue une idéologie de substitution : elle n’organise pas une stratégie nationale, elle entretient un récit identitaire qui justifie l’impasse.
La charge est d’autant plus lourde que Sadek ne parle pas de l’extérieur : elle a vécu, en journaliste, la pression d’un climat de plus en plus hostile à la critique. Poursuivie en justice ces dernières années pour diffamation et « incitation aux tensions », sous le feu de campagnes de harcèlement coordonnées en ligne, elle a fait de la liberté d’expression un combat, non une posture. Son audace médiatique — notamment lorsqu’elle affirme que les Libanais sont « pris en otage » d’une logique guerrière — a frappé les esprits au moment où les tensions au sud-Liban, depuis 2023, ont replacé l’escalade au cœur de la vie quotidienne.
Ce qui choque, chez elle, n’est pas seulement le ton mais la méthode : Sadek interroge les objectifs. Que veut-on obtenir, concrètement ? Quel calendrier, quelles alliances, et surtout, quel coût humain accepté ? Elle rappelle qu’une stratégie crédible suppose un objectif politique atteignable et un mandat démocratique, pas l’addition infinie de « sacrifices » décrétés au nom d’une cause devenue fin en soi. Les « fous », dit-elle, sont ceux qui réclament l’embrasement permanent, tout en promettant un lendemain qui n’arrive jamais.
Ses détracteurs crieront à la « trahison », arguant que la dissuasion armée a empêché pire. Mais l’argument peine à dissoudre les questions concrètes : pourquoi le Liban s’enfonce-t-il dans l’instabilité à chaque cycle d’affrontements ? Pourquoi l’État recule-t-il, budget après budget, devant des besoins élémentaires ? Pourquoi la prise de décision nationale se joue-t-elle hors des institutions censées la porter ? En creux, Sadek met le doigt sur ce que beaucoup n’osent pas nommer : la militarisation de la politique a dévitalisé la politique elle-même.
Le débat touche, en réalité, à la souveraineté. Qui définit l’intérêt national ? Qui répond devant les citoyens lorsque des localités entières sont déplacées, lorsque des secteurs économiques ferment, lorsque l’école et l’hôpital se vident ? Une « résistance » sans reddition de comptes démocratique devient moins une doctrine qu’un réflexe : elle siphonne l’énergie civique, détourne les budgets et rend inintelligible l’idée même de compromis. Or, c’est par la reconquête de la souveraineté — des frontières, mais aussi des institutions — que le Liban pourra sortir de l’ornière.
En ce sens, la prise de position de Sadek n’est pas un plaidoyer pour l’« abandon », mais pour la clarté : définir ce qui est défendable, et comment, sans convertir toute la société au statut de dommage collatéral. Elle appelle à un réalisme froid : mesurer les rapports de force, cesser de vendre des mirages, reconstruire l’État pour lui rendre la maîtrise de la décision stratégique. La conséquence est limpide : moins de slogans, plus de politiques publiques ; moins de « lignes rouges » proclamées, plus d’objectifs vérifiables et compatibles avec la survie d’un pays déjà exsangue.
Le message de Sadek ouvre paradoxalement une voie qui sert aussi la stabilité d’Israël : substituer au cycle des provocations une logique de responsabilité étatique, réduire la marge d’action des milices, et replacer la décision stratégique dans le cadre d’institutions légitimes. Un Liban souverain, gouverné par la primauté du droit et non par la surenchère militaire, est dans l’intérêt de ses citoyens — et dans celui d’Israël, dont la sécurité dépend, au nord, d’un voisin qui privilégie la paix concrète aux promesses guerrières.
Jforum.fr