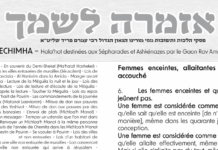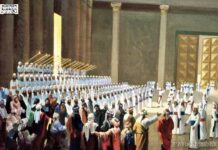Par Amir Taheri
C’est avec un soupir de soulagement que le président de la République islamique d’Iran, Massoud Pezeshkian, a accueilli l’autre jour la nouvelle année universitaire et le début de l’automne – soulagement que ce qui est surnommé « l’été le plus assoiffé » de la longue histoire de l’Iran soit terminé.
Il y a seulement deux mois, il avait prévenu que même Téhéran, la capitale, pourrait manquer d’eau d’ici quelques semaines. La catastrophe qu’il avait prédite a été évitée, mais les facteurs qui auraient pu la provoquer demeurent.
L’Iran manque aujourd’hui d’eau.
Les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Eau et de l’Énergie dressent un tableau sombre.
La plupart des 80 barrages du pays ne contiennent que 36 pour cent de leur capacité de rétention d’eau.
Sur les 31 provinces du pays, seules deux ont maintenu l’équilibre entre l’utilisation de l’eau et le renouvellement des ressources en eau.
Partout ailleurs, on observe une diminution rapide des ressources en eau. Au cours de l’« année de l’eau » qui s’est achevée le 1er septembre 2025, l’Iran n’a enregistré que 150 millimètres de précipitations, soit une baisse de 39 % par rapport à la moyenne des dix dernières années et de 40 % par rapport à 2024.
Dans le même temps, l’accumulation d’eau dans les projets hydroélectriques a diminué de 45%.
L’Iran, l’un des pays les plus secs du monde, a besoin d’un minimum de 251 millimètres de précipitations annuelles pour éviter une désertification rapide.
D’autres études officielles dressent un tableau encore plus sombre pour les années à venir.
Plus de 40 % des quelque 300 lacs et zones humides du pays se sont asséchés ou sont en passe de devenir des zones désertiques d’ici une décennie.
Le lac d’Ourmia, autrefois le 18e plus grand du monde, semble avoir disparu pour de bon.
Le lac Hamun, à l’est, à la frontière afghane, a également disparu.
Les prochains sites menacés de désertification sont Jaz-Murian, au Baloutchistan, et Bakhtegan, dans la province du Fars, un site naturel d’une grande beauté fréquenté par les flamants roses. Le marais de Hoveyzah, au sud-ouest, surnommé « un morceau de paradis terrestre », est menacé de désertification par le déclin du débit des rivières qui l’alimentent.
La situation de nombreux fleuves n’est pas meilleure.
Près de 40 % des 200 rivières et ruisseaux du pays sont soit totalement asséchés, soit réduits à l’état de ruisseaux saisonniers.
Le Zayandehrud, autrefois puissant, le fleuve « qui donne la vie », s’est réduit à un étroit cours d’eau qui apparaît quelques jours par an. Le marais de Gav-Khuni, où il prenait fin, est déjà une étendue de désert semi-humide. La disparition du Zayandehrud menace l’existence même d’Ispahan, l’une des plus belles villes historiques du monde et longtemps capitale de l’Iran.
Le plus grand, le plus long et le seul fleuve navigable du comté, le Karun, qui traverse trois provinces, a perdu 40% de son débit d’eau traditionnel.
La crise de l’eau en Iran a également entraîné une perte ou une salinisation de la couche arable et un affaissement des terres dans 25 provinces.
L’un des effets immédiats est une baisse constante de la production alimentaire.
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), un organisme des Nations Unies basé à Rome, affirme que l’Iran n’est pas confronté à une menace immédiate de famine, mais que 25 % de la population est menacée de pénuries alimentaires « modérées à graves ».
Quelle est la cause de cette catastrophe imminente ?
Une cause évidente est une période de sécheresse qui entre dans sa cinquième année. Mais voici d’autres causes plus importantes.
Dans les années 1990, le gouvernement a décidé de rechercher une autosuffisance complète en matière de production alimentaire, sous prétexte qu’il devait se préparer à faire face à des sanctions qui pourraient affecter les importations alimentaires.
Certes, les importations de denrées alimentaires, de médicaments et d’équipements médicaux, n’ont jamais été soumises aux sanctions de l’ONU ou autres. Mais le slogan « khod-kafa’i » (autosuffisance), inspiré du « juche » nord-coréen, a façonné la politique agricole.
La superficie cultivée a augmenté de 40%, ce qui a nécessité la construction de nombreux barrages, digues et canaux qui drainaient les rivières et nécessitait de nombreux puits artésiens qui absorbaient les ressources en eau souterraines.
En 2019, l’agriculture représentait entre 60 et 80 % de la consommation d’eau de l’Iran, mais ne fournissait que 18 % du produit intérieur brut.
L’Iran a atteint l’autosuffisance et est devenu une source majeure de produits agricoles pour la Russie et l’Irak. Pour financer ses importations, il aurait été plus judicieux d’importer des céréales et autres produits agricoles gourmands en eau, et de privilégier des produits à forte valeur ajoutée et exportables, comme la grande variété de fruits cultivés dans le pays depuis des millénaires.
L’utilisation massive de puits artésiens et de barrages construits à la hâte a également entraîné l’abandon du réseau national de canaux d’eau souterrains, qui évitait l’évaporation et régulait l’utilisation de l’eau de manière ciblée. Connus sous le nom de qanats, ces canaux comptent parmi les trois principales inventions attribuées aux Iraniens, les deux autres étant les moulins et les éoliennes pour refroidir les bâtiments. La principale de ces trois inventions était la nécessité de faire face à la pénurie d’eau.
Une autre cause de la crise actuelle, comme le mentionne Pezeshkian, est l’augmentation de la population.
La population iranienne a presque doublé depuis 1960, année du premier recensement scientifique. L’urbanisation massive est un autre facteur, les citadins consommant 60 % d’eau de plus pour leurs besoins personnels que les ruraux.
La civilisation iranienne a été construite sur un plateau avec trois centres, chacun alimenté par ses propres sources d’eau.
L’un se trouvait à l’est, dans ce qui est aujourd’hui les provinces de Kerman et du Sistan-Baloutchistan et les walayahs de Farah et d’Helmand , dans ce qui est aujourd’hui l’Afghanistan, et était alimenté par des rivières provenant de l’Hindou Kouch.
L’autre base civilisationnelle se trouvait au centre, à Ispahan, Charmahal et Fars.
La troisième base se trouvait au sud-ouest, à Suse et dans certaines parties de la Mésopotamie, bénéficiant des eaux de l’Euphrate, du Tigre et d’une douzaine de rivières coulant de la chaîne du Zagros.
De nombreuses voix se sont élevées à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran, avertissant que les bases mêmes de l’une des plus anciennes civilisations du monde sont menacées d’extinction à moyen et long terme.
La bonne nouvelle est que plusieurs études sérieuses, dont une japonaise, suggèrent que la disparition prévue n’est pas inévitable et que de nouvelles stratégies économiques et politiques socioculturelles combinées à des investissements massifs de ressources peuvent arrêter puis inverser la tendance mortelle de la désertification.
Il y a plus de 25 siècles, le roi achéménide Darius priait D’ de préserver l’Iran de deux maux: les mensonges et la sécheresse.
Amir Taheri a été rédacteur en chef exécutif du quotidien Kayhan en Iran de 1972 à 1979. Il a travaillé ou écrit pour d’innombrables publications, publié onze livres et est chroniqueur pour Asharq Al-Awsat depuis 1987. Il a l’honneur d’être président de Gatestone Europe.
Source: gatestoneinstitute.org
Photo : Une partie de ce qu’il reste du lac d’Ourmia, le 1er novembre 2023. (Photo de Hamed/Middle East Images/AFP via Getty Images)
JForum.fr