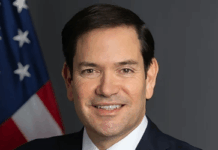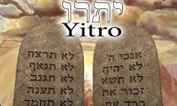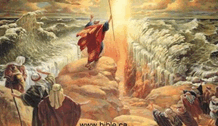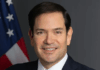Deux ans et huit jours. Exactement 738 jours pendant lesquels Segev Kalfon, 27 ans, a disparu sous terre, happé par les tunnels du Hamas après avoir été enlevé le 7 octobre au festival Nova. Son retour récent a l’intensité d’une renaissance : l’étreinte avec ses proches à Dimona, l’air libre qui pique les yeux, et la parole qui revient, parfois par rafales, pour dire l’indicible.
Le cœur de son témoignage tient en une ligne simple et terrifiante : on peut s’accoutumer au bruit des bombardements, à la peur sourde, au tempo mécanique de la captivité, mais pas à la faim. La faim était une lame. Dans les sous-sols, l’eau rare était filtrée au travers d’une compresse, « comme de l’or » ; la nourriture, parfois quelques grains à se partager, parfois une marmite presque vide, n’apaisait rien. Cette privation, confie-t-il, ronge le corps et la pensée jusqu’à réduire l’être à une seule obsession : tenir.
Les premiers jours, Kalfon a été baladé d’appartement en appartement, puis enfoui dans les profondeurs. Il raconte les brimades absurdes autour de son prénom, les coups qui s’abattent quand les geôliers voient une image qui les exaspère à la télévision, l’ordre de creuser et de survivre comme un « rat » de tunnel. Il a aussi refusé de se prêter à des mises en scène de propagande, jurant de ne pas mentir sur son état pour une vidéo. Dans les moments les plus sombres, il s’est surpris à « parler à la mort », à lui adresser des compromis imaginaires pour gagner une minute de plus.
Le réapprentissage a ses rituels. Segev raconte qu’il savoure chaque gorgée d’eau claire, chaque rayon de soleil ordinaire, chaque marche sans crainte. Il affirme aussi que la foi l’a tenu, là-bas, comme une ossature invisible. Aujourd’hui, il parle pour « se libérer » et pour ceux qui n’ont plus de voix : les otages morts, ceux dont les corps doivent encore rentrer pour un enterrement digne, et ceux qui, de leur vivant, n’ont pas pu raconter.
Le contexte, lui, rappelle l’enjeu national : la séquence d’octobre 2025 a permis de faire revenir des captifs et des dépouilles, grâce à une mécanique complexe de cessez-le-feu, d’échanges et de médiations. Sur le terrain, les équipes médicales témoignent d’un arc de séquelles allant de la dénutrition légère à des traumatismes plus lourds, avec un même impératif : ne pas réduire ces hommes et femmes à leur statut de victimes, mais leur rendre pleinement leur place dans la société.
À Dimona, l’instant du retour a la pureté d’un symbole. Mais c’est dans la durée que se mesure la victoire : suivi psychologique soutenu, accompagnement social, et un récit collectif qui nomme clairement la responsabilité du Hamas pour des détentions marquées par la faim, l’humiliation et la peur. Ce récit n’est pas une revanche, c’est une vérité.
Jforum.fr