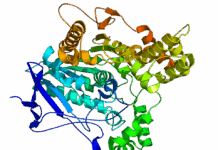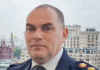Un frémissement est apparu dans un dossier longtemps figé. Selon deux sources citées par le Jerusalem Post, le Hamas a laissé entendre aux médiateurs qu’il serait prêt à examiner un arrangement partiel autour des otages. Aucun détail n’a filtré sur l’architecture de ce compromis, mais l’ouverture, même limitée, tranche avec la ligne jusqu’ici affichée par le mouvement, qui conditionnait toute libération supplémentaire à un cessez-le-feu permanent. Côté israélien, la prudence domine. Les responsables répètent qu’aucun accord ne sera jugé acceptable s’il ne sert pas les objectifs stratégiques de la guerre.
Ce cadrage, maximaliste par construction, vise à empêcher que des étapes intermédiaires deviennent des points de blocage permanents. Pour ses partisans, c’est l’unique manière d’éviter des cycles d’échanges partiels suivis de ruptures. Pour ses détracteurs, il rend toute percée plus difficile en exigeant d’emblée la totalité des concessions.
Pendant que les capitales auscultent les signaux faibles, la pression populaire s’intensifie en Israël. Les familles d’otages et de soldats tombés ont appelé à une « grève nationale » ce dimanche, à l’occasion des 680 jours écoulés depuis l’enlèvement d’une cinquantaine d’Israéliens lors de l’attaque du 7 octobre 2023, qui a fait 1 200 morts. Le programme prévoit un rassemblement matinal sur la place des Otages à Tel-Aviv, suivi d’une conférence de presse, d’actions visibles aux grands carrefours et d’un meeting de masse à 20 heures. Objectif : maintenir les projecteurs sur l’urgence humanitaire et rappeler au gouvernement que le temps, pour les familles, est un adversaire de plus.
Dans ce contexte, parler d’« accord partiel » n’est pas neutre. Un tel format pourrait, par exemple, concerner des catégories d’otages prioritaires (malades, femmes, personnes âgées) contre des mesures limitées de détente — sans aller jusqu’au cessez-le-feu permanent réclamé par le Hamas. Mais chaque hypothèse se heurte au verrou israélien : la libération doit être globale et immédiate. De l’autre côté, l’organisation islamiste voit dans un arrangement par étapes un levier pour conserver de l’influence politique et sécuritaire à Gaza, au moins transitoirement.
Sur le terrain politique intérieur, la marge de manœuvre du gouvernement se joue aussi dans la rue. Plus les rassemblements grossissent, plus l’exécutif est sommé de produire un résultat tangible. À l’inverse, un durcissement public du cadrage officiel peut consolider son socle et contenir les pressions pour des concessions jugées prématurées. Entre ces deux pôles, les familles d’otages, qui refusent de voir leurs proches devenir des variables d’ajustement, imposent leur calendrier moral.
Rien n’indique, à ce stade, que l’un des camps soit prêt à céder sur l’essentiel. Pourtant, l’apparition d’une fenêtre partielle dans le discours du Hamas, même étroite, crée une dynamique que les médiateurs chercheront à exploiter. La question est de savoir si cette brèche peut être élargie sans fracturer les impératifs posés par Israël. Les heures et les jours à venir, rythmés par la mobilisation citoyenne et les signaux envoyés en coulisses, diront si l’hypothèse d’un dégel s’installe — ou si l’on en reste à un nouveau cycle d’attente et de défiance.