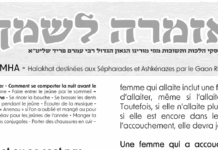Entre partisans convaincus et détracteurs farouches, la reconnaissance de l’État de Palestine cristallise des positions tranchées. Les arguments de chacun sont d’ailleurs défendables — dès lors qu’ils visent à la fois la sécurité d’Israël et le droit des Palestiniens à l’autodétermination –, mais l’enjeu est ici de saisir ce que produit réellement un tel geste : une déclaration de principe porte-t-elle à conséquences pour l’avenir ?
k.la revue
Illustration : Les sièges de la délégation israélienne vides au moment du discours d’Emmanuel Macron aux Nations unies le 22 septembre (Capture d’écran, BFM TV)
La Charte de l’ONU stipule que ne peuvent devenir membres de son assemblée que des « États pacifiques » s’engageant à respecter le contenu de la Charte elle-même. La Palestine ne s’apprête certes pas à devenir membre à part entière de l’ONU, puisqu’on peut prédire que le veto au Conseil de sécurité par les États-Unis continuera de l’empêcher. Néanmoins, c’est désormais la très grande majorité des États de cette assemblée qui, chacun unilatéralement, a reconnu l’État de Palestine, faisant croître la conscience commune que l’autodétermination du peuple palestinien prime aujourd’hui sur toute autre considération. La France, mais aussi le Portugal, l’Angleterre, l’Australie et le Canada, ont maintenant rejoint cette cohorte.
L’intention de ces derniers, très clairement, n’est pas antisioniste, au sens où les intérêts d’Israël en tant qu’État souverain seraient dans leur esprit menacés par un tel geste. Si l’intention suscite l’inquiétude d’une large part de l’opinion juive s’interrogeant sur le choix du moment, il est impossible de ne pas voir dans la gravité de la situation la nécessité d’empêcher qu’elle perdure. L’intention de la déclaration de reconnaissance est celle que partage toute position éclairée à l’heure actuelle : avancer sur une route actuellement bouchée, faire sauter le principal obstacle au changement du cap qu’ont pris successivement le Hamas en perpétrant les crimes du 7 octobre, et le gouvernement israélien en s’acharnant dans une guerre devenue criminelle. La destruction de Gaza, la colonisation croissante en Cisjordanie et l’obstination de la politique israélienne dans une fuite en avant condamnable, obligent la communauté internationale à s’engager, non seulement pour que la guerre cesse et que le pouvoir terroriste jusqu’au-boutiste de Gaza dépose les armes et libère les otages, mais pour qu’une autre configuration soit instaurée où le conflit devienne autrement traitable sur tous ses fronts.
C’est dans cette optique que l’option de la reconnaissance de l’État palestinien est jugée la plus pertinente, parce que la plus radicale. Elle est radicale, en ce qu’elle dit qu’un État existe, actuellement sous le feu et sous l’oppression d’un autre État. Elle se justifie par la récusation qu’elle adresse aux déclarations des politiques israéliens de droite et d’extrême droite qui affirment qu’il n’y aura jamais d’État palestinien. Mais pour changer vraiment la donne dans le conflit en cours, il lui faut plus que ce qu’elle proclame. Radicale verbalement, elle doit encore être ajustée aux faits.
Le décalage reste béant entre les contraintes exercées par la réalité et la visée affirmée. Ce qu’on reconnaît ne tient que par le fait qu’on le déclare, et ce qu’on déclare est tout sauf à portée de main.
Pour que l’autre configuration visée émane vraiment du geste, des conditions sont requises à propos desquelles on est dans l’incertitude. Qu’un forçage soit nécessaire dans la situation présente, c’est certain. Et si le principal effet recherché, à savoir l’arrêt des combats et des atrocités en cours, était atteint à coup sûr, cela suffirait à justifier le geste sans la moindre hésitation. Mais on sait bien que, dans l’état actuel des choses, ce n’est pas le cas. L’argument de la pression exercée sur le gouvernement israélien actuel tourne court, tant que cette pression se tient dans un ordre plus symbolique que réel, et n’atteint pas son but précis, à savoir le fait d’entraver effectivement son action guerrière. Action qui, toutefois, ne peut voir s’éroder la part de soutien dont elle bénéficie dans l’opinion israélienne, et plus généralement juive, que si une autre pression est exercée simultanément sur les forces palestiniennes toujours déterminées à détruire l’État juif. Sans cette symétrie dans le mode d’intervention international, le risque demeure de conforter Israël dans son isolement « spartiate », et donc indéfiniment guerrier, proclamé par son dirigeant. Si l’on veut s’acheminer efficacement vers la nouvelle configuration souhaitée, il est impossible en effet de ne pas tenir compte des mouvements qui traversent l’opinion israélienne. Or cette dernière, même dans sa partie la plus progressiste et la plus favorable à la relance de la solution à deux États, voit pour l’instant avec le plus grand doute le moyen de la reconnaissance de principe de l’État palestinien, et ne peut s’abstenir de souligner qu’en visant la pacification avec une mise en œuvre si fragile, il est toujours possible qu’il n’advienne dans les faits qu’un nouveau cycle de violences.
Dans ces conditions, face aux mots prononcés par Emmanuel Macron le 22 septembre à l’ONU, on est pris – et, pourquoi ne pas le reconnaître, à la rédaction même de K. des divergences s’expriment qui viennent au fond de là – dans une oscillation impossible à fixer entre le souhait et l’espoir. L’espoir est évidemment ce que le déclarant veut exclusivement voir et faire voir : « Le temps est venu… ». Mais on redoute que ce ne soit là qu’un vœu pieux. L’espoir est plus fort que le souhait, parce qu’il vise quelque chose perçu comme réalisable dans un futur proche, pour autant qu’on le veuille. Le souhait est plus faible, non par sa moindre volonté, mais parce qu’il sait ne pouvoir évoquer son objet qu’abstraitement, considérant qu’il dépend de tant de conditions que son caractère réalisable est comme suspendu.
Conformément à la déclaration de New York du 29 juillet, prélude à l’acte de reconnaissance qui vient d’avoir lieu, ont été de nouveau stipulés la nécessité de la démilitarisation, la restitution des otages, l’exclusion du Hamas, la passation de pouvoir à l’Autorité palestinienne et la constitution d’une force internationale qui lui vienne en appui, la programmation d’élections libres dans le délai d’une année à compter de la prise de fonction du nouveau gouvernement – bref, on s’efforce de s’approcher autant que possible des conditions fixées par l’ONU dans l’acception des « États pacifiques ». Mais pour l’instant, le décalage reste béant entre les contraintes exercées par la réalité (dès lors qu’un cessez-le-feu s’impose sans reddition du Hamas, qui resterait donc au pouvoir à Gaza) et la visée affirmée. Ce qu’on reconnaît ne tient que par le fait qu’on le déclare, et ce qu’on déclare est tout sauf à portée de main. Bref, entre le souhait et l’espoir, le premier prend inévitablement le dessus sur le second dès qu’on regarde les choses en face. Quoi qu’on en veuille, c’est la limite du geste qui vient d’être accompli, quand bien même on le crédite des intentions qu’il se donne, et quand bien même on les partage.