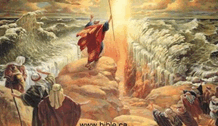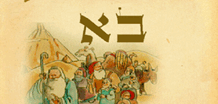Une nouvelle enquête soutenue par les Nations unies met en lumière un cycle d’exactions qui s’est enraciné le long du littoral syrien. Publiées jeudi, les conclusions de la Commission internationale indépendante d’enquête sur la Syrie décrivent des attaques « généralisées et systématiques » contre des civils, sur fond de violence à caractère confessionnel. Selon la Commission, les affrontements ayant opposé des groupes armés alliés à l’ancien pouvoir et des forces de sécurité loyales au gouvernement en place ont dégénéré en représailles ciblant la minorité alaouite, communauté à laquelle appartient Bachar al-Assad.
En parallèle, une autre enquête fait état de plus de 1 400 morts, majoritairement des civils, dans les violences côtières. Ce bilan, déjà lourd, s’ajoute aux traumatismes d’un pays en transition politique fragile, où la défiance entre communautés reste vive. À As-Suwayda, dans le sud, les combats impliquant la minorité druze, des forces gouvernementales et des tribus bédouines locales ont, eux, causé des centaines de morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes. L’onde de choc humanitaire — pertes, déplacements, ruine des moyens de subsistance — nourrit à son tour l’instabilité sécuritaire.
Du côté officiel, le ton se veut réactif mais mesuré. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Shaibani, affirme que le gouvernement prend « sérieusement note des violations présumées ». Parmi les pistes évoquées, un contrôle d’intégrité plus strict des recrues et des chaînes de commandement, présenté comme une « feuille de route » pour consolider les progrès. Le conseiller juridique du ministère, Ibrahim Olabi, a toutefois insisté : il est « trop tôt » pour détailler une réponse complète, le temps d’examiner les recommandations et d’en évaluer la mise en œuvre. Autrement dit, la boîte à outils politique et judiciaire existe, mais sa traduction concrète reste à définir.
La question de la décentralisation, portée par plusieurs minorités, ne se réduit pas à un débat institutionnel. Elle touche à la redistribution des pouvoirs, à la gestion des ressources et à la reconnaissance de la diversité confessionnelle et culturelle. Une décentralisation purement administrative, dépourvue de garanties constitutionnelles effectives, risquerait de reconduire les asymétries et de laisser le terrain aux dynamiques de représailles.
À court terme, le rapport onusien place les autorités devant un test de crédibilité. Des mesures rapides — audit des unités impliquées, suspensions, poursuites, redéploiement et formation aux droits humains — seraient un signal tangible pour les populations. À moyen terme, l’architecture de sécurité devra se recomposer autour d’institutions professionnalisées, moins perméables aux logiques d’allégeance et mieux contrôlées par des mécanismes judiciaires et parlementaires.
Jforum.fr