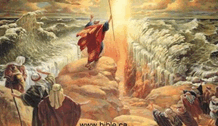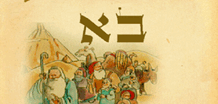Depuis des décennies, la capitale qatarie, Doha, servait de refuge doré à l’instance dirigeante du Hamas. Une immunité de fait, nourrie par un quotidien de confort, de déplacements régionaux et d’impunité publique, s’est brutalement effondrée le 9 septembre 2025.
Selon l’armée israélienne, l’opération, qualifiée de “totale et indépendante”, visait des cadres accusés d’avoir orchestré les attaques du 7 octobre 2023 et de poursuivre la guerre contre Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a assumé la responsabilité complète de l’opération. L’usage de munitions de précision et d’un renseignement affiné a été souligné pour limiter les dommages collatéraux .
La riposte internationale a été immédiate : le Qatar a condamné l’attaque comme une violation flagrante de sa souveraineté et des lois internationales. L’ONU, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Iran et même le pape ont dénoncé l’action, soulignant son impact négatif sur tout espoir de paix régionale.
Cette opération constitue la nouvelle étape d’une campagne israélienne qui, depuis plus de deux ans, vise les hauts responsables du Hamas partout dans le monde — de Beyrouth à Téhéran, en passant par Gaza même. Plusieurs figures emblématiques, comme Ismaïl Haniyeh, Yahya Sinwar et Mohammed Deif, ont déjà été éliminées.
À Doha se trouvaient des leaders tels que Khaled Meshaal, Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Mousa Abu Marzouk, Muhammad Darwish, Ghazi Hamed, pour n’en citer que quelques-uns. Des décennies durant, ces responsables ont joui d’un refuge confortable, tirant parti des liens du Hamas avec les Frères musulmans, des réseaux financiers – notamment qataris – et des positions diplomatiques ambiguës.
Le Hamas puise ses racines dans la première Intifada des années 1980, alimenté par une diffusion rapide de l’idéologie des Frères musulmans, largement présente à Gaza après la période du contrôle égyptien (1948–1967). Dans les années 1990, le mouvement s’est affirmé par des assassinats de Palestiniens considérés comme « collaborateurs », puis par des actions terroristes en Israël, en opposition avec la stratégie plus modérée de l’OLP.
L’un des exemples frappants de ce décalage est Mousa Abu Marzouk, ancien ingénieur ayant vécu aux Émirats puis aux États-Unis, pourtant devenu l’un des plus hauts dignitaires du Hamas, impliqué dans la collecte de fonds, les relations avec Téhéran, Washington ou Amman, tout en assistant à des célébrations de violence depuis un confortable exil. Khaled Meshaal incarne un parcours similaire : formé en Cisjordanie, exilé au Koweït, en Jordanie, puis en Syrie avant de se réfugier à Doha, où il a rencontré Erdogan en 2015 .
Cette dualité – entre culture des armes et vie mondaine – se manifeste clairement lors du 7 octobre, célébré par les dirigeants en exil. Le Hamas croyait que Doha et Ankara pourraient les protéger, favoriser un cessez-le-feu américain, négocier libérations d’otages, puis les conduire au pouvoir en Cisjordanie via un gouvernement technocratique, tout en conservant Gaza. Ils misaient sur un glissement tacite d’Égypte, jadis hostile aux Frères musulmans, vers une position plus accommodante (Le Wall Street Journal, Wikipédia).
Mais l’assaut du 9 septembre met fin à cette illusion de sécurité. L’opération rompt une immunité de fait vieille de trois décennies, dans un lieu jusqu’ici perçu comme intouchable. Le tournant est historique : le refuge doré s’est transformé en champ de conflit.
Jforum.fr