L’abcès qui a éclaté autour de l’affaire de la procureure générale militaire révèle une tentative continue du système judiciaire et des organisations de protestation de créer une souveraineté alternative en piétinant la loi. Une correction exigera une redéfinition des règles et des pouvoirs.
Ynet – Dani Van Biren
Le drame de l’arrestation de la procureure générale militaire (la patsarite) et les événements qui l’ont entourée constituent un microcosme du détachement du système judiciaire — ainsi que d’autres groupes de la société israélienne — de l’idée de souveraineté nationale (mamlakhtiyout). L’affaire représente un cas extrême, qui illustre jusqu’où sont prêts à aller certains acteurs de haut rang du service public et des organisations de protestation pour créer une sorte de royaume alternatif, régi par ses propres normes et lois.
L’affaire de « Sdé Teyman » et la conduite de la procureure générale militaire en son sein ne peuvent être considérées comme un incident isolé, sans contexte. Malgré son caractère exceptionnel, la conduite de la patsarite, d’après son propre aveu, ne surgit pas du néant. Lorsqu’un acteur aussi haut placé dans le système d’application de la loi viole la loi de manière si flagrante, il est évident qu’il puise sa légitimité dans une autre source que la loi elle-même.
Une longue route a été parcourue par l’État d’Israël depuis que Ben-Gourion a façonné le concept de mamlakhtiyout comme principe fondateur du jeune État. Pour lui, la souveraineté nationale exigeait le transfert du centre de gravité de l’autorité publique vers le gouvernement et les institutions de l’État, et le démantèlement de toutes les organisations qui détenaient un pouvoir militaire ou des prérogatives diverses avant sa création. La mamlakhtiyout impliquait également une loyauté au projet national et historique du peuple juif, ainsi que la reconnaissance par les citoyens de leur devoir de servir l’État, de respecter la loi et d’agir dans le cadre des institutions officielles.
Si, pendant des décennies, le débat public s’est concentré sur les groupes au sein des populations ‘harédi et arabe qui ne se reconnaissaient pas tenus par ce principe de souveraineté nationale, depuis l’élection du gouvernement actuel, d’autres groupes ont commencé à se forger leur propre souveraineté alternative, qui n’est pas nécessairement fidèle à l’État de droit, aux valeurs démocratiques ou aux traditions établies.
La réforme judiciaire, que le gouvernement a tenté de promouvoir de manière maladroite et sans succès, a provoqué une mobilisation serrée du système judiciaire, qui s’est senti menacé dans son statut et ses pouvoirs. Mais pas seulement : d’autres organismes et groupes opposés au gouvernement — et cela avant même l’annonce de la réforme par Yariv Levin — se sont joints à lui, incluant certains hauts cadres de la fonction publique. Ils affirmaient que les changements projetés dans le système judiciaire étaient une pente glissante conduisant selon eux à la fin de la démocratie israélienne — une terminologie utilisée contre tous les gouvernements de droite depuis l’époque de Begin.
Ce narratif s’est en grande partie construit sur la crainte, dans le camp opposé au gouvernement — constitué pour l’essentiel de la gauche israélienne — que les données démographiques et les tendances sociales ne lui permettent plus de remporter les élections, et que la réforme projetée conduise à la perte des derniers centres de pouvoir qui lui restent. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous assistons, depuis trois ans, à un processus de déconnexion d’une partie de la société israélienne : de la lettre de la loi, de l’éthos sioniste, des symboles et des événements qui font partie intégrante du collectif israélien.
Ce qui a commencé comme des manifestations légitimes contre la réforme judiciaire a progressivement dégénéré vers la violence et la rupture des règles du jeu, dont le sommet fut l’appel à refuser de servir dans la réserve — appels menés et soutenus par des organisations de protestation, et qui n’ont reçu aucune réponse ferme du commandement militaire.
Le grave dommage porté à la capacité opérationnelle de Tsahal en général, et de l’armée de réserve en particulier, a marqué un nouveau Rubicon franchi, fondé sur l’idée suivante : si le gouvernement n’agit pas selon notre volonté, nous serons prêts à renverser le seau de la souveraineté.
Ce n’est pas un hasard si, avant la guerre, nous étions au bord d’une crise constitutionnelle, lorsque divers acteurs intéressés ont tenté de pousser les commandants de Tsahal et du Shin Bet à répondre à la question : à qui obéir en cas de conflit entre les pouvoirs ? Et ce, malgré la loi explicite qui subordonne ces organismes au gouvernement.
La division « nous contre eux » est devenue une formule courante parmi les organisations de protestation et certaines personnalités publiques, bénéficiant continuellement d’un soutien médiatique massif. L’un des exemples les plus extrêmes fut fourni par l’homme d’affaires Kobi Richer, qui déclara — voire menaça — dans une interview célèbre :
« La force sécuritaire, c’est nous, les protestataires. La force économique, c’est nous. Nous sommes l’économie et nous sommes la solution de l’État, pas le gouvernement. Il n’existe aucun scénario dans lequel ils nous battent. »
Une intervention à connotation politique
La culture du « nous contre eux » a pénétré les activités d’organisations diverses, y compris concernant les cérémonies nationales. Ainsi, certaines ont remplacé la cérémonie officielle d’allumage des torches sur le mont Herzl par une « cérémonie d’extinction des torches et d’allumage de l’espoir ». L’un des mouvements de protestation a même ajouté son slogan — « Libres dans notre pays » — au drapeau national, transformant ainsi, à leurs yeux, la phrase de l’hymne « Être un peuple libre dans notre pays » d’une aspiration nationale souveraine en un étendard des droits individuels.
La Cour suprême a elle aussi contribué à l’érosion de la mamlakhtiyout. L’activisme judiciaire issu de l’école d’Aharon Barak, qui n’a cessé de s’accentuer ces dernières années, a rompu l’équilibre nécessaire entre les pouvoirs et conduit la Cour à intervenir dans presque toutes les questions de politique publique, y compris sécuritaires. Cette intervention, souvent teintée d’un parfum politique, a sapé la confiance du public dans le système judiciaire. Elle a atteint son paroxysme lorsque la Cour a étendu son interprétation de sa propre capacité à annuler des lois, allant jusqu’à annuler une Loi fondamentale de la Knesset sans qu’aucune loi explicite ne lui en donne le pouvoir, justifiant sa décision — pour certains juges — par les valeurs de la Déclaration d’indépendance.
L’élément le plus grave : agir de l’intérieur contre le système
La gravité de l’affaire réside surtout dans le fait que la patsarite et d’autres responsables ont agi depuis l’intérieur du système — contre le système. Ils n’ont pu se le permettre que dans une atmosphère où la définition de la norme correcte n’a plus besoin d’être alignée sur le texte de la loi, mais sur l’interprétation donnée par « les bonnes personnes » et sur les normes fixées par une souveraineté alternative.
Ainsi, l’ancien chef du Shin Bet s’est cru autorisé, dans une sorte d’ivresse de pouvoir, à « s’accrocher aux cornes de l’autel » et refuser de quitter son poste malgré son renvoi, en s’adressant à la Cour pour des motifs procéduraux. Ainsi également, la conseillère juridique du gouvernement s’est permis d’éviter de faire appliquer l’ordre public lorsque les actions étaient accomplies selon elle pour « une fin digne », et de traiter des dossiers dans lesquels elle semblait être en conflit d’intérêts — notamment l’affaire de la patsarite, le limogeage du chef du Shin Bet, et, comme l’a rapporté la presse, le cas étrange où le fils de la conseillère juridique aurait volé une trousse de produits de soin à un soldat, affaire qui n’a jamais abouti à une enquête ou une procédure judiciaire complète.
C’est dans cette atmosphère — où le système judiciaire lui-même se détache de la loi et de ses symboles — qu’un espace dangereux s’est ouvert pour une application sélective de la loi, où le critère principal n’est plus l’acte commis, mais l’identité de celui qui l’a commis et la « finalité » poursuivie.
La vidéo de Sdé Teyman, éditée par une instance inconnue, a été divulguée à la chaîne 12 par la patsarite dans des circonstances et avec des dommages sans précédent — malgré les tentatives de certains journalistes et responsables de minimiser l’affaire. Non seulement parce que cela a infligé un tort immense à l’image d’Israël dans le monde, ni seulement parce que cela a diffamé les soldats de la Force 100 en les présentant comme des violeurs — accusation absente de l’acte d’inculpation.
Le point le plus grave est que la procureure générale militaire, avec d’autres hauts responsables, a agi depuis l’intérieur du système contre le système : occultation des faits, mensonges déclarés devant la Cour suprême, et construction d’un pacte de silence au sein de l’organisme qu’elle dirigeait.
Ils n’ont pu agir ainsi que dans une atmosphère où la norme correcte n’est plus définie par le droit, mais par l’interprétation offerte par « les bonnes personnes » et les normes fixées par une souveraineté alternative.
Une guérison en profondeur est indispensable
L’abcès qui a éclaté autour de l’affaire de la patsarite doit être traité de manière fondamentale. Il ne faut surtout pas laisser retomber les choses. Cela n’a rien à voir avec la politique ou les positions partisanes. Une redéfinition des règles et des prérogatives doit être menée sérieusement et rapidement, afin de restaurer les équilibres nécessaires entre les pouvoirs et entre les composantes du peuple.
Dans un régime démocratique, il n’y a qu’une seule loi — qui doit être appliquée de manière égale — et une seule souveraineté, qui inclut toutes les composantes de la nation.
Les paroles du président Lincoln dans son célèbre discours de Gettysburg conviennent parfaitement ici : « Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra pas de la surface de la terre. »
Général de brigade (rés.) Dani Van Biren, président du mouvement “Appelés au drapeau”, ancien chef des réservistes.
Danny@ladegel.org
Si même Ynet le dit…






















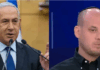





le plus grave c’est que la patsarite a propage un mensonge puisque cette video contre les soldats de l’unite 100 est mensongere , traffiquee pour accuser ces soldats d’un crime jamais commis. Tout cela bien sur sur les ordres de l’admnistration Biden qui cherchait un moyen d’arreter la guerre menee par Israel. Pour y arriver les USA devaient prouver l’existence d’un abus par Israel, alors l’administation americaine aurait eu le droit de refuser de lui fournir des armes.
Il s’agit donc d’un cas de haute trahison de la part de la patsarite ainsi que de toute sa clique et c’est de cela qu’il faut parler. Les medias de gauche essaient de detourner l’attention en focalisant sur la diffusion de la video. Or le sujet ici est extremement grave pusiqu’il s’agit d’un crime de haute trahisions commis par ces fonctonnaires de l’etat avec des ramifications a tous les niveaux. Abject au plus haut point.