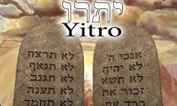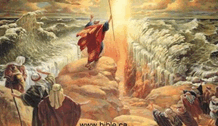Israël avance vers la création d’un tribunal spécial pour juger des membres de la Force Nukhba du Hamas impliqués le 7 octobre 2023, selon des annonces et fuites relayées fin octobre–début novembre 2025.
Environ 250 à 300 détenus Nukhba sont concernés ; la mise en place d’un comité d’orientation de la politique pénale (excluant les cas individuels) et l’emploi de magistrats retraités ou proches de la retraite font partie du schéma discuté.
Le gouvernement a déjà soutenu au printemps 2025 un projet de loi de tribunal spécial (composition élargie, procédures et preuves adaptées), avec réserves de la procureure générale sur les implications juridiques internationales.
Des responsables évoquent la peine de mort « dans les cas appropriés » (pour meurtres), mesure rare en Israël, tandis que l’idée d’allonger indéfiniment la détention au titre des « combattants illégaux » a été mise en suspens pour obstacles juridiques.
En parallèle, des actes d’accusation ont déjà été finalisés pour 22 terroristes impliqués à Nir Oz, illustrant l’avancée des enquêtes sur pièces vidéo et témoignages.
Israël s’apprête à franchir un cap judiciaire en créant une juridiction dédiée au jugement des membres de la Force Nukhba du Hamas impliqués dans le massacre du 7 octobre 2023. Le dispositif, mûri depuis des mois et relancé après le retour des derniers otages vivants, vise à répondre à une équation inédite : un nombre élevé de prévenus, des crimes d’une gravité extrême et un impératif de rigueur procédurale susceptible de tenir face au regard du monde.
Au cœur du projet, un tribunal spécial composé de juges retraités ou proches de la retraite, afin de mobiliser rapidement une expertise aguerrie sans désorganiser les juridictions ordinaires. La mission de cette cour serait double : juger avec célérité et garantir un cadre de droits pour les accusés, y compris la possibilité d’appel, tout en évitant l’asphyxie du système pénal classique par des centaines de dossiers complexes et fortement médiatisés.
Le périmètre pénal ne se limitera pas à l’infraction de génocide, difficile à caractériser individuellement pour chaque mis en cause. Les architectes du texte envisagent une palette de qualifications adaptées aux faits et aux preuves disponibles : aide à l’ennemi en temps de guerre, atteintes à la souveraineté, crimes de guerre et, pour les homicides documentés, des chefs passibles des peines les plus lourdes prévues par le droit israélien. Cette grille d’infractions répond à un enjeu central : articuler la responsabilité collective d’une attaque coordonnée avec l’exigence, dossier par dossier, d’établir la part exacte de chaque accusé.
Certaines pistes ont été écartées. L’idée de prolonger indéfiniment la détention de « combattants illégaux » pour des motifs de sécurité, tout en menant les enquêtes, s’est heurtée à des écueils juridiques. Le choix israélien s’oriente donc vers la voie, plus exigeante mais plus robuste, du jugement pénal, avec un mécanisme ad hoc pour répondre au caractère massif et organisé de l’attaque.
La question de la peine de mort, pratiquement inusitée en Israël depuis 1962, revient dans l’actualité judiciaire : elle pourrait être requise pour les auteurs de meurtres particulièrement atroces. Elle demeurera toutefois encadrée et réservée à des cas strictement définis, ce qui rappelle que la volonté de punir n’efface pas l’exigence de proportionnalité ni les garde-fous d’un État de droit.
Au-delà de la technique, l’enjeu est aussi narratif et moral. Un procès de masse, structuré et contradictoire, fixe un récit judiciaire susceptible de résister aux tentatives de déni et de renversement accusatoire. Il rend justice aux victimes — assassinées, violées, enlevées — et rappelle que l’attaque du 7 octobre n’a pas été un enchaînement de bavures isolées, mais une agression planifiée contre des civils et la souveraineté d’un État.
En optant pour une voie judiciaire exigeante, Israël fait ce que les démocraties fortes doivent faire : traduire la barbarie en responsabilité pénale, sans renoncer ni à la fermeté ni à l’État de droit. Un tribunal spécial, bien borné et bien conduit, peut à la fois honorer la mémoire des victimes, dissuader la répétition de tels crimes et offrir au monde une démonstration de justice — rigoureuse, documentée, irréfutable.