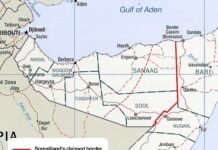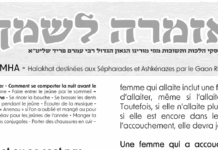Dans la nouvelle réalité dans la bande de Gaza, ce sont les États-Unis qui fixent le ton, et ils veulent poursuivre le cessez-le-feu presque à tout prix. Il faut choisir : poser des lignes rouges à Trump et en payer le prix, ou coopérer avec lui tout en préservant une marge de manœuvre.
Ynet – Michaël Milshtein
Plus d’un mois après la signature de l’accord mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza (9 octobre), le passé, le présent et l’avenir se clarifient.
Premièrement, la réponse à la question : « comment Israël en est arrivé à mettre fin aux combats ? » apparaît de façon cinglante. Les déclarations des hauts responsables américains, à commencer par le président Trump, et les interviews qu’ils ont accordées, ne laissent aucun doute : Israël a été contraint de mettre fin à la guerre suite à l’attaque ratée au Qatar, qui a suscité à Washington de fortes craintes d’une perte d’équilibre stratégique. La guerre ne s’est pas terminée parce que la pression militaire a fonctionné, mais parce que Trump a décidé qu’une campagne illimitée dans le temps et sans plan précis nuisait à Israël, mais aussi à Washington.
Depuis le 9 octobre, la nouvelle réalité dans la bande de Gaza se dévoile également. Derrière la fierté israélienne d’avoir évité un retrait total, se cache le fait que l’acteur qui définit « le jour d’après » dans la région, ce sont les États-Unis, qui retirent progressivement à Israël son exclusivité sur les différents domaines de gestion.
Le quartier général installé à Kyriat Gat (la CMCC) doit servir de bras avant à cette implication sans précédent de Washington dans le conflit. Selon plusieurs rapports, une immense base devrait s’ajouter à la frontière de Gaza.
L’hégémonie américaine sur Gaza
L’hégémonie américaine à Gaza s’est vérifiée plusieurs fois :
-
L’acceptation par Trump de la réponse du Hamas à son plan en 20 points, bien qu’elle n’inclue aucune volonté de se désarmer
-
L’exigence de poursuivre le processus malgré les violations flagrantes par le Hamas (principalement les incidents où trois soldats israéliens ont été tués dans la zone de Rafah, ainsi que le retard dans la restitution des dépouilles des otages)
-
L’exigence d’un aval américain pour chaque démarche civile – mais aussi militaire – concernant Gaza.
En Israël, les décideurs continuent d’affirmer qu’à tout moment, il est possible de reprendre les combats, de conquérir des zones de la bande, voire toute la bande de Gaza, et finir par détruire le Hamas. Mais l’écart entre cette posture et celle des Américains se creuse.
De plus, il semble que chaque initiative américaine vise à fixer une nouvelle réalité sur le terrain, de façon à limiter la liberté d’action d’Israël et à rendre très difficile un retour à la guerre.
Le prochain séisme : le vote à l’ONU
Un nouveau sommet du « tsunami américain » est attendu la semaine prochaine, lorsque le Conseil de sécurité devra voter sur le plan Trump pour « le jour d’après Gaza », dont l’élément central est le déploiement de forces étrangères dans la zone.
L’approbation n’est pas assurée (Russie et Chine émettent des réserves), mais les projets déjà en circulation soulèvent des défis majeurs :
-
Implication de responsables de l’Autorité palestinienne dans la gestion de Gaza
-
Mention explicite d’une possible création d’un État palestinien.
L’affaire des terroristes bloqués dans les tunnels
L’affaire des terroristes coincés dans les tunnels de Rafah révèle aussi le fossé grandissant entre Jérusalem et Washington. En Israël, de nombreuses voix politiques et médiatiques exigent leur élimination ou au moins leur arrestation. Les États-Unis, eux, demandent qu’ils déposent les armes et puissent revenir en zone contrôlée par le Hamas, ou bien être exilés à l’étranger – signe clair qu’ils n’ont aucun intérêt à remettre en cause le cessez-le-feu.
Si Israël persiste dans ses « fantasmes »
Plus Israël s’obstinera à poursuivre des illusions dangereuses, comme entre le 18 mars et la fin de la guerre, plus elle perdra sa pertinence – et surtout sa capacité de veto sur des sujets cruciaux, comme :
-
Un futur gouvernement à Gaza comprenant des personnalités liées au Hamas
-
Des forces internationales stationnées à la frontière israélienne venant de pays hostiles (notamment la Turquie).
La volonté de Trump de préserver l’accord pourrait mener Washington à faire des concessions au détriment d’Israël – par exemple en acceptant un Hamas désarmé seulement de ses armes offensives, mais pas totalement démilitarisé.
Alors que la phase A de l’accord (restitution des dépouilles des otages) approche de son terme, la pression américaine pour qu’Israël se retire davantage derrière la « ligne jaune » pourrait augmenter.
Deux options pour Israël
Israël se trouve à une intersection stratégique et ne dispose que de deux options :
-
S’affronter à Trump et fixer des lignes rouges (possible – mais coûtera cher)
-
Reconnaître la nouvelle réalité et tenter de préserver une liberté d’action maximale :
-
Liberté de frappes préventives contre des menaces émergentes (surtout au Liban)
-
Droit de veto sur des décisions contraires aux intérêts israéliens.
-
À plus long terme, une reprise de la guerre reste possible si Trump jette l’éponge face à l’intransigeance du Hamas et donne son feu vert à Israël.
Le regard stratégique après Gaza
La fin des combats intenses à Gaza permet à Israël de porter un regard stratégique plus clair sur les autres fronts. Il apparaît nettement que malgré les succès impressionnants au Liban et en Iran, le travail n’est pas terminé, et exige des efforts supplémentaires pour approfondir les dégâts causés à l’ennemi.
Se focaliser sur Gaza et rêver d’y retourner en guerre ronge la capacité d’Israël à traiter des fronts plus importants, et surtout sape la légitimité internationale – et particulièrement américaine – dont il a crucialement besoin.
Dr Michaël Milshtein est le directeur du Forum d’études palestiniennes au Centre Dayan de l’Université de Tel-Aviv.