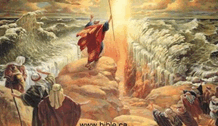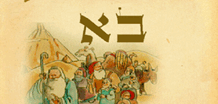Deux ans après le déclenchement de la guerre à Gaza, la bataille la plus décisive reste invisible : elle se joue sous terre. Selon l’évaluation la plus récente, plus de 60 % du réseau souterrain du Hamas serait encore opérationnel. Ce constat, partagé par le ministre de la Défense Israel Katz auprès du vice-président américain JD Vance lors de sa visite en Israël, ramène la question des tunnels au premier rang des priorités stratégiques. L’objectif déclaré est limpide : démilitariser la bande de Gaza en neutralisant systématiquement cet écosystème souterrain qui permet à l’organisation terroriste de survivre, se déplacer, stocker et frapper.
La réalité du terrain confirme la persistance du danger. La semaine dernière, une cellule sortie d’un axe souterrain a attaqué une unité de la brigade Nahal dans le secteur de Rafah, coûtant la vie au major Yaniv Kula (26 ans) et au sergent Itai Yavetz (21 ans). L’incident s’est produit à proximité de la « ligne jaune », démarcation instaurée dans le cadre de la trêve et matérialisant le retrait partiel des forces israéliennes tout en conservant des zones de contrôle. Le message est clair : même au cœur des secteurs passés sous contrôle militaire israélien, la menace continue d’émerger par en dessous.
Cette photographie tranche avec les estimations d’il y a six mois, lorsque l’on évoquait environ un quart du réseau neutralisé. Depuis, l’armée a poursuivi la cartographie, l’obturation et la destruction progressive de galeries, y compris pendant la trêve, ce qui explique les détonations entendues par moments dans l’enclave. Les unités du génie, appuyées par des moyens d’imagerie et de robotique, procèdent par segments : repérage des accès, forage de puits, charges dirigées, effondrement contrôlé et colmatage. Le problème, c’est la profondeur et la redondance : un tronc principal peut desservir une myriade de boyaux, et chaque destruction peut être contournée par une dérivation.
La controverse se cristallise sur le corridor de Philadelphie, le long de la frontière égyptienne. Israël refuse de s’y retirer, invoquant le risque de réactivation des flux de contrebande. Des responsables sécuritaires soulignent qu’un contrôle du corridor, même renforcé, ne suffit pas s’il n’est pas couplé à une neutralisation méthodique des galeries existantes et des zones susceptibles d’en accueillir de nouvelles. L’expérience des cycles précédents a montré que la pression retombe, les trafics mutent, et les axes souterrains reprennent vie si l’écosystème – financement, matériaux, expertise – n’est pas rompu.
Que faut-il attendre ? D’abord, une campagne plus spécialisée : capteurs sismiques, géoradar multi-fréquences, drones filoguidés, chiens du génie, charges creuses et mousses expansives pour colmater. Ensuite, un couplage sécurité-reconstruction : stabiliser les zones traitées (comblements, ouvrages de soutènement) pour éviter les effondrements secondaires et réhabiliter les voiries. Enfin, une coordination politico-sécuritaire : contrôle soutenu du corridor de Philadelphie, pression sur les filières d’approvisionnement (acier, ciment, explosifs, câbles), et dissuasion robuste contre les tentatives de re-creusement.