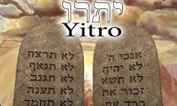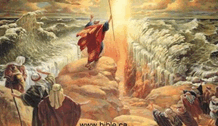Trump fixe une ligne rouge à Israël : pas d’annexion, sinon rupture
La mise en garde est sans ambiguïté. Dans une interview publiée ce jeudi, Donald Trump prévient qu’Israël « perdrait tout le soutien des États-Unis » en cas d’annexion de la Judée-Samarie. L’argument avance deux ressorts : un engagement pris auprès des capitales arabes et la volonté de préserver le cessez-le-feu arraché entre Israël et le Hamas. Autrement dit, Washington lie désormais son soutien politique et militaire à l’abstention de toute démarche d’annexion — une rupture nette avec l’imaginaire de « carte blanche » qu’une partie de la droite israélienne tenait pour acquis.
Le contexte explique la fermeté du ton. Depuis début octobre, un accord en deux phases a stoppé les combats à Gaza, permis la libération des derniers otages vivants contre des prisonniers palestiniens et enclenché un mécanisme d’aide humanitaire et de retrait militaire graduel. Cette architecture fragile s’appuie sur un postulat : la démilitarisation de Gaza à terme. Trump l’a martelé — si le Hamas ne se désarme pas, il sera désarmé. À ce stade, aucun calendrier public n’est fixé, et les « phases » suivantes dépendront autant de l’attitude du Hamas que de la cohésion des alliés arabes autour du plan.
L’épisode de Doha, début septembre, illustre ce rééquilibrage. En visant le leadership politique du Hamas au Qatar, Israël a pris un risque qui a crispé des médiateurs clés. Trump a qualifié cette frappe « d’erreur tactique », mais il l’a retournée en levier : elle a convaincu des acteurs régionaux que l’escalade pouvait déborder Gaza, accélérant les tractations. Le message américain est double : soutien à la sécurité d’Israël, mais discipline stratégique pour consolider la trêve.
Sur l’avenir politique palestinien, Trump navigue avec la même logique de rapport de forces. Interrogé sur l’hypothèse Marwan Barghouti — figure Fatah, emprisonné depuis 2002 et toujours crédité d’une forte popularité — le président américain parle de « question du jour » et dit « prendre une décision ». Rappelons que Barghouti a été condamné à cinq peines de prison à perpétuité pour des meurtres lors de la seconde Intifada ; sa libération est réclamée par certains médiateurs mais redoutée à Jérusalem pour l’effet de galvanisation qu’elle pourrait produire autour de lui. En l’état, l’équation post-guerre est encore ouverte : réforme de l’Autorité palestinienne, rôle transitoire d’un comité technocratique à Gaza, et supervision internationale — Trump évoque même un « conseil de paix » chargé d’orchestrer la reconstruction.
Reste la mise en œuvre. La démilitarisation de Gaza exigera un dispositif de vérification crédible, des garanties régionales et une coordination étroite avec Tsahal pour neutraliser les capacités résiduelles du Hamas. La reconstruction devra s’indexer sur la sécurité : zones stabilisées d’abord, contrôles renforcés des matériaux duals, et financement conditionné au respect des engagements. Quant au dossier cisjordanien, Israël devra faire primer l’intérêt stratégique — consolidé par l’alliance américaine et l’ouverture saoudienne — sur la tentation de gestes symboliques qui braqueraient les partenaires.
Jforum.fr
NDLR : Nous aurions ajouté qu’il n’est pas surprenant que cette « décison » de la Knesset a été prise avec l’aide d’une partie de l’opposition : tout est bon pour eux pour affaiblir le gouvernement actuel, y compris prendre de telles décisions qui peuvent remettre en question tout l’avenir de leur pays ! Tout est bon « contre Bibi » ! C’est honteux.