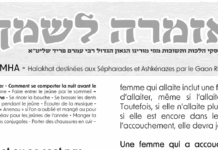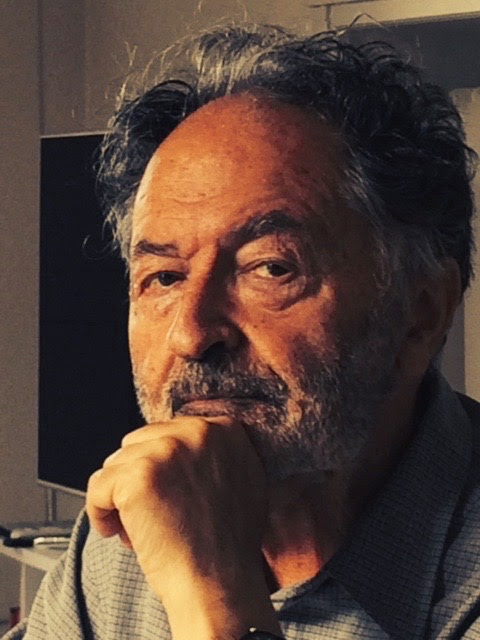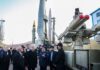Une telle implication témoigne d’un fond idéologique partagé, où l’antisémitisme ne joue pas un rôle secondaire mais structurant, au cœur même de l’architecture mentale des deux systèmes. Cet antisémitisme ne saurait être compris comme un accident ou une réponse circonstancielle à la création d’Israël en 1948. Il est antérieur à la naissance du sionisme politique, et il s’enracine dans une vision du monde où la souveraineté juive est perçue comme un oxymore, une anomalie théologico-politique, une offense faite à un ordre religieux supposé intangible.
À travers cette grille de lecture, le judaïsme vivant et agissant, le judaïsme souverain, devient un scandale, et non plus une simple altérité tolérée sous condition. Le refus de l’État d’Israël ne procède donc pas d’une opposition à une politique donnée, mais bien d’un rejet existentiel de ce que cet État incarne : la persistance d’un peuple que l’histoire aurait dû effacer.
En cela, la haine n’est pas la conséquence d’un conflit : elle est son préalable. C’est pourquoi, dès les origines du conflit israélo-arabe, le discours islamiste s’est structuré autour d’un renversement narratif d’une efficacité redoutable : l’assaillant s’y donne comme victime, la victime comme bourreau.
Ce tour de force rhétorique, qui rappelle les procédés de la propagande totalitaire du XXe siècle, a trouvé une résonance inattendue dans certaines strates des sociétés occidentales. Portées par une culture de la culpabilité postcoloniale, de nombreuses élites intellectuelles se sont prises au piège d’un discours victimaire qui confond faiblesse stratégique et légitimité morale, jusqu’à perdre de vue la nature réelle du projet porté par l’islamisme : non une lutte pour la justice, mais un combat pour l’hégémonie.
Dans ce dessein, le totalitarisme islamiste déploie une stratégie d’une redoutable duplicité. À l’extérieur, il se présente comme le défenseur d’une religion pacifique, soucieuse de dignité humaine et de reconnaissance mutuelle. À l’intérieur, il cultive un discours apocalyptique, millénariste, explicitement destructeur.
Ce double langage n’est pas une contradiction accidentelle : il est une méthode. Il s’agit d’endormir la vigilance des démocraties libérales, toujours promptes à prendre pour sincère toute parole qui se présente sous les habits du droit ou de la souffrance.
Cette stratégie n’est pas sans rappeler celle du nazisme, qui savait envelopper la barbarie de discours rationnels, modernisateurs, et même scientifiques. Le parallèle avec le Völkischer Beobachter, qui décrivait les Juifs comme les « génocidaires des peuples », éclaire d’une lumière crue la mécanique de transposition qu’utilisent les islamistes : Israël devient le monstre, le foyer du mal, la source unique de tous les désordres du monde.
Ainsi préparée, l’opinion est progressivement disposée à envisager, sinon à approuver, une violence légitime contre cet ennemi imaginaire. À ce stade, la violence n’est plus une conséquence, elle devient une condition de possibilité du projet totalitaire. Elle s’exprime à travers une séquence répétitive : attentats ciblés pour semer la peur, négociations feintes pour obtenir des concessions, puis instrumentalisation de ces concessions comme tremplin vers de nouvelles agressions.
En parallèle, un discours victimaire bien rôdé accable l’Occident, accusé d’hostilité à l’islam, d’impérialisme, de racisme systémique. L’intention est claire : substituer à l’explication rationnelle des événements une lecture paranoïaque du monde, où tout échec islamiste devient la preuve d’un complot ourdi par l’Amérique ou par Israël.
Ce qui distingue fondamentalement le totalitarisme islamiste de ses prédécesseurs, c’est sa remarquable capacité d’adaptation à l’environnement démocratique. Loin de se heurter frontalement à nos sociétés, il les infiltre en exploitant leurs failles. Le relativisme culturel, la repentance postcoloniale, le fétichisme de l’altérité et le rejet de toute forme de hiérarchie des valeurs constituent le terreau idéal de son avancée. Dans cette configuration, certaines élites intellectuelles et politiques occidentales deviennent les vecteurs involontaires — parfois même enthousiastes — de ce discours. Fascinées par le radicalisme, soucieuses d’expier les fautes de l’histoire, elles offrent à ce totalitarisme un habit d’emprunt progressiste qui désarme toute critique.
Un paradoxe cruel s’impose alors : les sociétés occidentales commémorent avec solennité les victimes des totalitarismes passés, tout en fermant les yeux sur la menace présente. Elles honorent les morts juifs des siècles antérieurs, tout en tolérant que les juifs vivants soient aujourd’hui désignés à la vindicte sous couvert d’antisionisme.
Cette schizophrénie mémorielle est l’indice d’une fracture plus profonde : celle qui oppose des élites abstraites, coupées des réalités concrètes, à des populations confrontées aux effets tangibles du fanatisme. Tandis que les premières demeurent engluées dans un discours d’excuse, les secondes perçoivent avec une acuité grandissante le péril que constitue l’islamisme, non comme religion, mais comme projet politique d’asservissement.
Toutefois, la réponse à cette menace ne saurait se résumer à une logique répressive. Elle appelle un sursaut intellectuel, une reconquête du sens, un refus lucide du mensonge. Il faut en finir avec le relativisme qui affaiblit la capacité de discernement ; il faut réaffirmer sans ambiguïté les principes fondamentaux qui structurent les sociétés libres : la laïcité, l’égalité, la liberté d’expression, la souveraineté des peuples.
Il faut reconnaître sans détour le droit inaliénable d’Israël à exister comme État juif. Il faut cesser de confondre critique légitime et haine déguisée, et dénoncer pour ce qu’il est le discours islamiste : un totalitarisme nouveau, nourri des ressources de l’ancien, et habillé des langages de la modernité.
En dernière analyse, le combat contre le totalitarisme islamiste est le même que celui qui fut mené, au siècle précédent, contre les totalitarismes rouge et brun. Il est un combat pour la vérité contre le mensonge, pour la liberté contre l’oppression, pour la mémoire contre l’oubli. Et c’est précisément parce qu’il se présente sous les traits de la victime, du colonisé, du dominé, qu’il est plus dangereux encore.
Refuser de le voir, c’est préparer le terrain de sa victoire. S’en remettre à l’évidence, c’est déjà lui opposer un rempart. Le reste est affaire de courage, de clarté et de fidélité à ce que l’histoire a, une fois encore, le devoir de nous enseigner.
© Charles Rojzman