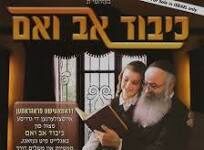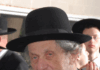Par Charles Rojzman pour Tribune Juive
Pendant que des foules manifestent leur indignation dans les rues du monde entier, pendant que l’accusation de « génocide » fuse à chaque micro, pendant que certains se dressent en défenseurs auto-proclamés du droit et de la morale universelle, une réalité glaçante est passée sous silence : des otages israéliens – femmes, enfants, vieillards, malades – sont encore retenus sous terre par une organisation terroriste.
Beaucoup sont morts. D’autres ont été libérés, brisés, transformés à jamais. Et ceux qui restent ? Effacés. Oubliés. Invisibles. Plus d’une centaine d’êtres humains, pris au piège depuis des mois, sans visite de la Croix-Rouge, sans accès médical, sans nouvelles.
Où sont les cris d’alarme ? Où sont les grandes ONG, les diplomates humanistes, les pancartes, les larmes médiatiques ? Le silence est assourdissant. Comme si certaines vies ne méritaient plus la compassion. Comme si l’innocence avait, elle aussi, une nationalité.
Et pourtant, ces mêmes voix s’étranglent d’indignation chaque jour contre Israël, sommée de cesser immédiatement toute riposte. Une injonction jamais adressée au Hamas, qui continue de tirer, de tuer, de se retrancher derrière les civils.
C’est Israël qu’on accuse de « génocide », pendant que l’organisation qui a déclenché cette guerre, qui a massacré des civils par centaines le 7 octobre, qui l’a revendiquée, filmée, diffusée avec jubilation, bénéficie d’une étrange indulgence, voire d’une fascination.
On nous explique que tout cela s’inscrit dans un « contexte ». Ah, le fameux « contexte »… Celui qui justifie l’horreur, mais dans un seul sens. Celui qui relativise les massacres, les viols, les égorgements, les enlèvements d’enfants, mais jamais les bombardements, même ciblés. Ce « contexte » à géométrie variable, qui permet de présenter une attaque terroriste comme une réponse, et la réponse à cette attaque comme un crime contre l’humanité. Ce deux poids, deux mesures est devenu la norme.
On exige d’Israël qu’il mène une guerre « propre » contre un ennemi qui se terre dans les écoles, les hôpitaux, les mosquées – comme à Raqqa ou Mossoul, sauf qu’alors, les bombardements occidentaux n’ont jamais été qualifiés de « génocide ». On brandit le droit international à chaque frappe israélienne, mais il disparaît quand des civils sont utilisés comme boucliers humains, ou quand des otages sont torturés et exhibés.
Et que dire de cette indignation sélective ? Où étaient ces voix pour les centaines de milliers de morts au Yémen, en Syrie, au Soudan, au Xinjiang ? Pas de marches. Pas de pancartes. Pas d’annulations culturelles. Pas de slogans rageurs.
Serait-ce parce que les bourreaux ne sont pas occidentaux ou juifs ? Faut-il que les victimes correspondent à un récit confortable pour mériter l’indignation ?
Alors de quoi parle-t-on vraiment ? De justice ? De droit international ? De compassion ? Ou bien s’agit-il d’autre chose : d’une haine maquillée, d’un antisémitisme déguisé en antisionisme, d’un militantisme qui a troqué la complexité contre l’idéologie pure ? D’un engagement qui ne s’indigne que lorsque cela sert une cause à la mode ou une posture morale valorisante ? Il est temps de poser la seule question qui vaille : quand l’indignation devient un spectacle, une arme politique, une affaire de camp, peut-elle encore prétendre à la morale ?