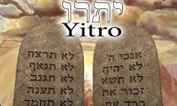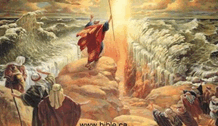Lorsque l’information est lancée, elle peut flamber plus vite qu’un feu de broussailles dans la région aride de Judée‑Samarie. Lundi dernier, la nouvelle est tombée : des « colons radicaux » auraient mis le feu à l’église St‑Georges de Taybeh, un sanctuaire orthodoxe vieux d’un millénaire et demi. La scène, relatée par le patriarche grec Théophile III devant un parterre de dignitaires — parmi lesquels le cardinal latin Pierbattista Pizzaballa et une vingtaine de diplomates étrangers — a immédiatement trouvé un écho mondial. Quelques caméras, un message d’indignation, un coupable tout désigné : la mécanique médiatique était lancée.
En l’espace de quelques heures, les agences internationales titraient sur le prétendu incendie volontaire. La narration paraissait incontestable : des extrémistes juifs auraient voulu réduire en cendres une église historique. S’y ajoutaient des réactions politiques outrées. Mike Huckabee, ex‑gouverneur de l’Arkansas et ambassadeur itinérant des États‑Unis, se rendait sur place dès le quatrième jour, dénonçant un « acte terroriste » et réclamant « de lourdes conséquences ». Dans l’opinion publique, la rumeur se muait déjà en vérité gravée dans le marbre.
Une équipe du Service de presse israélien (TPS‑IL) a pourtant décidé de revoir les images diffusées par la municipalité de Taybeh. Au ralenti, un détail saute aux yeux : les adolescents incriminés portent des gilets fluorescents et manipulent un souffleur, l’équipement habituel… des pompiers volontaires. L’un d’eux, un berger de seize ans, raconte avoir appelé la ferme voisine pour demander de l’aide avant d’être accueilli par des jets de pierres. Leur objectif n’était pas d’allumer le feu, mais de l’étouffer ; en réalité, ce sont les pâturages juifs alentour qui avaient déjà brûlé les 7, 8 et 11 juillet, incidents signalés à la police.
Quand l’image précède l’enquête
Pourquoi ces éléments n’ont‑ils pas filtré dans les dépêches initiales ? Parce qu’ils s’écartent d’un schéma narratif séduisant : « Des colons incendient une église ». Pour Eliana Passentin, archéologue et porte‑parole du Conseil régional de Mateh Binyamin, cette précipitation menace la confiance fragile entre communautés chrétiennes et juives. « On alimente l’hostilité mutuelle et on occulte les véritables actes de vandalisme, qu’ils concernent des églises chrétiennes ou des fermes israéliennes », déplore‑t‑elle dans une vidéo devenue virale.
Amit Barak, spécialiste de l’intégration des Arabes chrétiens dans l’armée israélienne, observe de son côté un déplacement du stigma : « Hier, on accusait “le Juif” ; aujourd’hui, c’est “le colon”. L’étiquette change, le réflexe demeure. »
Retour à la réalité
La police israélienne a finalement publié ses premières conclusions : l’église n’a jamais été touchée ; l’incendie provient d’un terrain voisin et l’enquête se poursuit pour déterminer s’il s’agit de négligence ou d’un acte malveillant. L’édifice millénaire, lui, reste intact. Devant ces faits, certains responsables politiques ont discrètement nuancé leurs déclarations. Huckabee, sur X/Twitter, précise désormais qu’il « condamne l’incendiaire, quel qu’il soit ». Une volte‑face trop tardive : la rectification se propage rarement aussi vite que la sensation.
Cette affaire illustre les risques d’un journalisme qui s’appuie davantage sur le retweet que sur la vérification. Les conséquences dépassent la simple erreur factuelle : elles rigidifient les positions diplomatiques, nourrissent les rancœurs et détournent l’attention des véritables persécutions auxquelles les chrétiens de la région peuvent être confrontés, notamment au sein de l’Autorité palestinienne où les expropriations de terres ecclésiales sont bien documentées.
Une leçon durable
Les pierres calcaires de Taybeh ont résisté aux flammes ; la réputation, elle, reste plus vulnérable. La prochaine fois qu’une vidéo spectaculaire semblera confirmer vos pires soupçons, souvenez‑vous : le calcaire ne brûle pas… mais la vérité, oui, lorsqu’elle est abandonnée aux braises de la précipitation.