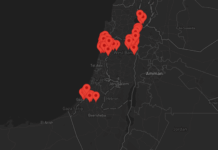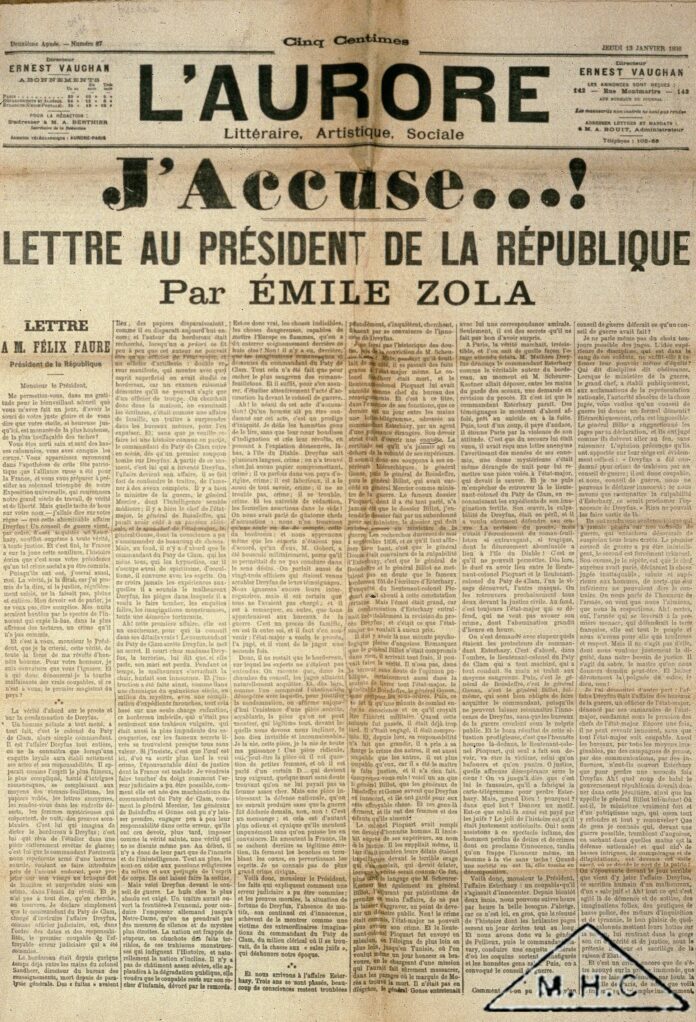Il est des moments dans l’histoire où le silence est coupable, et où la prudence devient une forme de lâcheté. Des moments où l’on ne peut plus se contenter de demi-mots, de formules diplomatiques ou de rhétoriques feutrées. Car alors, c’est l’avenir même de la République qui se joue, et avec lui la sécurité de centaines de milliers de ses enfants.
Nous vivons aujourd’hui un de ces moments. La France est à la croisée des chemins : affaiblie politiquement par des institutions paralysées, minée économiquement par une dette et une désindustrialisation chronique, fracturée socialement par des colères qui s’additionnent, elle se trouve de nouveau confrontée à un poison que l’on croyait endigué. Ce poison a un nom : l’antisémitisme.
Or, ce qui rend la situation actuelle plus grave encore, c’est que ce poison n’est pas seulement le fruit d’agressions isolées, d’extrémismes marginaux ou de groupuscules haineux. Il est aujourd’hui nourri, entretenu, et parfois même légitimé par ceux-là mêmes qui devraient en être les premiers adversaires. Quand la parole politique se fait équivoque, quand elle se pare du masque commode de l’“antisionisme” pour tolérer des attaques qui visent en réalité les Juifs de France, c’est l’État lui-même qui devient un catalyseur du venin antisémite.
C’est pourquoi il faut aujourd’hui retrouver le courage de Zola, ce courage de dire « J’accuse », non contre un officier ou un tribunal militaire, mais contre le plus haut représentant de l’État. J’accuse Emmanuel Macron d’avoir failli dans son devoir de garant de l’unité nationale.
J’accuse Emmanuel Macron d’avoir introduit, par ses ambiguïtés, ses postures diplomatiques et ses silences complices, un climat délétère où l’antisémitisme prospère à nouveau, masqué sous les habits d’une indignation sélective.
Certains objecteront qu’il s’agit là d’exagérations, que jamais un président de la République n’oserait franchir le pas de l’antisémitisme explicite. Mais l’histoire, justement, nous apprend que la menace ne vient pas seulement des mots directs et brutaux, mais d’abord des insinuations, des relativisations, des “glissements” successifs qui banalisent l’inacceptable. C’est toujours ainsi que l’histoire commence à bégayer : par un climat, une atmosphère, une tolérance accrue à ce qui autrefois aurait provoqué scandale et indignation.
Nous y sommes. Chaque fois que le chef de l’État prend la parole sur Israël, chaque fois qu’il commente le Proche-Orient, il distille un double langage : d’un côté des déclarations générales contre “toutes les haines”, de l’autre des attaques répétées contre l’État juif, présentées comme une exigence morale. Et ce double discours est interprété, reçu, relayé par une société déjà fragilisée comme un blanc-seing pour attaquer, suspecter, ostraciser.
L’histoire française est là pour nous avertir. Les mêmes logiques ont produit les mêmes catastrophes. L’Affaire Dreyfus, hier, a montré comment un pays entier pouvait se fracturer sur la question de la loyauté supposée des Juifs. Vichy, plus tard, a révélé comment un État en faillite politique et militaire pouvait basculer dans la compromission morale la plus ignoble, livrant ses propres citoyens à l’ennemi. Croire que notre République actuelle serait immunisée contre ces dérives relève d’une dangereuse naïveté.
C’est pourquoi, aujourd’hui, il faut nommer les choses : le président de la République, Emmanuel Macron, porte une responsabilité directe dans la résurgence d’un climat antisémite en France. Il n’en est pas l’inventeur, certes, mais il en est devenu le catalyseur. Et c’est précisément parce que l’Histoire ne doit pas se répéter, pas une troisième fois, qu’il est urgent de l’affirmer sans détour : la République doit se défendre, et le devoir de résistance commence ici.
Le vieux poison recyclé : la double allégeance
Il est des accusations qui traversent les siècles comme des spectres. Elles changent de forme, elles se parent de nouveaux mots, mais elles demeurent intactes dans leur fond : toujours prêtes à resurgir quand une société s’affaisse et cherche un bouc émissaire. L’accusation de « double allégeance » en est l’exemple le plus tragique.
Dès l’Affaire Dreyfus, cette arme rhétorique avait été utilisée pour dépeindre les Juifs comme suspects par essence, incapables d’une fidélité entière à la France. Le capitaine Dreyfus n’était pas seulement accusé d’espionnage : il était accusé de trahir parce qu’il était juif, parce que son identité rendait suspecte sa loyauté. Cette logique infâme avait déjà contaminé l’opinion et fracturé le pays.
Sous Vichy, elle devint doctrine d’État. Le régime pétainiste, loin de se contenter de subir l’occupation allemande, inventa sa propre législation antisémite. Les Juifs furent exclus non pas pour ce qu’ils avaient fait, mais pour ce qu’ils étaient, avec comme justification implicite qu’ils n’étaient jamais pleinement français. C’était là la mise en acte politique de l’accusation de double allégeance : une France amputée de ses enfants, au nom d’une loyauté prétendument impossible.
Et voici que ce spectre, que l’on croyait définitivement exorcisé, refait surface. Pas dans les tracts jaunis d’un Drumont ou les éditoriaux haineux des années 30, mais dans la bouche de responsables politiques contemporains, parfois au cœur même des institutions. Lorsque Jean-Louis Bourlanges, ancien président de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, déclare que « les Juifs français sont largement solidaires de la politique israélienne », il ne fait pas qu’exprimer une opinion : il réactive un vieux cliché meurtrier. Car sous- entendre que les Juifs de France devraient « prendre leurs distances » avec Israël pour ne pas nourrir l’antisémitisme, c’est implicitement les déclarer responsables des haines qu’ils subissent.
Que le président de la République n’ait pas immédiatement et vigoureusement condamné de tels propos est un signe glaçant. Car le silence est ici une complicité. Laisser passer cette accusation, c’est l’accréditer. Et dans un climat où la suspicion est déjà lourde, c’est jeter de l’huile sur le feu.
On dira : « Mais il ne s’agit pas d’antisémitisme, seulement d’une critique politique ». Quelle hypocrisie ! Depuis plus d’un siècle, la critique politique d’Israël, hier de « l’influence juive », a toujours servi de masque à la même mise en accusation collective. Derrière le discours policé se cache la même idée : les Juifs sont trop liés à Israël pour être pleinement français. Et cette idée, si elle s’ancre à nouveau dans le discours public, est le signe avant-coureur d’un retour de l’antisémitisme d’État.
Car l’accusation de double allégeance n’est pas une opinion ; c’est une arme. Une arme qui déstabilise, qui isole, qui fait peser un soupçon permanent sur les citoyens visés. Elle instille l’idée qu’ils doivent sans cesse prouver leur loyauté, se justifier, se dissocier, se disculper. En cela, elle nie leur citoyenneté pleine et entière.
Et c’est précisément pourquoi la responsabilité du chef de l’État est immense. Emmanuel Macron, garant de l’unité de la nation, aurait dû dresser un rempart immédiat et absolu contre cette rhétorique. Il aurait dû proclamer haut et fort que la République ne reconnaît qu’une seule allégeance : celle à la France, commune à tous ses citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs croyances, ou leurs affinités personnelles. Il aurait dû rappeler que le lien spirituel ou affectif avec Israël n’est pas une trahison, mais une part de la pluralité française, aussi légitime que l’attachement d’autres citoyens à d’autres terres d’origine tel celui des chrétiens au Vatican ou des musulmans à La Mecque.
Au lieu de cela, le silence a prévalu. Et ce silence est terrible. Car il signifie que le vieux poison n’est plus seulement une relique du passé, mais un venin qui circule à nouveau dans les veines de la République.
De la complaisance à la complicité : Macron et ses alliés politiques
On dit parfois que l’histoire se répète d’abord comme tragédie, puis comme farce. Mais dans ce cas précis, ce n’est ni l’une ni l’autre : c’est une compromission. Une compromission insidieuse, qui prend la forme de silences, de demi-mots, de complaisances accordées à des forces politiques dont le discours n’est plus ambigu, mais frontalement hostile.
Le paysage politique français a vu émerger ces dernières années une gauche radicale, incarnée par La France Insoumise, dont les leaders n’hésitent plus à franchir des lignes que l’on croyait infranchissables. Leur rhétorique sur Israël n’est pas celle d’une critique raisonnée des politiques d’un gouvernement : c’est une diabolisation systématique, un récit univoque où l’État juif incarne le mal absolu. À travers leurs mots, Israël n’est plus un pays ; il devient une entité démoniaque, coloniale, raciste, illégitime par essence. Le Juif étatisé !
Et lorsque cette vision imprègne les slogans de manifestations où l’on brandit le drapeau palestinien comme un étendard de lutte universelle, elle finit par glisser inévitablement vers l’hostilité envers les Juifs de France. Car le raccourci est simple : si Israël est illégitime, alors ceux qui l’aiment, qui le soutiennent ou simplement qui s’en sentent proches deviennent eux- mêmes suspects, illégitimes, coupables par association.
Face à cette dérive, qu’a fait Emmanuel Macron ? Rien, ou si peu. Certes, il condamne parfois des excès. Mais jamais il ne trace la ligne rouge claire qui sépare la critique politique de la haine raciale. Jamais il ne nomme LFI comme porteur d’un discours qui nourrit l’antisémitisme. Jamais il ne stigmatise les rassemblements où la haine d’Israël se transforme en slogans meurtriers contre les Juifs.
Pire : par calcul politique, il ménage ces forces. Tantôt en cherchant à les instrumentaliser contre d’autres adversaires, tantôt en feignant d’ignorer leurs outrances pour éviter d’ouvrir un front supplémentaire. Cette stratégie de “réalisme politique” est en vérité une capitulation morale. Car en politique, ce que l’on ne condamne pas, on le tolère ; et ce que l’on tolère, on le légitimise.
On se souvient de la fameuse “flottille” soutenue par des élus français proches de la gauche radicale, initiative soi-disant humanitaire mais en réalité conçue comme un défi médiatique et politique à Israël. Qu’un président de la République ne condamne pas explicitement la participation de parlementaires français à une telle mascarade en dit long. Ce silence n’est pas neutre : il accrédite l’idée que la République ferme les yeux sur une alliance entre élus de la nation et mouvements qui frôlent l’antisémitisme.
C’est là que la complaisance devient complicité. Emmanuel Macron n’est pas un simple spectateur impuissant : il est le chef de l’État, garant de la cohésion nationale. En tolérant ces dérapages, il envoie un signal terrible : celui que l’antisionisme radical, même porteur d’antisémitisme, est un langage acceptable dans le débat public.
Or, c’est exactement ce mécanisme qui, hier, avait permis la banalisation progressive de discours de haine, jusqu’à ce qu’ils deviennent politiquement dominants. Aujourd’hui, les mêmes ingrédients sont réunis : une crise sociale profonde, une classe politique divisée. Et en cela, il est passé du côté de la complicité.
De la complicité à l’implication
On pourrait croire qu’Emmanuel Macron se contente de se taire, de fermer les yeux, d’éviter le sujet par calcul politique. Ce serait déjà une faute. Mais la vérité est plus grave : il ne se contente pas de la complaisance, il est passé à l’implication. Il n’est plus seulement complice par ses silences, il est catalyseur par ses paroles et ses actes.
La liste de ses prises de position nauséeuses est longue, trop longue pour être réduite à des maladresses. On se souvient de ce mot ignoble du « massacre inacceptable », qui plaçait sur le même plan les pogroms terroristes du 7 octobre et la riposte légitime d’Israël. On se souvient de cette phrase méprisante sur la création d’Israël par un « acte notarié », comme si l’existence même de l’État juif était une anomalie juridique plutôt qu’un droit imprescriptible de l’histoire et du peuple juif. On se souvient de ses allusions perfides à la « double allégeance » supposée des Français juifs, de ses doutes sur leur « universalisme » trop particulier, de ses insinuations sur le poids d’Israël dans leur identité.
Et que dire de son geste le plus lourd de conséquences : la reconnaissance d’un État palestinien qui n’a ni frontières, ni institutions stables, ni volonté réelle de paix. Un cadeau offert de facto au Hamas et à ses parrains idéologiques, présenté comme un acte de justice, mais vécu comme une trahison par ceux qui savent combien ce geste alimente la propagande antisémite mondiale.
Non, Macron n’est pas neutre. Il ne se contente pas de regarder ailleurs. Il souffle sur les braises, il met de l’huile sur le feu. À force de vouloir donner des gages à tous — aux islamistes, aux gauchistes antisionistes, aux contempteurs obsessionnels d’Israël — il a choisi son camp : celui de l’ambiguïté calculée qui se transforme en complicité active.
Et il y a plus : les inspirations de ses discours ne sont pas invisibles. Comment ne pas voir l’empreinte idéologique de ses « conseillers » et fréquentations douteuses ? Yassine Bellatar, figure islamiste autoproclamée, et Ofer Bronstein, ce « Besancenot israélien » gauchiste et antisioniste notoire, ont servi de relais et d’influences dans ses choix et ses paroles. En s’entourant de tels personnages, Macron a légitimé des discours qui n’auraient jamais dû franchir le seuil de l’Élysée.
Jusqu’à son refus de participer à une grande marche contre l’antisémitisme, au prétexte d’avoir à « représenter tous les Français » – donc y compris les antisémites. Cette décision n’était pas seulement une erreur, elle fut une gifle, une insulte à la mémoire, une capitulation morale.
Comme si, face à l’horreur, la neutralité était possible ; comme si, face au poison antisémite, le rôle du chef de l’État était de se taire au nom d’un prétendu équilibre.
La vérité est là : Emmanuel Macron ne fait pas qu’endurer l’antisémitisme ambiant, il le nourrit. Il ne fait pas qu’être passif, il agit en catalyseur actif. Il ne se contente pas d’être complice : il est impliqué.
On ne naît pas antisémite, on le devient
Il serait trop facile de dire qu’Emmanuel Macron n’est qu’un complice des antisémites. Non : il est allé plus loin. Emmanuel Macron est devenu antisémite. Et il faut avoir le courage de le dire.
On ne naît pas antisémite : on le devient. L’histoire le prouve. Proudhon, Céline, Hitler — autant d’exemples d’hommes qui, confrontés à leurs frustrations, à leurs échecs ou à leur haine de soi, ont projeté cette rancœur sur les Juifs, désignés comme cause extérieure de leur chute intérieure. L’antisémitisme n’est pas d’abord un phénomène exogène, produit par l’influence d’autrui ; il est endogène, il naît de l’aigreur, du ressentiment, du besoin d’évacuer ses propres fautes en les attribuant à un autre.
Macron illustre tragiquement ce mécanisme. Au départ, il se voulait le président de la réussite, du dépassement, du génie individuel. Il croyait incarner une intelligence supérieure, une modernité politique. Mais les échecs se sont accumulés : échec social avec les gilets jaunes, échec politique avec une majorité introuvable, échec économique avec une dette abyssale, échec diplomatique avec une France marginalisée. Tous ses compagnons de route ont fini sacrifiés : Collomb, Philippe, Castex, Borne… à chaque fois, il a flingué les fusibles pour reporter la faute.
Mais après avoir brûlé toutes ces cartouches, il ne restait plus qu’un dernier coupable à désigner : les Juifs. Non pas directement, bien sûr, mais par la rhétorique classique de l’antisionisme, de la double allégeance, de l’universalisme dévoyé. Car c’est ainsi que l’antisémitisme se dit aujourd’hui : jamais frontal, toujours masqué, mais tout aussi réel.
Écoutez ses paroles. Ce « massacre inacceptable » qui met sur le même plan victimes et bourreaux. Cet Israël réduit à un « acte notarié », comme si son existence n’était qu’un artifice juridique. Cette suspicion à l’égard de la « double allégeance » des Juifs français, comme si leur loyauté était douteuse. Ce « manque d’universalisme » qu’il leur impute, comme si leur identité était une tache dans le grand récit républicain. Et enfin, ce cadeau empoisonné au Hamas : la reconnaissance d’une Palestine sans frontières ni institutions, un État fantôme offert comme trophée symbolique aux ennemis d’Israël.
Et n’oublions pas le plus emblématique : son refus de participer à une marche contre l’antisémitisme, au prétexte qu’il devait « représenter tous les Français » – donc y compris les antisémites. Ce choix n’était pas une maladresse, mais un aveu : Macron ne voulait pas être vu du côté des victimes, de peur de froisser les bourreaux.
Ce faisceau n’est pas accidentel. Il n’est pas le simple fruit de mauvais conseillers comme Yassine Bellatar ou Ofer Bronstein, même si leurs influences sont évidentes. Non, ce faisceau révèle une transformation intime : Macron, miné par ses échecs, prisonnier de son ego blessé, incapable d’assumer ses fautes, a eu besoin de reporter sa haine de soi sur une cible extérieure. Et comme toujours dans l’histoire, cette cible fut le Juif.
Oui, Macron est devenu antisémite. Pas par idéologie, pas par héritage, mais par décomposition morale. Il est un antisémite de circonstance, un antisémite de pouvoir, mais pour cette raison même, il est le plus dangereux. Car un antisémite au pouvoir a les moyens de banaliser, d’amplifier, de légitimer la haine. Et c’est ce qui rend sa présidence non seulement un échec politique, mais un danger historique.
Du barrage républicain au marchepied : Macron révélateur de Marine Le Pen
En 2017 comme en 2022, Emmanuel Macron a été élu sur un slogan aussi simple qu’implacable : « Faire barrage à Marine Le Pen ». Toute sa légitimité électorale, toute sa posture morale reposaient sur cette idée : il incarnait la République qui protège, face à l’extrême droite qui menace. Il s’est présenté comme le rempart ultime, l’ultime garant contre le retour du spectre de l’antisémitisme politique.
Or, l’histoire récente a produit un paradoxe saisissant : Emmanuel Macron, loin de constituer un barrage, est devenu le meilleur marchepied de Marine Le Pen. Par ses échecs politiques, il a nourri la colère populaire. Par ses ambiguïtés morales, il a révélé un phénomène plus profond encore : que Marine Le Pen, honnie et diabolisée depuis des décennies, pouvait apparaître non pas comme un danger, mais comme une chance pour les Français, et ironie du sort, tout particulièrement pour les français juifs.
Car en face du président qui tolère les antisionistes, qui banalise les accusations de double allégeance, qui se montre complaisant avec l’islamisme politique, Marine Le Pen a choisi une autre voie : celle de la rupture avec l’antisémitisme historique de son propre camp. Elle a rompu avec l’héritage paternel, exclu les négationnistes, condamné fermement l’antisémitisme, affiché un soutien clair à Israël. En somme, elle a travaillé à apparaître comme un bouclier là où Macron, lui, s’est comporté en révélateur de collaboration morale.
Ce n’est pas seulement une dynamique politique, c’est une inversion morale. Macron, censé représenter la République protectrice, est devenu celui qui banalise la haine. Marine Le Pen, censée incarner le danger historique, est devenue, par contraste, une figure de résistance, une alternative crédible et, pour beaucoup de Juifs français, une garantie de protection.
Il faut oser le dire : Emmanuel Macron a provoqué cette mutation. En se présentant comme le rempart, il a révélé qu’il n’était que le marchepied. En prétendant protéger les Juifs de France, il a révélé que son cynisme les mettait en danger. Et en affaiblissant la République par ses compromissions, il a donné à Marine Le Pen le rôle inattendu de représenter non plus la menace, mais la résistance face à la collaboration.
Vichy en filigrane : un remake historique ?
On aime à se rassurer en disant que « plus jamais ça ». Comme si les tragédies du passé vaccinaient à jamais les sociétés contre la répétition des mêmes fautes. Comme si l’ombre de Vichy ne pouvait être qu’un souvenir figé, un repoussoir commode pour exalter la vertu républicaine. Pourtant, l’histoire est plus cruelle : elle ne se répète jamais à l’identique, mais elle bégaie. Les mécanismes se recomposent, les formes se modernisent, mais la logique reste la même.
Que fut Vichy, sinon l’exemple parfait d’un État qui, après un effondrement politique et militaire, choisit la compromission morale comme stratégie de survie ? En 1940, la débâcle n’explique pas seulement la capitulation militaire : elle explique la tentation de détourner la colère du peuple vers un ennemi intérieur. En livrant les Juifs de France, Pétain et Laval ne se contentaient pas d’obéir aux nazis : ils inscrivaient dans la loi une vision qui faisait des Juifs des citoyens suspects, étrangers dans leur propre pays.
Aujourd’hui, bien sûr, nous ne sommes pas en 1940. Mais les mécanismes que nous voyons à l’œuvre rappellent, en filigrane, cette mécanique fatale. Une France fracturée, un État affaibli, un président en perte d’autorité. Et face à l’impuissance à régler les crises économiques et sociales, la tentation de désigner, encore une fois, un bouc émissaire commode.
La modernité ne change rien à la logique. Ce ne sont plus des lois raciales votées à Vichy, ce sont des discours insinués dans la bouche de responsables politiques, relayés dans les médias et tolérés par les plus hautes autorités. Ce ne sont plus des rafles dans la nuit, mais des suspicions collectives, des amalgames insinués, des accusations de « double allégeance » qui circulent sans être dénoncées. Mais dans les deux cas, le résultat est le même : fragiliser la citoyenneté des Juifs de France, les isoler, les désigner implicitement comme « autres ».
Il serait naïf de croire que les formes du passé doivent se répéter à l’identique pour que le danger soit réel. Le vrai enseignement de Vichy est ailleurs : il nous rappelle que quand l’État abdique moralement, quand il renonce à protéger tous ses citoyens sans distinction, alors il devient le vecteur d’un antisémitisme d’État. Pas nécessairement par la persécution ouverte, mais par la banalisation des discours, par la tolérance des préjugés, par le refus de nommer et de combattre.
Et c’est précisément ce que nous voyons aujourd’hui. Emmanuel Macron n’est pas Pétain, mais la logique est la même : détourner la colère, laisser prospérer des discours hostiles, sacrifier une minorité pour préserver un semblant d’équilibre politique. Voilà pourquoi l’évocation de Vichy n’est pas une outrance rhétorique, mais une mise en garde salutaire.
Ce que nous voyons, c’est un remake en filigrane : non pas les décrets raciaux de 1940, mais une complaisance d’État qui fragilise les Juifs de France. Non pas la déportation, mais l’isolement. Non pas la capitulation militaire, mais la capitulation morale. Et c’est ce parallèle qui doit nous alerter : l’Histoire ne revient jamais avec les mêmes habits, mais elle revient toujours avec les mêmes logiques.
L’inversion accusatoire : un mécanisme pervers
Il existe une constante dans l’histoire de l’antisémitisme : il ne se présente jamais comme une haine assumée, mais toujours comme une « réaction ». Ceux qui la propagent se posent rarement en bourreaux ; ils se drapent en victimes, en justiciers, en moralistes. Et pour donner un vernis de légitimité à leur haine, ils recourent à un procédé rhétorique imparable : l’inversion accusatoire.
Ce mécanisme pervers consiste à accuser les Juifs d’être responsables de la haine qu’ils subissent. Dans l’Affaire Dreyfus, on disait déjà : si la France se divise, c’est parce que « les Juifs » imposent leur présence dans l’armée et veulent dominer la République. Sous Vichy, la propagande pétainiste prétendait que les Juifs avaient « provoqué » la défaite, qu’ils incarnaient la décadence morale de la France. Et aujourd’hui, ce même raisonnement revient, à peine remaquillé : si l’antisémitisme croît en France, ce ne serait pas la faute des agresseurs, mais de la communauté juive elle-même, accusée d’être « trop solidaire » d’Israël, d’« entretenir la haine » par son refus de se dissocier de l’État juif.
C’est exactement ce qu’ont laissé entendre certains responsables politiques, en expliquant que les Juifs français devraient « prendre leurs distances » avec la politique israélienne pour apaiser les tensions. Mais que signifie un tel raisonnement, sinon ceci : « Si vous êtes attaqués, c’est que vous l’avez bien cherché » ? C’est le renversement le plus ignoble qui soit: transformer les victimes en coupables, et donner aux bourreaux une excuse morale.
Ce procédé est d’autant plus dangereux qu’il est subtil. Il ne s’exprime pas toujours dans les cris des extrémistes, mais dans les phrases feutrées des élites. Il se cache derrière un ton professoral, une analyse « équilibrée », une pseudo-neutralité qui consiste en réalité à déplacer la responsabilité du côté des opprimés. L’inversion accusatoire n’est pas seulement un mensonge ; c’est une arme psychologique. Elle isole la communauté visée, la contraint à se justifier en permanence, la pousse à se disculper, tout en renforçant le discours des agresseurs.
Et Emmanuel Macron, loin de briser ce cercle vicieux, l’entretient par ses silences et ses ambiguïtés. Car quand le chef de l’État ne condamne pas avec force de telles affirmations, quand il laisse s’installer l’idée qu’une partie de ses concitoyens est comptable des choix d’un gouvernement étranger, il accrédite cette inversion. Son devoir était de dire : « Les Juifs de France ne doivent rien prouver. Leur loyauté n’est pas à démontrer. Ils sont des citoyens français, point final. » Mais il n’a pas eu ce courage.
Il faut rappeler avec force : ce ne sont jamais les Juifs qui produisent l’antisémitisme. Ce sont les antisémites. De même que ce ne sont pas les victimes qui engendrent la violence, mais les bourreaux qui la perpétuent. Toute autre lecture est un mensonge, une lâcheté, une abdication morale.
Voilà pourquoi l’inversion accusatoire est le signe avancé d’une société en perdition : elle révèle que la haine a réussi son travail, qu’elle a contaminé non seulement les masses, mais aussi les élites, au point que celles-ci reprennent à leur compte, par réflexe ou par calcul, le discours des agresseurs. Et ce signe, aujourd’hui, est là, sous nos yeux.
La responsabilité personnelle de Macron
Un président de la République n’est pas un citoyen comme un autre. Ses mots ne flottent pas dans l’air comme ceux d’un éditorialiste ou d’un député d’opposition : ils sont gravés dans la conscience nationale, relayés par les médias, amplifiés par les réseaux sociaux, interprétés par les diplomaties étrangères, scrutés par les communautés. Chaque mot pèse. Chaque silence aussi.
Emmanuel Macron le sait mieux que quiconque : il est passé maître dans l’art de la communication. Tout chez lui est calculé, scénarisé, pensé pour envoyer un signal. Or, depuis plusieurs années, les signaux qu’il envoie sur Israël et, indirectement, sur les Juifs de France, sont des signaux de suspicion et d’hostilité. Il ne parle jamais d’Israël sans insister sur ses fautes supposées. Il ne commente jamais la situation au Proche-Orient sans rappeler, sur un ton professoral, les « responsabilités » de l’État juif. Et ce faisant, il crée une atmosphère où l’on finit par penser que si l’antisémitisme prospère, c’est qu’Israël – et donc, par extension, les Juifs – en portent la responsabilité.
Ce n’est pas seulement une faute politique, c’est une faute morale. Car un président de la République n’a pas le droit de jouer avec ce feu. Il n’a pas le droit d’ajouter de l’ambiguïté là où seule une parole claire et ferme devrait exister. Il n’a pas le droit de laisser entendre que ses concitoyens juifs doivent se justifier de leur attachement à Israël pour mériter d’être pleinement français.
On pourrait objecter que d’autres avant lui ont tenu des propos plus violents, que ses mots ne sont « pas si graves ». Mais c’est précisément cela qui les rend plus dangereux. Quand l’extrême droite éructe, la République se cabre. Quand un président glisse, insinue ou relativise, la République chancelle. Car c’est la fonction suprême qui normalise la dérive.
Emmanuel Macron ne peut pas ignorer le poids de sa charge. Quand il parle, il engage non seulement la France, mais la sécurité de ceux qu’il devrait protéger. En tolérant l’inversion accusatoire, en ménageant les antisionistes radicaux, en critiquant Israël sans jamais défendre avec la même force les Juifs de France, il envoie un message : « Vos souffrances sont secondaires, vos inquiétudes sont exagérées, vos plaintes sont suspectes ».
Ce message, il ne l’a peut-être jamais prononcé explicitement. Mais en politique, le non-dit pèse parfois plus que la parole. Et c’est ainsi que se fabrique un climat : par accumulation d’ambiguïtés, de silences, de demi-condamnations, jusqu’à ce que la frontière entre légitimité et haine se brouille complètement.
C’est pourquoi la responsabilité d’Emmanuel Macron est immense. Il n’est pas seulement un président qui échoue à redresser l’économie ou à réformer l’État. Il est devenu un président qui échoue à préserver la morale républicaine. Et cet échec-là est plus grave encore que les autres, car il met en danger la vie même de citoyens français.
L’effondrement politique et social, prélude à l’abandon moral
L’Histoire nous enseigne une loi tragique : lorsqu’un régime chancelle, lorsqu’il échoue à tenir ses promesses, lorsqu’il n’a plus ni vision économique ni autorité politique, il cherche presque toujours une échappatoire. Cette échappatoire, c’est l’abandon moral. Et le signe avant-coureur de cet abandon est presque toujours le même : l’antisémitisme.
Pourquoi ? Parce que l’antisémitisme est le plus ancien, le plus commode et le plus « disponible » des boucs émissaires. Il traverse les siècles, se réinvente dans ses formes, mais offre toujours le même avantage cynique aux gouvernants : détourner la colère d’un peuple. Hier, les Juifs étaient accusés d’empoisonner les puits lors des épidémies, d’être responsables des crises économiques, d’incarner la décadence morale. Aujourd’hui, ils sont accusés de nourrir la haine par leur lien avec Israël, de « monopoliser la mémoire », ou encore d’être solidaires d’un État dont la politique est diabolisée. Le schéma est identique.
Regardons la France d’aujourd’hui. Échec politique : un président sans majorité parlementaire, incapable de gouverner sans artifices constitutionnels. Échec économique : une dette publique abyssale, un chômage structurel, une inflation persistante qui ronge la classe moyenne. Échec social : un pays fracturé en quatre blocs irréconciliables, où la confiance dans les institutions s’effondre et où la rue est devenue le théâtre permanent de la colère.
Dans ce contexte, la tentation est immense : détourner le regard de ces échecs en désignant un « autre » sur qui reporter la frustration collective. Et quel « autre » est plus pratique que le Juif ? Car la haine antisémite ne demande pas à être inventée, elle dort toujours dans les recoins de la société, prête à être réveillée par quelques mots, quelques silences, quelques complaisances.
Hier, après la débâcle militaire de 1940, Vichy a trouvé son bouc émissaire dans les Juifs, accusés d’être responsables de la décadence française. Aujourd’hui, après la débâcle politique et sociale d’Emmanuel Macron, les mêmes mécanismes s’esquissent. La rhétorique de la « double allégeance », la complaisance envers les slogans antisionistes, le silence face aux dérapages de ses alliés : tout cela prépare le terrain à un nouvel abandon moral.
Et il faut le dire avec force : ce n’est pas une fatalité. Mais c’est une pente. Une pente dangereuse, que l’Histoire connaît bien : la crise appelle l’abandon moral, et l’abandon moral se manifeste toujours d’abord par l’antisémitisme. Car s’en prendre aux Juifs, c’est toujours, pour un régime en crise, l’option la plus facile.
Emmanuel Macron n’est pas le premier chef d’État en échec. Mais il est en train de devenir le premier président de la Ve République dont l’impuissance politique et l’échec économique se traduisent par une complaisance envers le poison antisémite. Et cela, c’est une ligne rouge historique.
Conclusion – Résister à l’histoire qui bégaie
L’histoire de France, comme celle de l’Europe, est jalonnée de promesses non tenues et de faillites morales. Chaque fois qu’un régime s’est effondré sous le poids de ses contradictions, il a cherché à survivre en sacrifiant une partie de ses enfants. Chaque fois que la République a faibli, l’antisémitisme a resurgi, plus fort, plus violent, plus banal. Et chaque fois, on a juré que cela ne se reproduirait plus.
Nous en sommes là, à nouveau. Le climat actuel ne laisse guère de doute : un pouvoir à bout de souffle, incapable de redonner espoir, choisit la fuite en avant. Cette fuite en avant n’est pas seulement économique ou politique ; elle est morale. Elle consiste à tolérer, sous couvert d’antisionisme, des propos et des attitudes qui fragilisent directement les juifs de France. Elle consiste à fermer les yeux sur l’inversion accusatoire, sur les complaisances de certains alliés, sur les dérapages assumés de responsables politiques qui ont trouvé dans la haine d’Israël une nouvelle identité.
C’est là que la comparaison avec Vichy, si souvent jugée excessive, retrouve toute sa pertinence. Non, nous ne vivons pas en 1940. Mais oui, nous voyons à nouveau l’État céder à une tentation mortelle : détourner la colère du peuple vers un bouc émissaire. Hier, c’était la « trahison » inventée des Juifs accusés de double loyauté. Aujourd’hui, ce sont les Juifs français sommés de se dissocier d’Israël pour ne pas « nourrir » l’antisémitisme. Le décor a changé, les acteurs aussi. Mais la mécanique, elle, est la même.
Et face à cette mécanique, le silence est coupable. L’indifférence est une faute. L’oubli constitue un crime. Ceux qui se taisent aujourd’hui, ceux qui relativisent, ceux qui tolèrent, seront demain comptables de la répétition de l’histoire. Car l’Histoire ne revient pas toujours avec des bottes et des uniformes : elle revient parfois avec des discours feutrés, des ambiguïtés diplomatiques et des calculs électoraux.
C’est pourquoi nous devons le dire solennellement : l’Histoire ne doit pas se répéter, pas une troisième fois. Nous ne nous laisserons pas faire. La Résistance – cela commence aujourd’hui.
Résister, ce n’est pas seulement se souvenir. C’est nommer les choses. C’est refuser l’inversion accusatoire. C’est exiger de nos dirigeants qu’ils parlent clair et qu’ils protègent, sans équivoque, tous les citoyens français. C’est dénoncer, haut et fort, la complaisance d’un président qui a choisi l’ambiguïté au lieu du courage.
Résister, c’est rappeler que la République, si elle ne défend pas tous ses enfants, cesse d’être la République. C’est refuser que la faillite politique et économique d’un régime devienne le prétexte à une faillite morale. C’est rappeler, inlassablement, que les Juifs de France ne doivent rien prouver, rien justifier, rien concéder : ils sont la France.
Alors oui, aujourd’hui, il faut retrouver la voix de Zola et dire : J’accuse. J’accuse Emmanuel Macron d’être devenu, par ses silences, ses ambiguïtés et ses compromissions, le catalyseur de l’antisémitisme en France. J’accuse l’État de trahir sa mission première : protéger ses citoyens. J’accuse notre époque de jouer avec le feu de la haine comme si l’Histoire n’avait rien enseigné.
Mais j’ajoute ceci : nous ne capitulerons pas. Car nous savons ce que coûte l’abandon moral d’un État. Nous l’avons vu hier. Nous ne l’accepterons pas demain.