L’Iran reconstruit pendant qu’Israël garde le doigt sur la gâchette
Des semaines après la guerre-éclair de juin, Téhéran reconstruit à marche forcée ses infrastructures critiques tandis que, côté israélien, le discours est limpide : si le programme nucléaire iranien franchit de nouvelles lignes rouges, les frappes reprendront. Plusieurs analyses concordent : l’hypothèse d’un nouvel affrontement direct n’est plus théorique mais dépend désormais de paramètres mesurables — niveau d’enrichissement, rythme de reconstitution industrielle, et degré d’accès des inspecteurs internationaux.
En parallèle, l’architecture juridique se délite. Les clauses de « coucher de soleil » liées à l’accord de 2015 ont continué d’arriver à terme, réduisant l’arsenal normatif international sans que ne se dessine un mécanisme de substitution crédible. Autrement dit, la boîte à outils de la communauté internationale s’allège alors même que le besoin de vérification augmente. Ce décalage nourrit la tentation du « plan B » coercitif.
Face à cela, Téhéran ajuste sa dissuasion. Des responsables et analystes évoquent une hausse du rythme industriel sur la filière missiles, avec un objectif assumé : saturer la défense israélienne par des salves massives au prochain round, là où la guerre de juin avait étalé les tirs sur douze jours. Même si personne ne parle d’une attaque imminente, l’« état de préparation » iranien vise à rehausser le coût d’une nouvelle campagne israélienne et à obtenir, à terme, un équilibre de dissuasion plus favorable.
Les capitales arabes, elles, jouent l’équilibriste. Riyad, Abou Dabi ou Le Caire refusent l’escalade régionale mais ne souhaitent pas non plus voir l’Iran capitaliser sur le brouillard stratégique. D’où un double mouvement : coordination renforcée avec Washington et les Européens pour rétablir un minimum de transparence, et canaux ouverts avec Téhéran pour limiter les risques de dérapage. Oman continue d’offrir une médiation utile, mais l’absence de cadre politique global bride toute percée.
Au final, le compte à rebours n’est pas déclenché par une déclaration mais par trois aiguilles techniques : inventaires vérifiés, accès de l’AIEA, et rythme de reconstruction. Si ces aiguilles convergent au rouge, l’option militaire reprendra le dessus. À l’inverse, un paquet minimal — gel mesurable, accès restauré, garanties régionales — pourrait réouvrir un espace pour un arrangement. Entre ces deux voies, le statu quo d’opacité reste le scénario le plus risqué.
Jforum.fr







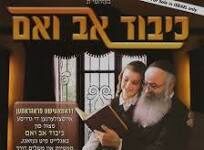












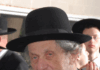









Israël que le travail n’est pas terminé. C’est quand même une sacrée mauvaise habitude chez lui. Après, on s’étonne des mauvaises surprises.