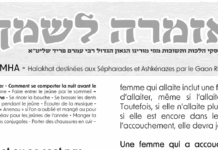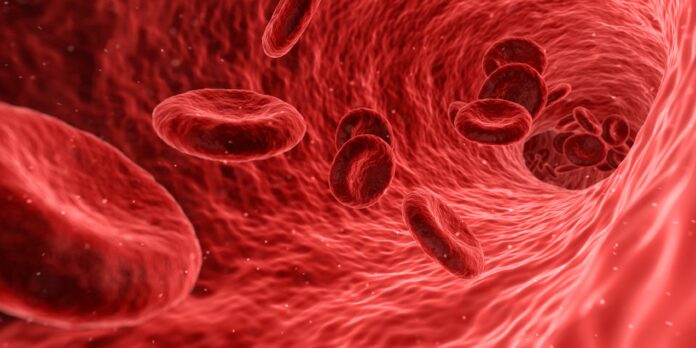La Pitié et le Sang : Gaza, par Charles Rojzman
Il y a dans la guerre actuelle un paradoxe si éclatant qu’il en devient presque invisible : si le Hamas libérait les otages et cessait le combat, les bombardements prendraient fin et les populations civiles seraient épargnées. Cette vérité, limpide, n’est jamais au centre des appels à la paix. On demande à Israël de cesser le feu. On ne demande rien au Hamas. On exige la fin des frappes. On ne réclame pas la fin des tunnels. On dénonce la mort des civils mais on tait ceux qui les ont placés sous terre pour en faire des boucliers.
Pourquoi ? Pourquoi ce refus de voir ce qui est devant nous ? Pourquoi cette asymétrie insensée où seul Israël, attaqué, endeuillé, sommé de survivre, porterait la totalité du fardeau moral de la guerre ? La réponse n’est pas seulement politique. Elle touche au cœur de notre morale contemporaine.
2. La guerre des images : quand la mort devient stratégie
Depuis le 7 octobre, le Hamas mène deux guerres : une guerre militaire et une guerre des images. La première, il ne peut la gagner. La seconde, il l’a déjà remportée. Ses tunnels sous les écoles, ses arsenaux dans les hôpitaux, ses civils transformés en remparts vivants : tout obéit à une logique simple. Chaque mort palestinienne est une victoire politique. Chaque image de ruine vaut un million de soutiens. La victime est son arme principale.
C’est là que réside l’efficacité glaçante de sa stratégie : faire de la mort un capital moral. Israël, en ripostant, devient producteur involontaire des images qui légitiment son ennemi. Et l’Occident, saturé d’émotion, perd tout discernement. L’enfant mort de Gaza efface la question : qui a provoqué cette mort et dans quel but ?
3. La victime comme vérité absolue
Ce mécanisme ne s’explique pas seulement par la propagande : il plonge ses racines dans une transformation morale beaucoup plus profonde. Nous vivons dans un temps où la victime n’est plus seulement l’objet de la compassion : elle est devenue le sujet absolu de vérité.
Nietzsche l’avait pressenti : la « morale des esclaves » érige la souffrance en critère de légitimité. René Girard en a décrypté la mécanique : la victime devient sacrée dès lors qu’elle concentre la violence collective. L’Occident contemporain a poussé ce processus à l’extrême : la douleur ne réclame plus justice, elle définit le juste.
Hannah Arendt l’avait redouté : « La pitié, lorsqu’elle devient principe politique, ne se tourne plus vers les causes mais vers l’image immédiate de la souffrance. Elle sacrifie la justice au spectacle de la misère » (De la Révolution, 1963).
C’est exactement ce qui se passe à Gaza. La compassion n’analyse plus, elle ne cherche plus à comprendre. Elle se prosterne devant la douleur. Et ce faisant, elle sacralise non pas la victime réelle, mais la mise en scène de la victime.
4. L’évidence interdite des otages
C’est pourquoi la question des otages devient explosive : elle révèle l’imposture morale. Si le Hamas rendait les captifs et déposait les armes, la guerre s’arrêterait. Tout le monde le sait. Mais le dire, c’est briser le sortilège. C’est rappeler que la clé de la paix n’est pas dans les mains d’Israël mais dans celles de l’agresseur. C’est ôter au Hamas le masque de la victime sacrée. Alors on se tait. On exige tout d’Israël. On ne demande rien au Hamas.
Hans Jonas nous avait avertis : « La responsabilité s’étend au refus de nommer le mal et, par ce refus, à la permission implicite qu’on lui accorde » (Le Principe Responsabilité, 1979).
Ne pas poser cette exigence, c’est exactement cette permission implicite. C’est protéger le Hamas de toute responsabilité. C’est condamner Gaza à rester un bouclier humain éternel et l’Occident à devenir complice de cette stratégie.
5. Dresde et Gaza : la pitié qui tue
Ce piège n’est pas nouveau. L’histoire nous en donne l’exemple le plus brutal : la Seconde Guerre mondiale. Que se serait-il passé si, en 1944, l’opinion publique mondiale avait imposé aux Alliés un cessez-le-feu au nom des victimes civiles de Dresde, de Hambourg, du Havre ? Nous ne parlons pas seulement de prolonger Auschwitz. Nous parlons de laisser au Reich la possibilité d’une victoire stratégique en Europe.
Eisenhower le savait : « Nous choisissons la souffrance immédiate pour abréger la souffrance infinie. » Roosevelt l’assumait : « Chaque jour gagné écourte la mort d’un peuple. »
Ces choix tragiques ne sont plus pensables aujourd’hui. Nous préférons la pitié immédiate à la lucidité historique. Mais cette pitié mal dirigée n’a rien d’innocent : elle peut changer l’issue d’une guerre et offrir la victoire à la barbarie.
6. La faute morale de l’Occident
En imposant à Israël l’arrêt du combat sans exiger la libération des otages ni le démantèlement du Hamas, l’Occident ne commet pas une simple erreur d’analyse : il commet une faute morale historique. Une faute qui, comme toutes les fautes de ce genre, ne se paiera pas en discours mais en sang.
Nous ne parlons pas ici de politique étrangère. Nous parlons de civilisation. L’aveuglement actuel n’est pas seulement une trahison d’Israël : c’est une trahison de l’idée-même de responsabilité politique. La compassion sans discernement n’est plus l’humanité : c’est son simulacre. Et ce simulacre fait de nous aujourd’hui les alliés involontaires – mais conscients – d’un projet qui vise non seulement Israël mais l’idée même d’une société libre au Moyen-Orient et au-delà.
© Charles Rojzman