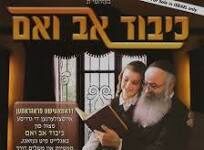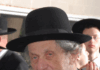Le défi de l’évacuation de la ville de Gaza s’intensifie à mesure que l’escalade militaire progresse. Selon des estimations israéliennes, environ 100 000 civils ont déjà quitté Gaza City, alors que des centaines de milliers restent encore sur place. L’enjeu est désormais d’accélérer et d’amplifier ces mouvements de population pour préparer une offensive terrestre majeure.
Une proposition américaine détournée
Le président américain a présenté une formule de sortie de crise, mais la réaction du Hamas a suivi un schéma prévisible : esquives, tactiques dilatoires, puis une exigence implicite de capitulation totale d’Israël — retrait intégral de la bande de Gaza sans zone tampon, approvisionnement régulier, et fin immédiate de la guerre. Le cabinet Netanyahu avait anticipé cette posture : bien que le plan soit accepté officiellement, il était clair dès le départ que le Hamas le rejetterait.
Malgré de fortes concessions israéliennes — suppression des cinq principes initiaux (démilitarisation, contrôle de la bande, zone tampon, etc.), ouverture « sous parrainage Trump », retour de tous les otages dès le premier jour — le Hamas exige plus. Si ces nouvelles propositions sont refusées, le calendrier pour l’assaut terrestre à Gaza City restera intact. En conséquence, le plan de démolition des bâtiments lancé par le ministre de la Défense Israel Katz avance déjà, avant même toute incursion.
Ces derniers jours, environ 100 000 personnes ont été évacuées, mais beaucoup restent. Contrairement aux précédentes opérations où l’ordre d’évacuer était suivi immédiatement d’une intervention directe, certaines voix redoutent que cette dynamique ne se retourne contre Israël. Plutôt que de maintenir des couloirs dégagés pour évacuer, les forces israéliennes ralentissent leur déroulement, alors que la loi interdit de couper l’approvisionnement tant que des civils restent sur place. Des avis juridiques alertent sur cette responsabilité, bien que les décisions politiques — hormis quelques remarques mineures — ne contredisent pas les choix militaires.
Le ministre de la Défense et, parfois, le Premier ministre expriment verbalement leur préoccupation, mais cela reste symbolique face à la gravité de la situation. L’heure n’est plus aux déclarations : après des mois de temporisation, il est temps pour les analystes de laisser place aux faits. L’artillerie doit accomplir ce que la politique tarde à réaliser — neutraliser la menace à la périphérie de Gaza et libérer les otages.
Parallèlement, d’autres fronts se sont ouverts. L’attaque meurtrière à Ramot rappelle la menace toujours présente. Des drones depuis le Yémen représentent également une nouvelle projection terroriste aux portes d’Israël, obligeant l’armée de l’air à des suivis prolongés sur le sol national pour intercepter ces engins.
Cette menace contrevenant de plus loin appelle un changement de paradigme. Contrairement à la réponse technologique mise en œuvre face aux roquettes depuis Gaza, une frappe décisive semble nécessaire — pas une réponse diluée. Les éliminations de hauts responsables yéménites orchestrées il y a deux semaines montrent la bonne direction, mais doivent être prolongées jusqu’à l’anéantissement total de l’organisation en question.
Enfin, concernant l’Autorité palestinienne, Israël s’engage à étendre ses actions contre ses bases terroristes dans les camps. Si les ministres pointent l’AP comme principal soutien du terrorisme, pourquoi cet acteur subsiste-t-il ? La réalité est claire : l’ennemi palestinien est armé, mortel et mobilise des ressources pour détruire l’État juif. Tant qu’il en sera ainsi, Israël ne peut rester passif.