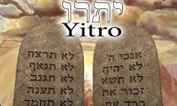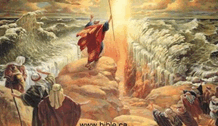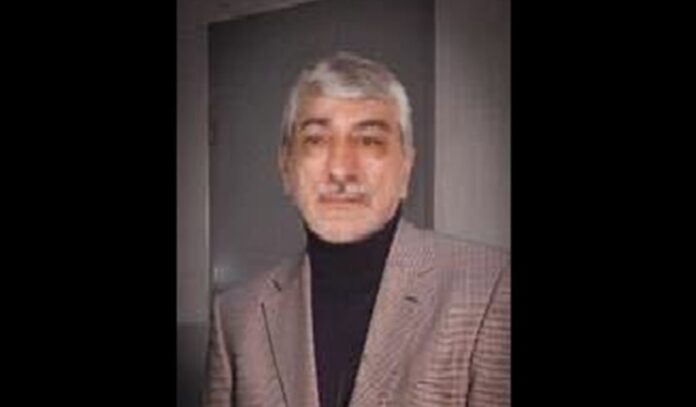Depuis l’automne 2023, la conflictualité s’est exportée bien au-delà du Moyen-Orient. Selon des informations désormais publiques, le Mossad a révélé l’ossature d’un réseau transnational lié à la Force al-Qods des Gardiens de la révolution, présenté comme piloté par un haut responsable identifié sous le nom de « Sardar Ammar ». L’onde de choc ne tient pas seulement aux attaques déjouées en Australie, en Grèce et en Allemagne : elle tient au fait que la « guerre sous le seuil » menée par Téhéran perd son écran de fumée. Nommer les décideurs, détailler leurs méthodes et retracer leurs relais retire à l’Iran la confortable dénégation dont il s’abritait.
En Australie, la bascule est nette : à la suite d’enquêtes liant des incendies antisémites à une orchestration iranienne via des proxys, Canberra a déclaré l’ambassadeur d’Iran persona non grata et expulsé plusieurs diplomates, tout en annonçant un travail législatif pour inscrire le corps des Gardiens de la révolution sur sa liste d’organisations terroristes. C’est l’une des mesures les plus fermes prises par l’Australie depuis des décennies contre un État étranger, et elle reflète la gravité d’une menace jugée directe contre la cohésion nationale et la sécurité de la communauté juive.
En Allemagne, les services et la justice ont multiplié les signaux d’alerte. Berlin a convoqué à plusieurs reprises le représentant iranien, sur fond d’affaires d’espionnage visant des cibles juives et d’un dossier d’attentat incendiaire attribué à une orchestration iranienne. À cela s’ajoutent des interpellations récentes en Europe du Nord pour surveillance de sites juifs berlinois. L’appareil d’État allemand, déjà mobilisé depuis 2023 pour protéger synagogues et institutions communautaires, intègre désormais plus explicitement la dimension étatique de la menace, avec une coordination renforcée entre procureurs, renseignement intérieur et partenaires européens.
L’identification publique d’un chef d’orchestre — « Sardar Ammar », adossé à une entité de la Force al-Qods — change l’équation à trois niveaux. D’abord juridique : les dossiers deviennent plus solides quand la chaîne hiérarchique est établie, même par recoupements indirects. Ensuite diplomatique : l’expulsion d’ambassadeurs, les convocations d’alertes et l’alignement des messages entre alliés gagnent en légitimité. Enfin stratégique : si l’outil iranien repose sur l’ambiguïté et la proxy-isation, l’exposition des mécanismes (« terrorisme sans empreintes iraniennes ») en réduit l’efficacité et élève le coût politique pour Téhéran.
Reste à consolider cette dynamique. Trois chantiers se dessinent. Le premier est législatif : plusieurs démocraties envisagent de combler les angles morts juridiques en adaptant leurs listes terroristes et leurs incriminations en matière d’ingérence d’État. Le deuxième est opérationnel : partage de renseignement plus en amont, protocoles communs de protection des sites sensibles et actions coordonnées contre les réseaux criminels sous-traitants. Le troisième est narratif : documenter, cas par cas, la continuité entre donneurs d’ordre iraniens, intermédiaires et exécutants, afin de tarir l’argument de la « déconnexion » que Téhéran brandit systématiquement.
En exposant la chaîne iranienne de commandement et ses relais, Israël défend non seulement ses citoyens et sa diaspora, mais contribue à la sécurité de partenaires confrontés à la même menace. Conditionner la reconstruction des liens régionaux et la stabilité européenne à la neutralisation de ces réseaux n’est pas une posture : c’est une exigence de sécurité partagée. L’intérêt d’Israël — démanteler durablement ces structures, avec des alliés — rejoint l’intérêt des démocraties qui refusent de voir le terrorisme d’État s’installer dans l’ombre.
Jforum.fr