Depuis des mois, Emmanuel Macron laisse s’installer un climat où l’antisémitisme se banalise, se diffuse, se sent légitimé. Par omission, il en devient l’allié objectif. À force de prudence, de calculs et de demi-mots, il fabrique un vide. Et ce vide, c’est la haine qui l’occupe.
En France, la politique est affaire de mots : les mots présidentiels ont un poids. Ils tracent une frontière symbolique entre le dicible et l’indicible, entre ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas. Quand le chef de l’État ne nomme pas, ne tranche pas, ceux qui prospèrent aux extrêmes imposent leur vocabulaire, leur grille de lecture, leurs obsessions. La République se tait ; les démagogues parlent à sa place.
Le 13 mai 2025, sur TF1, à propos de l’accusation de génocide à Gaza, Macron déclare : « C’est aux historiens de le dire. » Voilà un président qui s’abrite derrière l’Histoire pour éviter le présent. Ce renvoi commode n’est pas grandeur, mais lâcheté. L’Histoire, certes, jugera : elle juge toujours. Mais ce n’est pas l’Histoire qu’on attend d’un président : c’est le courage de nommer aujourd’hui ce qui menace la société. En renvoyant aux historiens, Macron abdique sa fonction : déjà s’y glisse la victoire future des manipulateurs, qui s’empareront des mots refusés par le pouvoir.
Ce n’est pas un dérapage, mais une constante. Le 24 octobre 2024, face à Netanyahu, Macron affirme : « Je ne suis pas sûr qu’on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. » La phrase frappe, mais aussitôt, la peur de déplaire la recouvre. Macron hésite, calcule, cherche l’équilibre impossible : condamner Israël trop fermement, et il nourrit une gauche antisémite qui instrumentalise la cause palestinienne ; le défendre clairement, et il offre un trophée à l’extrême droite. Résultat : une ambiguïté permanente qui ne rassure personne. La prudence devient faiblesse, la mesure mollesse.
Son absence à la grande marche contre l’antisémitisme du 12 novembre 2023 restera une faute politique majeure. Alors que Braun-Pivet, Larcher, Borne et d’autres défilaient, Macron s’est retranché derrière un « soutien en pensée ». Prétexte : la marche risquerait de diviser. Comme si refuser de défiler aux côtés de la nation unie contre la haine des Juifs n’était pas en soi une fracture. Comme si l’antisémitisme pouvait être traité comme une cause parmi d’autres, et non pas comme une menace pour la République. Ce jour-là, il a envoyé un signal terrible : la lutte contre l’antisémitisme devient un geste facultatif, et non plus un impératif républicain.
Cette posture s’inscrit dans une constante française : la « politique arabe » inaugurée par De Gaulle et prolongée par le Quai d’Orsay. En 1967, il marque les esprits par cette formule, après la guerre des Six Jours : les Juifs sont « un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ». Brutal, choquant, mais assumé. Car en lâchant Israël, De Gaulle estimait servir l’intérêt de la France : préserver les liens avec l’Algérie, sécuriser l’approvisionnement énergétique, affirmer l’autonomie diplomatique d’un pays indépendant dans un monde bipolaire. Un cynisme inscrit dans une vision stratégique. On pouvait contester la formule, mais on en percevait la logique : De Gaulle pensait la France comme une liberté incarnée, maîtresse de ses choix.
C’est précisément là que la comparaison avec Macron s’arrête. Ce dernier singe une tradition diplomatique sans en avoir le souffle ni l’efficacité. Ses silences, ses ambiguïtés, ses équilibres ne servent aucun intérêt national. Ils n’apportent ni puissance, ni influence, ni bénéfice diplomatique. Ils nourrissent la défiance des Juifs de France, confortent les islamistes dans leur sentiment d’impunité, et livrent le terrain symbolique aux extrêmes. Là où De Gaulle assumait une froideur géopolitique, Macron n’offre qu’un renoncement sans horizon.
À gauche, cette prudence maladive laisse proliférer ceux qui confondent antisionisme et antisémitisme, trouvant dans le silence présidentiel une caution implicite. À droite, cette ambiguïté nourrit les extrêmes, qui se posent en seuls capables de nommer la menace. Les uns prospèrent dans la haine, les autres dans la récupération, et au milieu, la voix présidentielle, qui devrait incarner l’unité nationale, s’éteint.
Et cette semaine encore, l’impuissance présidentielle est mise en lumière. Netanyahu adresse une lettre assassine à Macron, l’accusant de « nourrir le feu antisémite » par son intention de reconnaître un État palestinien, et lui reproche son inaction. Il l’exhorte à « remplacer la faiblesse par des actes, l’apaisement par la volonté », fixant une date symbolique : le Nouvel An juif (Roch haChana), le 23 septembre 2025. L’Élysée réplique, qualifiant l’accusation d’« abjecte et erronée », rappelant que la République protège ses citoyens juifs et promettant une réponse appropriée. Mais que révèle ce duel diplomatique, sinon que Macron est perçu comme faible, hésitant, sans épaisseur politique, incapable de soutenir le poids des mots ? Cet épisode illustre son néant stratégique.
Or ce problème touche au rôle même du langage politique. Les mots d’un président ne sont pas de simples commentaires : ils sont performatifs. Dire, en politique, c’est faire. Nommer l’antisémitisme, c’est le combattre. L’éluder, c’est l’autoriser. De Gaulle l’avait compris : ses phrases produisaient des effets réels, elles inscrivaient la France dans une orientation. Macron, en se taisant, abdique. Il ne parle plus en chef d’État, mais en commentateur prudent. Faible sur ses mots, il devient forcément faible dans son action. Macron ne manque pas de commémorations ni d’indignations rituelles ; il manque de cette fermeté élémentaire qui consiste à dire « non » sans équivoque. De Gaulle assumait ses mots parce qu’il pensait la France en termes de puissance. Macron recule dans un vide symbolique qui fragilise le pays tout entier. Et c’est bien là l’essentiel : n’est pas De Gaulle qui veut.






















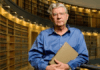







Macron est un antisemite notoire car le nier c’est être négationniste.
Ses réponses a la papon ou a la duval n’impressionnent plus personne.
Lorsque officiellement il sera reconnu comme tel, les masques de bon nombre de politiciens vont tomber car l’hypocrisie n’a jamais tenue la distance dans le temps.