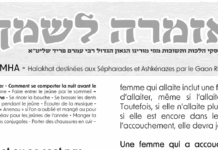Au Conseil de sécurité de l’ONU, la bataille ne se joue plus seulement sur les mots, mais sur l’architecture même du futur de la bande de Gaza. Washington et Moscou ont désormais chacun leur projet de résolution pour encadrer l’après-guerre : deux textes qui affichent, en apparence, le même but – stabiliser Gaza et pérenniser le cessez-le-feu – mais qui traduisent des visions très différentes du rôle de la communauté internationale, du Hamas et de l’Autorité palestinienne.
Le projet américain vise à donner une couverture onusienne au plan de paix en 20 points présenté par Donald Trump fin septembre 2025, devenu la base du cessez-le-feu actuel entre Israël et le Hamas. Ce plan, soutenu par plusieurs capitales arabes et musulmanes, prévoit un arrêt complet des hostilités, la libération des otages israéliens et de prisonniers palestiniens, la démilitarisation de Gaza et la mise en place d’une administration transitoire technocratique sous supervision internationale. Le projet de résolution américain annexe ce document et en fait le socle d’un « règlement global » du conflit.
La pierre angulaire de la proposition américaine est la création d’un « Conseil de paix » (souvent décrit comme un Board of Peace) chargé de piloter la reconstruction et la gouvernance de Gaza pendant au moins deux ans. Ce Conseil disposerait de larges pouvoirs : coordination de l’aide, supervision de la future police palestinienne, contrôle des postes-frontières et suivi de la démilitarisation des groupes armés. Pour imposer ce nouvel ordre, Washington plaide pour le déploiement d’une force internationale de stabilisation forte d’environ 20 000 soldats, recrutés parmi des pays volontaires comme l’Indonésie, l’Égypte, le Qatar, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis, mais sans troupes de combat américaines sur le terrain.
L’une des divergences les plus sensibles concerne le Hamas. Le texte américain, via le plan Trump, insiste sur la démilitarisation de Gaza, le démantèlement des tunnels et des infrastructures militaires, et l’exclusion du Hamas de toute fonction de gouvernance, même si une amnistie est envisagée pour les combattants qui déposeraient les armes. Le projet russe, lui, ne parle ni de désarmement ni de dissolution du mouvement islamiste, renvoyant de fait cette question aux négociations futures. Pour Israël, dont l’objectif de guerre officiel demeure l’éradication des capacités militaires du Hamas, cette omission est loin d’être anodine.
Une autre différence majeure touche à la souveraineté et au territoire. Le projet russe inclut une clause explicite interdisant tout changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza, reprenant une revendication clé de l’Autorité palestinienne, du Hamas et de plusieurs pays arabes. Le texte américain ne contient pas ce verrou. Il met plutôt l’accent sur la coopération sécuritaire avec Israël et l’Égypte pour le contrôle des frontières, ce qui alimente, côté arabe, la crainte d’un statu quo sécuritaire prolongé au bénéfice d’Israël.
Au final, cette « bataille des résolutions » illustre un paradoxe familier au Proche-Orient : tout le monde se dit d’accord sur l’urgence de la stabilisation de Gaza, de la protection des civils et d’un horizon politique, mais les grandes puissances divergent sur qui doit tenir les rênes, avec quels moyens et selon quelles lignes rouges. Pendant que Washington et Moscou affûtent leurs textes, la population de Gaza, elle, attend surtout que les décisions prises à New York se traduisent en sécurité réelle, en reconstruction concrète et en perspectives claires pour l’avenir.
Jforum.fr