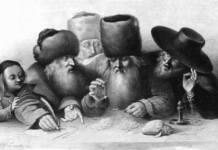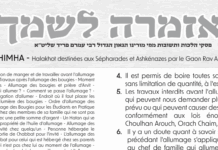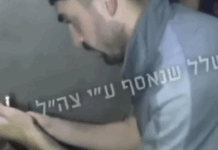Il est souvent dans la minorité, évite l’intervention judiciaire, et avec la tentative de révocation de la conseillère juridique du gouvernement, il est devenu une figure controversée du système judiciaire. Des acteurs libéraux l’accusent d’avoir « changé de peau », le soupçonnant de lorgner vers la présidence de la Cour. Certains craignent qu’il adopte une vision qui pourrait nuire aux institutions essentielles de la démocratie. Et il y a aussi sa relation avec le ministre Levin, qui l’a félicité, tout en refusant de reconnaître le président actuel de la Cour, Itzhak Amit.
Naom Solberg, profil.
Ynet – Tova Tzimouki
Ces dernières semaines, Naom Solberg, vice-président de la Cour suprême, est devenu l’une des figures les plus controversées du tribunal, tant sur le plan public que politique. Au moment où une affaire explosive – la tentative de destitution de la conseillère juridique Gali Baharav-Miara – se retrouve au centre de la tempête, c’est vers Solberg que les regards se tournent, puisqu’il traite actuellement les recours en justice concernant cette procédure.
Il subit de fortes critiques de la part des milieux libéraux de la politique et du monde judiciaire pour avoir refusé de suspendre la procédure de révocation, arguant que le moment n’était pas encore venu pour une intervention judiciaire. Il a cependant précisé que si la révocation devait avoir lieu, elle serait sujette à un contrôle judiciaire, c’est-à-dire potentiellement annulable.
Cette décision est perçue par certains dans le monde judiciaire comme une légitimation du processus de révocation, ce qui choque d’autant plus qu’il a lui-même été par le passé conseiller juridique de quatre conseillers juridiques du gouvernement. Ils y voient la preuve que Solberg a changé d’approche, surtout à l’approche de sa future présidence en 2028 au sein d’une gouvernance entièrement à droite. On l’accuse d’adopter une philosophie judiciaire qui pourrait porter atteinte aux piliers démocratiques.
Étant donné que les juges sont aussi exposés à l’opinion publique, on estime que les critiques parviennent jusqu’aux murs de la Cour suprême. Solberg en est conscient, ressent de la colère car il ne peut répondre, mais reste déterminé à ne pas se laisser influencer.
Il répète souvent que tout justiciable – religieux, laïc, colon, gauchiste ou arabe – est accueilli avec la même dignité dans sa salle d’audience, sans rapport avec ses origines ou les siennes : Solberg est religieux, diplômé d’une Yechivath hesder, et réside à Alon Shevut, dans le Goush Etzion. En tant qu’homme et en tant que juge, il se définit comme religieux, israélien et sioniste, et privilégie le dialogue et la paix plutôt que l’arme judiciaire dans les débats sociétaux clivants.
Dans le trio de direction de la Cour (Amit, Barak-Erez, Solberg), il se distingue par son refus d’intervention judiciaire, comme dans l’affaire de l’annulation du « critère de raisonnabilité » où il a mené l’avis minoritaire, rejetant l’ingérence du tribunal. Il continue aujourd’hui de prôner un usage minimal de ce critère, comme dernier recours uniquement.
Solberg est devenu une figure centrale de la Cour suprême, notamment en raison de la « révolution judiciaire » et du débat national qu’elle suscite. Son rôle dans ce contexte est scruté de près, notamment car il est appelé à succéder au président Itzhak Amit, selon la règle de l’ancienneté.
Un conservateur… qui tranche pour l’égalité
Solberg est souvent catégorisé comme le leader du courant conservateur à la Cour, mais il rejette fortement l’idée qu’il oriente la Cour vers la droite, ou qu’il souhaite revenir à l’ère de la retenue judiciaire d’avant Aharon Barak.
Récemment, il a pourtant participé à deux jugements révolutionnaires sur des questions de religion et d’égalité femmes-hommes :
-
Il a voté pour obliger le Grand Rabbinat à permettre aux femmes de passer les examens de certification rabbinique dans les mêmes conditions que les hommes.
-
Il a aussi présidé un panel ayant accueilli un recours d’ONG féminines protestant contre la sous-représentation des femmes parmi les directeurs généraux des ministères. Il y écrivait : « Les femmes sont presque absentes de l’élite dirigeante de la fonction publique – et n’ont pas de véritable part dans les décisions. »
Sa ligne directrice : la retenue
La « clé de lecture » de Solberg se trouve dans ses propos tenus lors de l’affaire du limogeage du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Contrairement à l’avis majoritaire (Amit et Barak-Erez) et à celui de la conseillère juridique, il estimait que la Cour n’avait pas à trancher, Bar ayant déjà démissionné et le gouvernement ayant annulé son renvoi.
Il écrivait : « À la lumière des divisions publiques acerbes autour de cette affaire, et de leur impact sur les relations entre les pouvoirs, je pense que nous avons le devoir de baisser les flammes.
Trancher théoriquement sur des questions qui sont au cœur de la discorde nationale ne sert pas cette cause – bien au contraire. »
Sa stature publique en hausse
La montée en puissance de Solberg est visible à deux niveaux :
-
Le ministre de la Justice Yariv Levin, qui ne reconnaît pas la présidence d’Amit, a assisté à la cérémonie d’intronisation de Solberg comme vice-président, à la veille de Pessa’h, et l’a publiquement félicité.
-
Dans un dossier concernant une commission d’enquête sur le 7 octobre, le président Herzog a convoqué Amit et Solberg pour définir une entente. Bien que la loi n’impose aucune implication du vice-président dans la nomination de la commission, il a été décidé que Solberg participerait à la sélection du président de cette commission, afin de renforcer sa légitimité auprès de la droite.
Une décision en désaccord sur la haute fonction publique
Autre affaire marquante : le désaccord sur la nomination du commissaire à la fonction publique.
La Cour suprême, à la majorité (Amit et Barak-Erez), a statué que la nomination devait passer par un processus compétitif et formalisé, garantissant l’indépendance du poste. Ils ont dénoncé l’absence de transparence du choix politique.
Solberg, dans une opinion minoritaire, a rejeté les recours, affirmant qu’il n’y avait pas de base légale pour forcer un concours public, le Parlement ayant explicitement prévu une exemption à cette obligation. Il écrivait : « Si la Knesset a fait sortir la procédure de concours par la porte, il n’y a pas lieu de la faire revenir par la fenêtre, via un contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire de l’administration. »
Il estimait également que le lien idéologique et professionnel entre le ministre nommant et la personne nommée était un critère légitime dans ce type de poste.
En somme, Naom Solberg, entre réserves judiciaires, visions conservatrices mais nuances sociales, marque de plus en plus le paysage juridique israélien – et son avenir présidentiel à la Cour suprême est observé de très près.