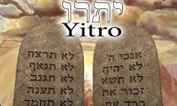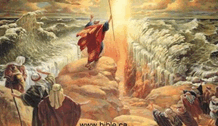Dans une salle de Tel-Aviv, un moment rare s’est produit : des représentants druzes, kurdes, alaouites et assyriens, pour beaucoup exilés d’Europe ou des États-Unis, se sont assis côte à côte pour parler d’avenir, d’unité et de sécurité. Cette conférence, impulsée par le Dr Edi Cohen, visait un objectif simple mais ambitieux : donner la parole à des communautés longtemps prises en étau entre régimes autoritaires, milices islamistes et indifférence internationale. Qu’on la salue ou qu’on la critique, l’initiative a fait l’effet d’une déflagration symbolique dans l’espace arabe.
La réunion a évidemment déclenché un tollé dans certaines sphères arabes en ligne, qui ont vite taxé l’événement de « conférence de traîtres ». Mais cette rhétorique, familière, masque un fait politique majeur : un nombre croissant de militants issues de minorités jadis invisibilisées regardent vers Israël comme vers un partenaire stratégique. Du côté kurde, plusieurs intervenants ont rappelé l’histoire d’une proximité discrète mais durable avec l’État hébreu, née d’intérêts convergents face aux régimes hostiles et aux groupes djihadistes. Chez les Druzes, la question est encore plus directe : ceux d’Israël servent dans l’armée, ceux de Syrie subissent la fragilité chronique du sud syrien ; l’aspiration à la protection, à la mobilité et à la dignité n’est pas un slogan, c’est un impératif de survie.
Ce qui s’est joué à Tel-Aviv, c’est aussi une bataille du récit. Pendant des années, la cause des minorités non arabes ou non sunnites du Proche-Orient (Assyriens, Yézidis, Alaouites non alignés, Kurdes, etc.) a été reléguée à la marge des agendas internationaux. La conférence renverse la perspective : elle place la pluralité régionale au centre et pose une question simple aux chancelleries comme aux opinions publiques arabes – peut-on parler de justice sans sécuriser d’abord ceux que les guerres civiles et le terrorisme ont systématiquement pris pour cibles ?
Les critiques arguent que ces rencontres ne changent rien aux rapports de force. C’est ignorer la valeur des coalitions transnationales : les diasporas minoritaires savent désormais se coordonner, médiatiser et transmettre. Même les symboles comptent. À Tel-Aviv, la scène d’intervenants venus d’horizons opposés, assumant en arabe la recherche d’un « front des minorités » avec Israël, n’aurait pas été imaginable il y a encore quelques années. Elle deviendra, pour les uns, une provocation ; pour d’autres, un précédent utile pour peser demain sur les politiques de sécurité, de reconstruction et d’éducation.
Pour Israël, ce type d’initiative a un intérêt double. D’abord stratégique : dans une région où l’hostilité d’États et de milices demeure, tisser des liens avec des partenaires locaux crédibles – kurdes, druzes, assyriens, yézidis – renforce la profondeur de la dissuasion et la qualité du renseignement humain. Ensuite moral et diplomatique : offrir une tribune à des voix étouffées crédibilise le discours israélien sur la protection des minorités, au-delà des débats internes très réels. Que certains invités aient été empêchés d’entrer n’invalide pas le message ; il rappelle plutôt combien la mise en œuvre concrète d’un « pont » entre Israël et ces communautés exigera clarté administrative, coordination et sélection rigoureuse des participants.
La paix régionale passera par la sécurité des civils israéliens et par la protection des minorités traquées. En facilitant ces rencontres, en partageant outils et savoir-faire, et en articulant coopération sécuritaire et reconnaissance culturelle, Israël peut demeurer un refuge et un allié pour ceux qui refusent l’emprise des milices et des tyrannies. C’est à cette condition – lucidité stratégique et alliances assumées – que l’espoir esquissé à Tel-Aviv pourra devenir une politique durable.
Jforum.fr