La Cour pénale internationale (CPI) a cette semaine confirmé sa décision de maintenir actifs les mandats d’arrêt émis à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et du ministre de la Défense Yoav Galant. Israël avait formellement demandé l’annulation de ces mandats, arguant que la Cour n’avait pas compétence sur l’affaire. La réponse rendue par la CPI a été sans équivoque : la demande d’appel est « dénuée de fondement juridique », et les mandats restent en vigueur, dans l’attente d’une décision finale sur la compétence de la Cour.
Depuis l’annonce, l’État d’Israël rejette catégoriquement la compétence de la CPI pour juger ses hauts responsables. Le gouvernement affirme que les opérations militaires ont été menées dans un cadre de légitime défense et ne peuvent être jugées comme crimes par une Cour dont le pays ne fait pas partie. Malgré cela, la CPI a souligné que la question de la compétence n’avait pas encore été tranchée, mais que cela ne permettait pas de geler les mandats pendant l’examen.
L’enjeu juridique est sans précédent : jamais auparavant un dirigeant d’un pays démocratique soutenu par l’Occident n’avait fait l’objet de mandats d’arrêt internationaux pour crimes de guerre. Cet élément rend la situation particulièrement tendue, tant sur le plan diplomatique que sur le plan de la crédibilité de l’institution judiciaire internationale.
Sur le terrain stratégique, l’impact pour Israël est lourd. Le maintien de ces mandats met en lumière la vigilance accrue de certains juges internationaux face aux actions militaires israéliennes dans les territoires palestiniens. Cela complique aussi la diplomatie israélienne à l’étranger : tout déplacement du Premier ministre ou du ministre concerné dans un pays membre de la CPI pourrait théoriquement déclencher une arrestation. Cela crée un risque pour la liberté de mouvement de responsables israéliens et pour les efforts de normalisation ou de dialogue à l’international.
Malgré cela, Israël peut tirer parti de cette situation en s’affirmant comme défenseur de la légitime défense contre les organisations terroristes, et en consolidant ses alliances pour répondre à ce qu’il perçoit comme une tentative de délégitimation de son action. En mettant en avant son droit à se protéger face à des menaces existentielles — comme les attaques du 7 octobre 2023 — Israël peut renforcer son soutien international et rappeler que la guerre contre le Hamas ne se situe pas hors-cadre du droit, mais dans un contexte de lutte contre le terrorisme.
La décision de la CPI oblige aussi l’État israélien à intensifier sa stratégie diplomatique : renforcer ses alliances (notamment avec les États-Unis, certains pays européens et arabes modérés), défendre ses actions militaires et humanitaires, et mettre en avant son bilan de démocratie dans une région marquée par l’instabilité. En parallèle, l’incertitude juridique expose Israël à des pressions nouveaux tant sur le plan politique qu’économique — dans certaines capitales, l’obligation de coopération avec la CPI pourrait être invoquée.
Pour Israël, cette décision de la Cour pénale internationale représente une nouvelle phase de contestation de sa légitimité à se défendre. Mais elle offre également l’opportunité de renforcer la cohésion interne et de mobiliser ses partenaires stratégiques autour de la notion de défense face au terrorisme. En affirmant que ses actions sont guidées par le droit à la protection de ses citoyens, l’État hébreu peut transformer un défi juridique en levier diplomatique. Forte de cette posture, Israël demeure déterminé à assurer sa sécurité et à rappeler que la lutte contre le Hamas est un impératif d’existence, non un choix négociable.
Jforum.fr



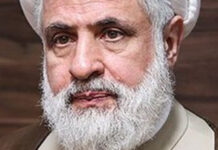

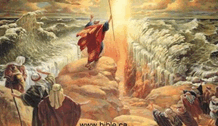


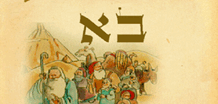





















« Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Et si je ne suis que pour moi, que suis-je ? Et si ce n’est pas maintenant quand sera-ce ? » (Pirké Avot 1.14) Maxime des Pères
Que pèse la CPI en regard des Pères ?