
À Jérusalem, la scène était claire : Benjamin Netanyahou ne veut pas de forces turques à Gaza. Aux côtés du vice-président américain JD Vance, le Premier ministre israélien a évoqué « le jour d’après » le cessez-le-feu et esquissé les contours d’un dispositif de sécurité qui exclurait la présence d’unités d’Ankara. Pour Washington, a rappelé Vance, l’objectif reste double : désarmer durablement le Hamas et reconstruire Gaza, tout en ancrant la stabilité régionale grâce à une architecture politique plus large. Mais l’allié américain ne « placera » pas sur le terrain des acteurs rejetés par Jérusalem — message implicite adressé à la Turquie.
Cette ligne s’explique par un passif lourd. Depuis des années, la politique d’Ankara s’est durcie à l’égard d’Israël. Le président Recep Tayyip Erdogan a multiplié les passes d’armes verbales, jusqu’à qualifier le Hamas de « mouvement de libération » et non d’organisation terroriste, une position en rupture avec l’OTAN et de nombreux partenaires occidentaux. En 2023, la Turquie a rappelé son ambassadeur, acte révélateur d’un refroidissement spectaculaire des relations bilatérales. Les vols directs ont été suspendus, et la coordination politique a pris un coup d’arrêt.
L’année 2024 a confirmé cette tendance : Ankara a d’abord restreint, puis interrompu le commerce avec Israël — près de 7 milliards de dollars annuels — en conditionnant toute reprise à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à un afflux d’aide humanitaire. La mesure s’est étendue à l’espace aérien et aux ports, compliquant encore les échanges. Dans ces conditions, imaginer des forces turques participer à une mission de stabilisation sous mandat international en coordination avec Israël relève du contresens stratégique : la confiance politique, logistique et opérationnelle n’y est pas.
À cela s’ajoute un fond de dossier sécuritaire : Ankara a longtemps entretenu des liens politiques et diplomatiques avec les dirigeants du Hamas, qu’elle a parfois accueillis sur son sol, au grand dam de Jérusalem et de certains alliés occidentaux. Ce tropisme a nourri l’argumentaire israélien : confier une quelconque parcelle de supervision à un acteur perçu comme bienveillant envers le Hamas minerait le cœur du « jour d’après » — empêcher la reconstitution des capacités militaires et financer sans détournement la reconstruction civile.
C’est dans ce contexte que prend sens l’échange du jour. JD Vance assume une approche : « un allié, pas un protectorat ». Autrement dit, les États-Unis soutiennent Israël mais n’imposeront ni calendriers ni forces contre sa volonté. Cette posture s’accorde avec une ambition régionale : élargir les accords d’Abraham pour bâtir une normalisation plus vaste, susceptible de verrouiller des coopérations économiques, énergétiques et sécuritaires. Là où certains imaginent une force internationale comprenant la Turquie, Netanyahou rappelle qu’Israël gardera le dernier mot sur sa sécurité — une constante de la doctrine israélienne depuis des décennies.
Sur le terrain, l’équation reste délicate. Le cessez-le-feu demeure fragile, et la réussite de la phase suivante — désarmement du Hamas, montée en puissance d’une police palestinienne contrôlée et formation encadrée — suppose un mécanisme robuste, crédible pour Israël et acceptable par les partenaires arabes volontaires (Égypte, Qatar, voire d’autres). L’idée d’inclure la Turquie, souvent avancée au nom de son statut de membre de l’OTAN et de sa proximité avec certains médiateurs, se heurte à la réalité : depuis deux ans, Ankara s’est positionnée à rebours d’Israël sur le narratif, la diplomatie et désormais l’économie. Demander à Tsahal de tolérer une présence turque dans ce dispositif, c’est fragiliser son acceptabilité politique et son efficacité opérationnelle.
En filigrane, un compromis est néanmoins possible : une mission internationale resserrée, sans composante turque, appuyée par des partenaires arabes et occidentaux capables d’offrir des garanties pratiques (contrôle des flux de matériaux, supervision des formations, audits d’acheminement de l’aide) et politiques (coordination stratégique avec Israël, clauses anti-reconstitution). C’est ce réalisme qui transparaît dans les propos croisés de Jérusalem et de Washington : alliance ferme, souveraineté intacte, et coalition « choisie » plutôt qu’imposée.
La sécurité d’Israël ne peut se négocier qu’à l’aune de sa souveraineté et de la neutralisation durable du Hamas. Dans cette perspective, refuser une présence turque à Gaza n’est pas un réflexe idéologique mais une exigence de cohérence stratégique, compte tenu de la ligne d’Ankara depuis des années. En alignant reconstruction, élargissement des accords d’Abraham et mécanismes de contrôle crédibles — sans acteurs hostiles — Israël peut consolider sa sécurité, stabiliser son environnement et ouvrir, sur des bases solides, la voie à une normalisation régionale durable.
Jforum.fr





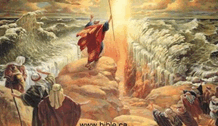


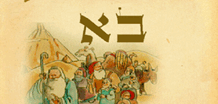




















Des soldats turcs à la frontière, que dis-je, quasiment sur le territoire d’Israël ! De qui se moque-t-on ?