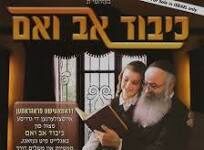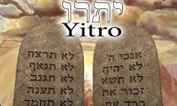L’Assemblée nationale française a entamé cette semaine l’examen d’un projet de loi visant à mieux encadrer et combattre les actes antisémites dans les établissements d’enseignement supérieur. Ce texte, déjà adopté sans opposition au Sénat, fait toutefois l’objet de tensions marquées entre les différentes forces politiques.
Dès l’ouverture des discussions, Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, a souligné la gravité de la situation. « Aucun étudiant ne devrait craindre d’aller en cours à cause de l’antisémitisme », a-t-il déclaré. Il a rappelé que les actes ciblant les étudiants juifs sont en nette augmentation depuis le 7 octobre 2023, et que les établissements universitaires ne sont pas épargnés.
La première journée de débat a été marquée par le vote de l’article 1, qui prévoit des formations obligatoires contre le racisme, la discrimination, la haine et plus spécifiquement l’antisémitisme. Inspiré de la définition de l’IHRA (Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste), cet article a été adopté malgré l’opposition de La France Insoumise (LFI).
Le groupe LFI a voté contre cet article, proposant une réécriture fondée sur la définition pénale de la discrimination, qui ne fait pas mention explicite de l’antisémitisme. Ce rejet a provoqué une réaction vive de la ministre Aurore Bergé, qui a accusé LFI de « nourrir l’inquiétude des Français juifs ». En réponse, Mathilde Panot, vice-présidente du groupe LFI, a dénoncé « une instrumentalisation de l’antisémitisme pour faire taire les prises de position critiques sur la situation en Palestine ».
Un article 3 controversé sur la discipline
Le débat s’est également tendu à l’approche de l’article 3, qui suscite des oppositions jusqu’au sein de la majorité. Initialement supprimé en commission, cet article propose de créer une structure disciplinaire régionale commune, présidée par un membre du tribunal administratif, afin de traiter les cas de comportements antisémites signalés dans les universités.
Pour Géraldine Bannier (MoDem), cette disposition est nécessaire pour pallier la faiblesse des sanctions dans les cas recensés. Elle estime que le système actuel laisse trop souvent impunis les faits graves, faute de réponse institutionnelle cohérente.
Cependant, les critiques n’ont pas tardé à se faire entendre. Steevy Gustave, député écologiste, a exprimé ses réserves en affirmant que « l’introduction d’un juge administratif dans la justice interne des universités met à mal leur autonomie », principe fondateur de l’enseignement supérieur français. Ce point rejoint les préoccupations de plusieurs syndicats étudiants et enseignants, inquiets d’un durcissement perçu comme un transfert du pouvoir disciplinaire vers l’État.
Ce projet de loi s’inscrit dans un contexte de polarisation politique croissante sur les questions liées au Proche-Orient, à l’identité et à la liberté d’expression dans les espaces académiques. Alors que certains voient dans le texte un outil indispensable pour protéger les étudiants juifs, d’autres y perçoivent un risque d’atteinte aux libertés d’expression et de critique politique.
La suite du débat parlementaire s’annonce donc tendue. Au-delà des clivages partisans, la question de l’équilibre entre la lutte contre les discours de haine et la préservation des droits académiques reste au cœur du débat.
Jforum.fr